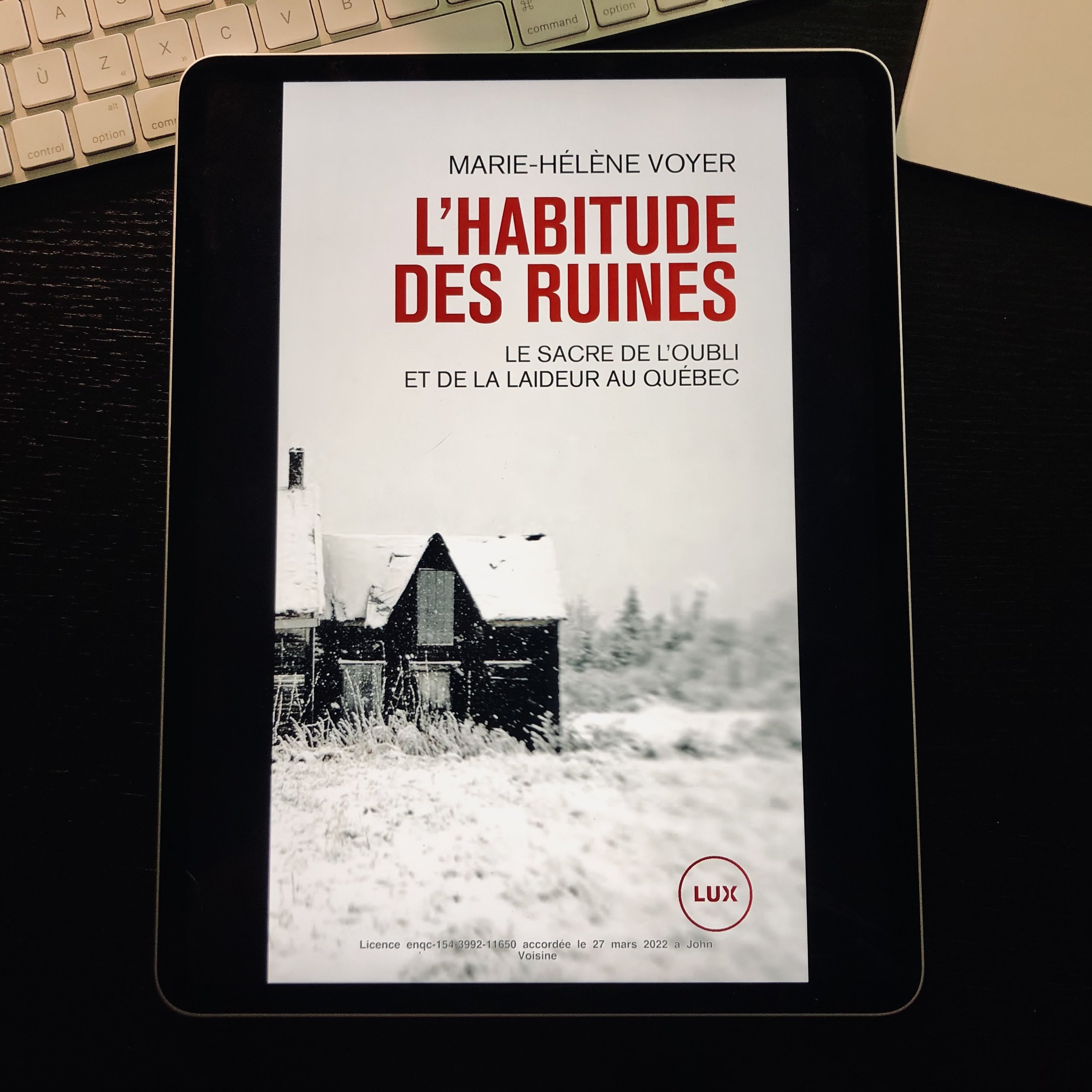L’habitude des ruines—Le sacre de l’oubli et de la laideur au Québec. Marie-Hélène Voyer, Lux Éditeur, 2021, 217 pages. Lu en format PDF sur app Books.
Certains livres nous travaillent beaucoup plus que l’on aimerait se l’admettre. Que ce soit par la forme ou le fond, ces ouvrages viennent nous chercher dans ces angles morts qu’on préférerait renier jusqu’à l’existence, que ce soit pour des raisons positives ou négatives. Le charme d’une prose bien tourné ou le mordant d’un humour sagace pourrait nous faire pencher en direction d’un argumentaire compromettant; facile et séduisant dans l’évocation de sa forme, mais que l’on devine avoir des conséquences réelles des plus funestes. Dans un sens, si l’on est honnête avec soi, ces moments démontrent la fragilité des arguments les mieux appuyés. En d’autres circonstances ou sous d’autres cieux, avec quelque levier bien placé, il aurait été tellement facile de se retrouver ailleurs sur le spectre. There but for the grace of God go I.
De façon encore plus dangereuse, il est parfois satisfaisant de lire un défoulement vigoureux, un déversement de feu sur une position, une cause ou même une personne, surtout si celle-ci incarne, selon nous, des comportements lâches ou malhonnêtes sur le plan humain ou intellectuel. Mais la satisfaction que procure un tel défoulement vient presque toujours obscurcir une insécurité que l’on devrait trouver le courage d’interroger.
Finalement, et à l’inverse, quoi de plus exaspérant qu’un auteur qui, dans son zèle pour une cause qui nous tient à cœur, dans une prose sclérosée, lourdement appuyée, grave sans être sérieux et sans humour, en oublie la base de toute coalition d’utilité publique : il est plus important de trouver les moyens de mettre le plus de gens derrière soi (en faveur d’un objectif) que contre soi. La plupart du temps, cela implique au minimum de faire l’effort de ne pas traiter la vaste majorité de la population comme s’ils étaient des idiots incapables de comprendre leurs intérêts ou ce qu’ils veulent, ou comme de simples pions dans un jeu capitaliste qui les dépasse. Cela fait piètre forme, ferme les cœurs et les esprits (du moins, en ouvrent très peu à la cause), nous ostracise d’un large bassin potentiellement réceptif et ne fait qu’inviter les pires partisans : conservateurs, refermés, frileux et paranoïaque.
En poursuivant au livre
On l’aura bien compris, le livre de Madame Voyez se situe catastrophiquement dans cette dernière catégorie. Non seulement est-il de lecture pénible par sa forme, mais en plus, par la manière dont se construit son argument en faveur de la conservation et de la valorisation du patrimoine bâti, il serait douteux si une seule personne, en dehors du cercle restreint aggloméré à la cause autrement que de façon dilettante, pouvait se voir recrutée.
En fait, il n’y a rien de fondamentalement compromettant à cette façon de faire les choses. Comme je le mentionnais, il est parfois satisfaisant, sur le plan personnel, d’utiliser un moment de notre parcours intellectuel pour écorcher l’ordinaire et les épouvantails faciles à moquer, comme le façadisme, le pastiche, les gros «Domaine» de banlieue et les «fontaine-buste à l’effigie d’Elvis» que l’on y «soupçonne dans chaque cour arrière» (ma grand-mère maternelle [God rest her soul] était une grande fan du King); bref, une vaste majorité de la population voit ici son mode de vie, et la nécessité d’en faire ce que l’on peut, passer au pilori d’une personne qui cherche manifestement, chez les gens avec le moins de choix, plus de coupables que de solution.
Pour les partisans du patrimoine, de la conservation du bâti et de ceux qui aimeraient voir renaître une vraie architecture urbaine, dense et diversifiée, ce livre est un repoussoir de plus de la part d’une personne qui prétend plaider la cause. À l’heure actuelle, partout en Amérique du Nord, la sauvegarde et la conservation du patrimoine sont menacées, non par une culture qui dénigre cet héritage, mais par une réglementation municipale hostile à sa propre nature. New York City ne peut pas se reconstruire. Mon triplex construit en 1920 à Verdun, héritage de ma grand-mère maternelle, rénové et restauré par moi-même à l’original : je ne pourrais le reconstruire en 2022, cette typologie étant bannie pour cause d’exigences de stationnement et autres réglementations de construction, de lotissement et de densité (c.-à-d. de non-densité).
Au lieu de chercher des alliés à la cause, Madame Voyez a trouvé plus facile et satisfaisant de s’en prendre aux «promoteurs qui ne pensent qu’à engloutir l’espace et le bien commun pour leur propre profit.» Triste.
Ce jeudi 19 mai on entame notre série sur le logement et l’habitation avec le fameux livre de Catherine Bauer, Modern Housing. On trouve une liste des livres qui seront passés en revue sur la première page de ce site.
(2022-05-19) : Je dois remettre la publication de cette revue à lundi prochain, le 23 mai. En attendant, la revue de l’Ordre des urbanistes du Québec (OUQ) vient de sortir un numéro avec un dossier spécial sur l’habitation intitulé « Repenser l’habitation ». Il est possible de le télécharger sans frais ici. Je n’ai aucune association avec la revue.