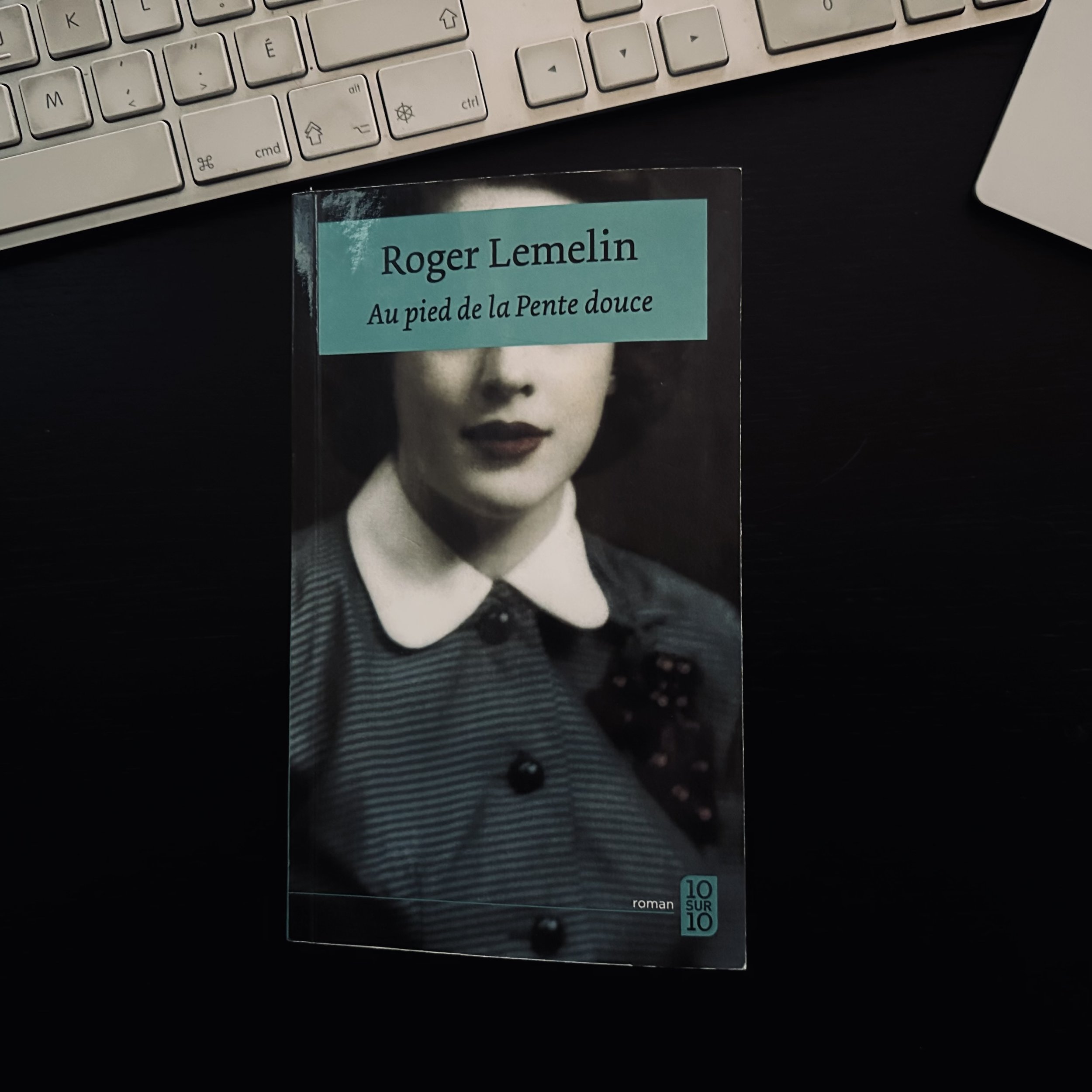Au pied de la Pente douce. Roger Lemelin, Stanké, collection 10/10, 2009 (Édition de l’Arbre, 1944), 388 pages.
Série fiction — À tous les deux mois
J’eus beaucoup de difficulté à lire et finir Au pied de la Pente douce cet automne. C’était le premier roman de Roger Lemelin. Lorsque l’on parle encore de lui, c’est généralement pour sa série Les Plouffe (qui se déroule dans le même univers). On le mentionne aussi pour avoir été président et éditeur du quotidien La Presse durant les années 1970, jusqu’en 1981. En d’autres termes, ce fut un homme à la carrière autant politique que littéraire, même si celle-ci était autrement plus du côté de la représentation politique que littéraire. C’était aussi à une époque où ce genre de mélange était possible et même relativement courant.
Si je compare maintenant la Pente douce à un roman paru presque simultanément et à l’impact analogue, Bonheur d’occasion de Gabrielle Roy, le contraste peut être choquant. Ce dernier, par exemple, trouve encore sa place dans tous les syllabus de programme de littérature, du secondaire au cégep et à l’université. Il est facile de se le procurer dans toutes les bonnes librairies, en volume de poche, en édition cadeau ou, sans jeu de mots, en livre d’occasion. Après l’expérience de lecture comparativement pénible que je viens de vivre avec la Pente douce, cet état de fait ne surprend plus.
Je suis pourtant ce ceux qui aurait aimé affirmer que ce premier roman de Lemelin est un classique injustement oublié de la littérature urbaine canadienne-française. À côté de Bonheur d’occasion, il est toutefois vrai que la Pente douce est le premier de ce genre qui fait, dans le roman, une translation de la fameuse « misère » canadienne-française en milieu urbain. Mais, là où mes souvenirs du roman de Gabrielle Roy sont ceux d’une lecture viscérale, qui vient nous chercher là où la douleur se cache, la Pente douce laisse perplexe devant des situations et des dialogues rendus dans une langue et imprégnés d’une culture qui ne s’assimile que péniblement. Étant donné la profusion de noms, prénoms et surnoms utilisés par l’auteur, il est souvent difficile de savoir de qui ou de quoi il est question entre les personnages. À leur décharge, ceux-ci ont toutefois un vrai dialogue intérieur, mais ce qui les fait « tiqué » nous est si étranger qu’il est parfois ardu de suivre la logique du déroulement du récit. Et si l’on ajoute à cela la difficulté de comprendre les enjeux des situations décrites, il est naturel que l’abandon de la lecture, avant la deuxième partie, qui est pourtant plus engageante, devienne la solution la plus courante.
En dernier lieu, j’aimerais toutefois faire un appel à la persistance à travers les pages touffues de ce roman, en quelque sorte un pionnier du genre. Le choc du changement et de l’évolution ne peut être absorbé et compris qu’en faisant preuve d’indulgence (la seule manière de comprendre profondément). Il faut se placer en position de vulnérabilité, en lecteur ouvert à ce qui devait, il n’y a pas si longtemps, être un univers assez commun pour enfin mériter sa propre trame. Le fait que l’écart entre cet univers et le nôtre soit un véritable canyon plutôt qu’une « pente douce » ne devrait toutefois pas surprendre. Je n’ai aucun doute que Roger Lemelin, dans ce premier roman écrit à 23 ans, ait évoqué fidèlement une tranche de vie des gens du quartier Saint-Sauveur, en basse-ville de Québec, juste avant le deuxième conflit mondial. C’est à nous maintenant de nous équiper pour cette randonnée, si l’on veut bien s’y plaire.