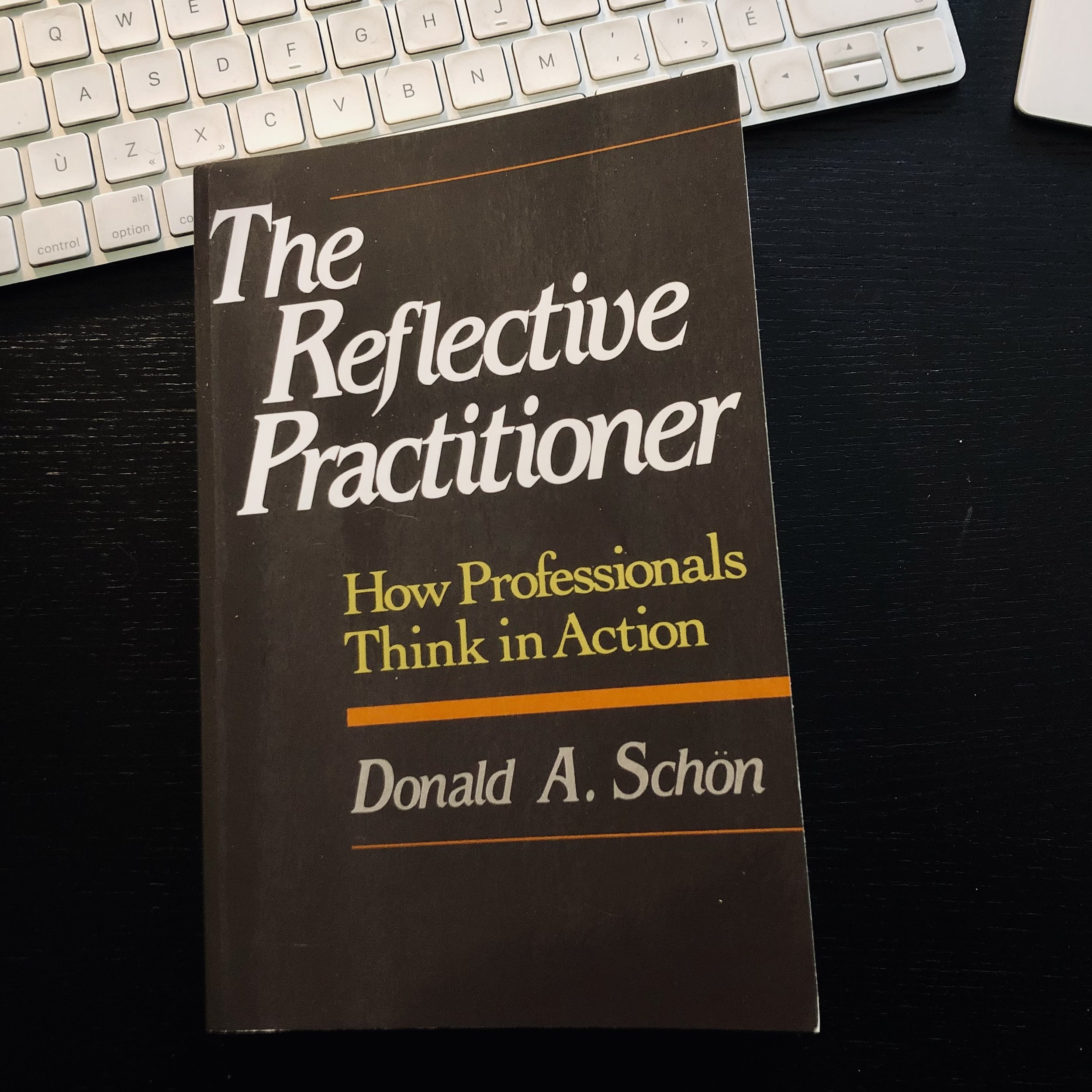Aménagement et urbanisme au Québec. Témoignages de pionniers et pionnières de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme depuis la Révolution tranquille. André Boisvert, Les Éditions GID, 2014, 723 pages.
The Reflective Practitioner—How Professionals Think in Action. Donald A. Schon, Basic Books, 1983, 374 pages.
Je fais cette semaine un premier, mais certainement pas un dernier, «deux dans un». Le premier est un véritable tome, avec ses 700+ pages d’entrevues, de récits, d’anecdotes, de réminiscence et de réflexion sur les pionniers/praticiens/professionnels de l’urbanisme dans la province. Le second, découvert en lisant le premier, nous offrira un moment d’introspection sur les limites de nos méthodes, outils et démarches professionnelles à appréhender la complexification des sociétés modernes.
On aimerait mettre le livre de Monsieur André Boisvert entre les mains de tous les étudiants universitaires en urbanisme au Québec; toutefois, le mieux serait dans le contexte d’un cours bien encadré. Cela n’est nullement attribuable à un défaut d’auteur ou dans la présentation du matériel lui-même. Publier en un volume le travail de plus d’une décennie d’entrevues avec les pionniers de la profession ne pouvait autrement faire que d’occuper des centaines de pages. Au contraire, on salut Monsieur Boisvert d’avoir laissé place aux propos des Benoît Bégin (2018), Jean-Claude La Haye (1998), Rolf Latté (2005), Blanche Lemco Van Ginkel, Marcel Junius (2018), Claude Langlois (2002), Ilona Kaszanitzky (2001), Jean Cimon (2016), Jean Décarie (2020) et Michel Barcelo (2013), pour ne nommer que ceux-là. On lit avec fascination les témoignages vifs de ces praticiens des premières décennies de l’après-Deuxième Guerre, parfois sans pouvoir immédiatement faire sens de tout ce qui est dit. En plus d’avoir souvent dû être recrutés à l’étranger (l’Angleterre et la Belgique ont été de gros bassin), même les gens d’ici ont tous dû recevoir l’essentiel de leurs formations dans des universités hors du pays, qui commençaient elles-mêmes juste à reconnaître la validité et l’autonomie de cette profession.
Pour se faire une idée de cette pratique pionnière et des défis qu’elle aura à transcender afin d’avoir le droit de citer, les témoignages recueillis sont tous aussi unique qu’essentiel en leurs genres. Une bonne capacité à rassembler mentalement des morceaux de récit, à suivre une trame à travers plusieurs regards (Rashomon style), sera d’un grand secours. Résultante de la franchise et de l’ouverture de la démarche, cela ne constitue en rien une lacune de l’ouvrage. Il faudra toutefois en être conscient : ce livre n’est pas une histoire de l’urbanisme au Québec. Mais pour qui en a l’inclination, il est quand même assez formidable de lire ces bâtisseurs de la profession exposer, dans leurs mots, ce que fut ce travail de pionnier.
Une pratique professionnelle hybride
Pour qui voulait exercer professionnellement ce qui ne sera reconnu que bien plus tard comme de l’urbanisme, il faudra auparavant avoir reçu une formation de premier cycle en ingénierie, en architecture, en architecture du paysage, en géographie ou même en sociologie. Ces professionnels de la première heure sont par la suite parvenus à appliquer leurs connaissances («transversale» avant l’heure) à une échelle invisible pour l’époque (le Québec pré-Révolution tranquille) : celle de l’urbain existant (accommoder l’automobile, faire tabula rasa du reste) et de l’urbain des nouvelles banlieues, alors en explosion. La notion même d’exercer une pratique professionnelle indépendante (sans la béquille de l’ingénierie ou de l’architecture) prendra finalement jusqu’aux années 1960 pour s’implanter. Je ne sais pas si c’est l’héritage de la formation hybride, mais même après le montage de curriculum universitaire local, une forte résistance à l’admission dans la profession des étudiants issus des programmes de baccalauréat en urbanisme a longtemps persisté. Aujourd’hui, demeure la question du titre réservé (urbaniste), mais sans l’association avec des actes réservés (contrairement aux professionnels adjacents, qui ont souvent les deux). Ces deux situations seraient-elles liées? Je suis de l’école qu’il en est mieux ainsi pour la viabilité et le potentiel à long terme de la profession.
Pour nous faire réfléchir sur le sens de l’exercice et de la pratique professionnelle, mais aussi sur les limites de nos méthodes et processus, l’ouvrage de Donald A. Schon est particulièrement pertinent. La crise de crédibilité des professionnels et de l’expertise en général est maintenant difficile à ignorer (voir l’ouvrage de Tom Nichols, The Death of Expertise).
Malgré tout, plusieurs possibilités d’exercer à partir d’un terrain solide de recherches et d’actualisation contextuelle existent encore. À moyen terme, une profession d’urbaniste plus ouverte sur ses limites, plus rigoureuse dans l’identification explicite des biais qui encadre ses conclusions et toujours plus tournée vers des résolutions de design inclusives gagnerait dans l’affirmation de notre discipline plurielle.
Publié une première fois le 20 janvier 2022.