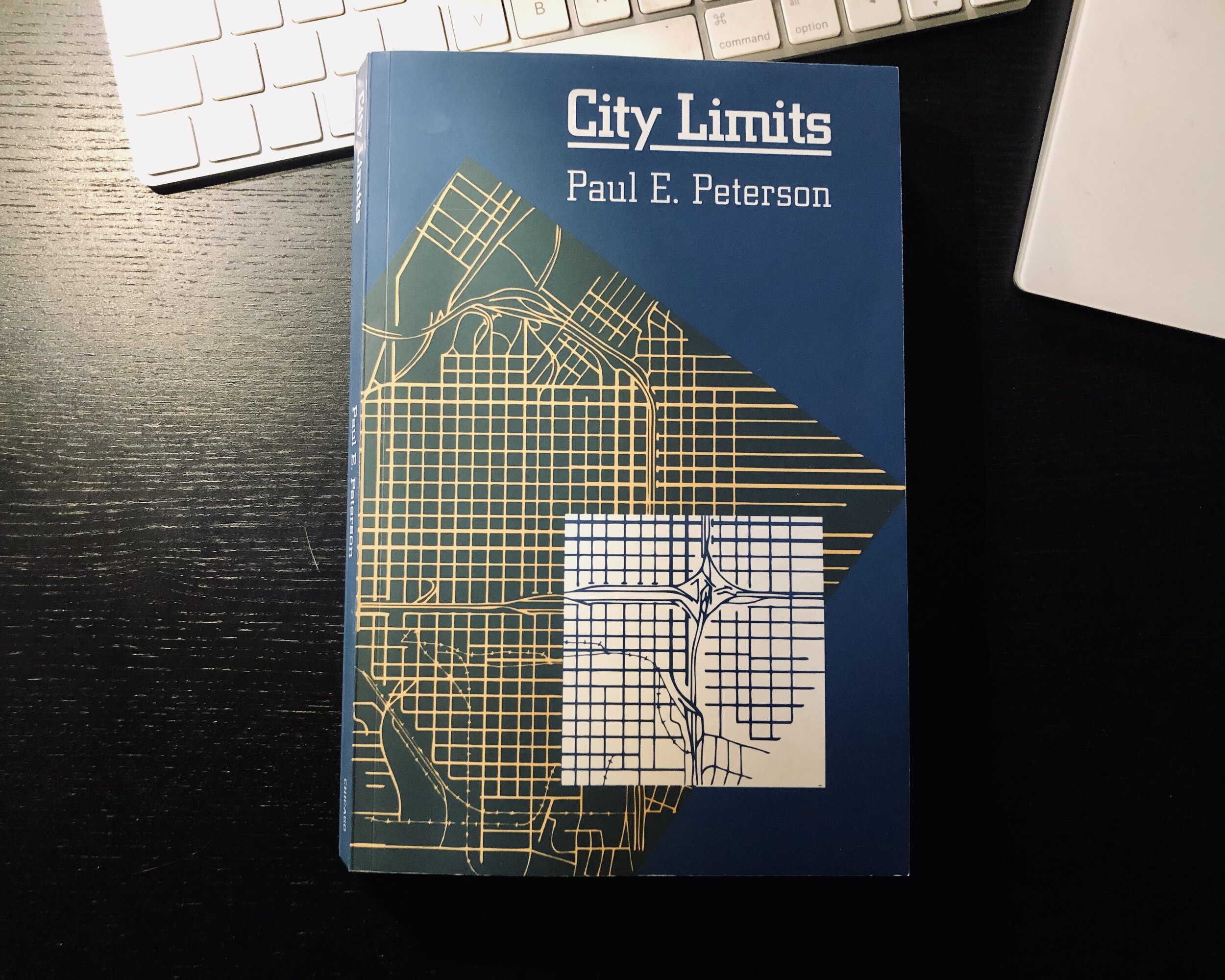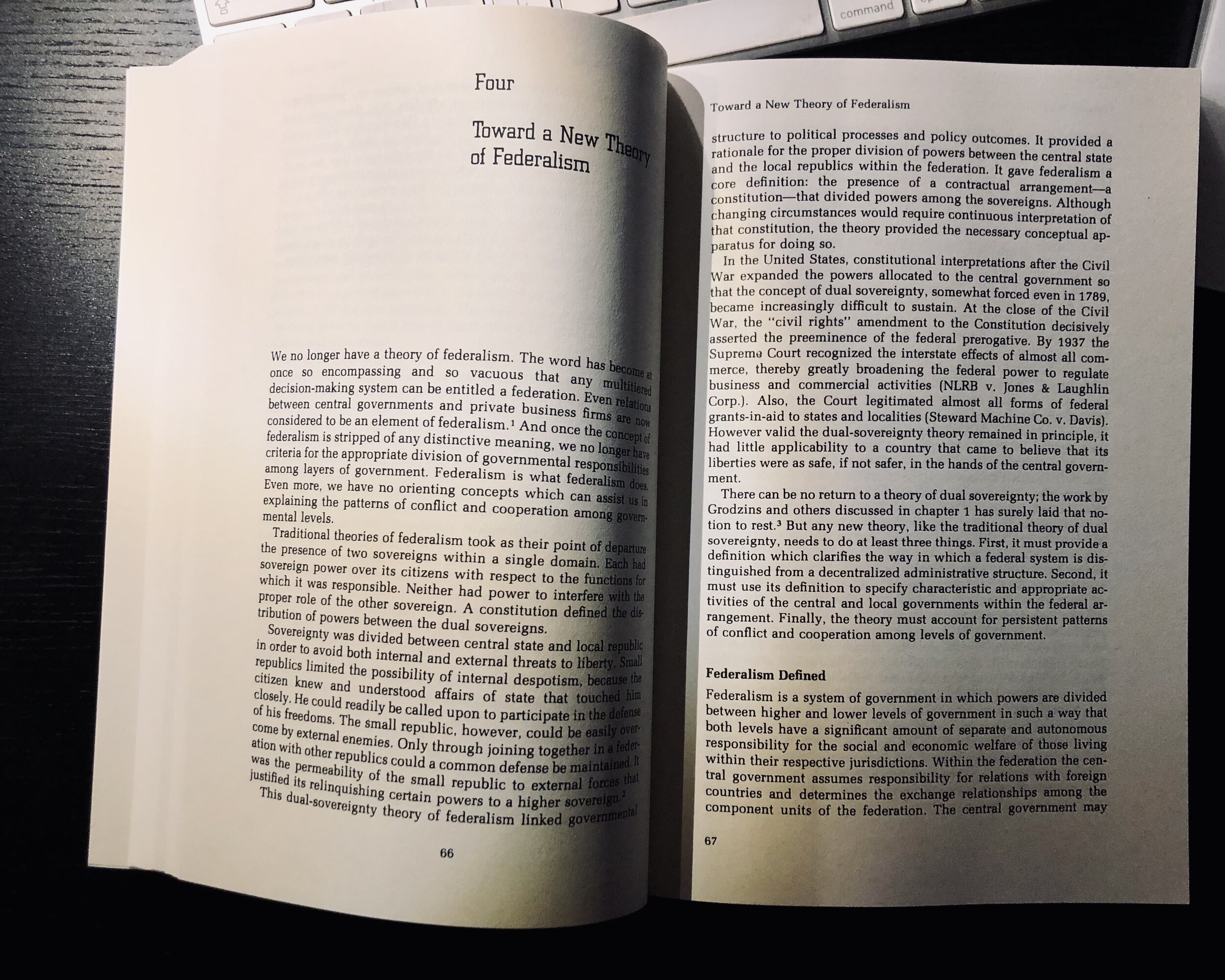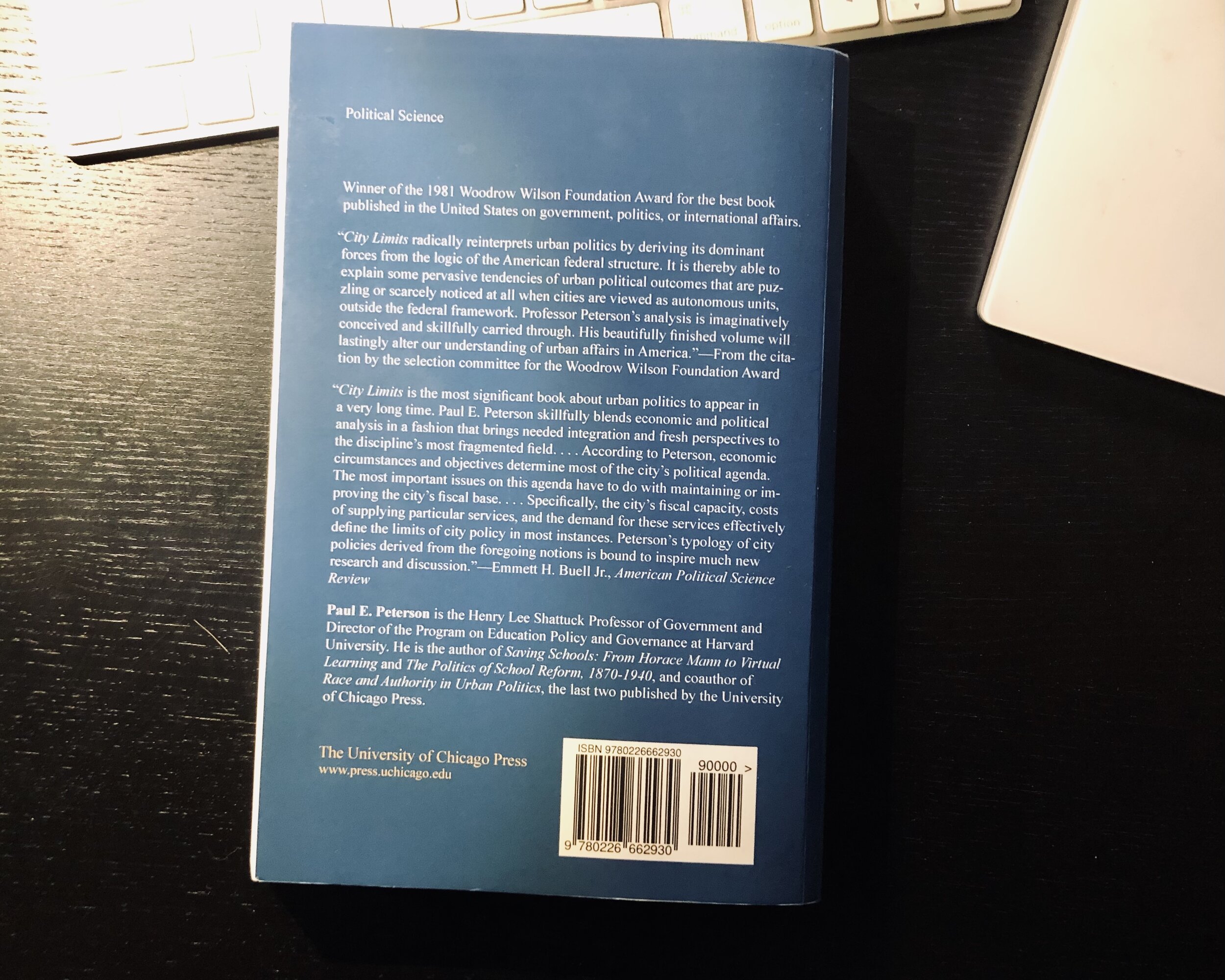City Limits. Paul E. Peterson, The University of Chicago Press, 1981, 268 pages.
S’il faut en croire les discours de plus en plus courants, les administrations municipales auront dans l’avenir (et ont déjà maintenant, parfois) des responsabilités qui ne cessent de s’accumuler. En plus des responsabilités de base, comme le contrôle de l’urbanisme, les inspections réglementaires, l’hygiène publique et la voirie, il faut en plus s’assurer maintenant d’avoir un environnement urbain résilient et préparer des contingences afin de faire face aux changements climatiques. Les administrations municipales doivent de plus se charger de ces responsabilités avec comme presque unique source de revenus la taxe foncière (et quelques miettes en frais de service). De plus, toujours en assurant de boucler le budget annuel sans faire de déficit. L’emprunt est aussi soumis à des paramètres stricts. Sur le plan de la gouvernance, les municipalités ne sont pas vraiment des gouvernements, autant dans leurs organisations que sur le plan de leurs statuts constitutionnels (c’est d’ailleurs la raison qu’il est plus exact de parler « d’administration municipale »). Comme les fusions au Québec (ou « l’amalgamation » de Toronto) l’ont bien démontré, il y a à peine une vingtaine d’années, les cités et villes de nos provinces ont bien peu de latitude, si un matin le gouvernement provincial décide de les encadrer autrement ou même de les rayer de la carte.
City Limits est écrit pour un contexte et un cadre spatio-temporel bien différents du nôtre, soit les États-Unis du début des années 1980. Les évènements (parfois traumatiques) de la fin des années 1960 étaient encore frais dans les mémoires. On pense aux émeutes raciales, au phénomène du « white flight », l’implantation des programmes découlant de la « Great Society », comme la « War on poverty » et la législation du Civil Rights Act, tous voté par le Congrès grâce à la persistance du président Lyndon. B. Johnson. Ce sont toutes là autant de mesures aux répercussions alors très contestées. Aussi, en 1975, le moment « Ford to City: Drop Dead » sera exploité autant par ceux qui y voyaient l’exemple de la déchéance urbaine (à droite), que par ceux qui espéraient ainsi (au centre et à gauche) recentrer les politiques sur une ville intrinsèquement riche en humanité et en ressources matérielles.
Sur les traces de City Limits
On pourrait donc penser que dans ce contexte si particulier, un lecteur canadien qui cherche à mieux comprendre ses « administrations » municipales n’y trouverait pas vraiment son compte. Mais l’approche de M. Paul E. Peterson, qui ce concentre sur les possibilités limites et les politiques communes que peuvent exercer de façon réaliste les administrations municipales, capture de façon assez universelle la nature et les limites de ce niveau de pouvoir dans une enceinte politique de type « fédéré », comme le Canada. Ainsi même si l’analyse contextuelle de l’auteur repose sur des données et des statistiques d’un autre pays (quoique toujours nord-américain) et d’une autre époque (certaines ont maintenant plus de soixante ans !), cela ne semble pas invalider les caractérisations sur le plan des « politiques urbaines » et de la « politique urbaine ». En tenant compte des ajustements inévitables qu’il faut assumer entre nos deux pays, la lecture en trois « limites » du possible des politiques urbaines, soit le développement (le « boosterism »), les « allocations » (les services de base d’une municipalité) et la redistribution (les services « sociaux » d’une ville), présentés en ordre croissant de difficulté, semble faire le tour des capacités consensuelles limites de la politique municipale.
Là où le livre et son propos montrent vraiment leurs âges est sur la question du diagnostique des conséquences réelles des politiques qui visaient à réduire, limité drastiquement ou même effacer toute trace de « redistribution ». Loin d’être des freins à la création de la richesse collective (l’auteur pose ce constat comme une loi immuable), il est maintenant plus facilement reconnu qu’une redistribution éclairée est à la racine d’une cité créatrice de richesse. Un ouvrage récent comme The Sum of Us d’Heather McGhee illustre à quel point tout le monde perd quand cet aspect est négligé, surtout en contexte urbain.
Un autre problème avec un ouvrage publié en 1981 est que la vaste majorité des références sont maintenant inaccessibles ou sans objet. Mais il y en a deux qui vont mériter de se retrouver sur ma liste : Lonely Crowd, de David Riesman et de Richard Hofstadter, The Age of Reform, qui se trouvera justement à être commenté la semaine prochaine.