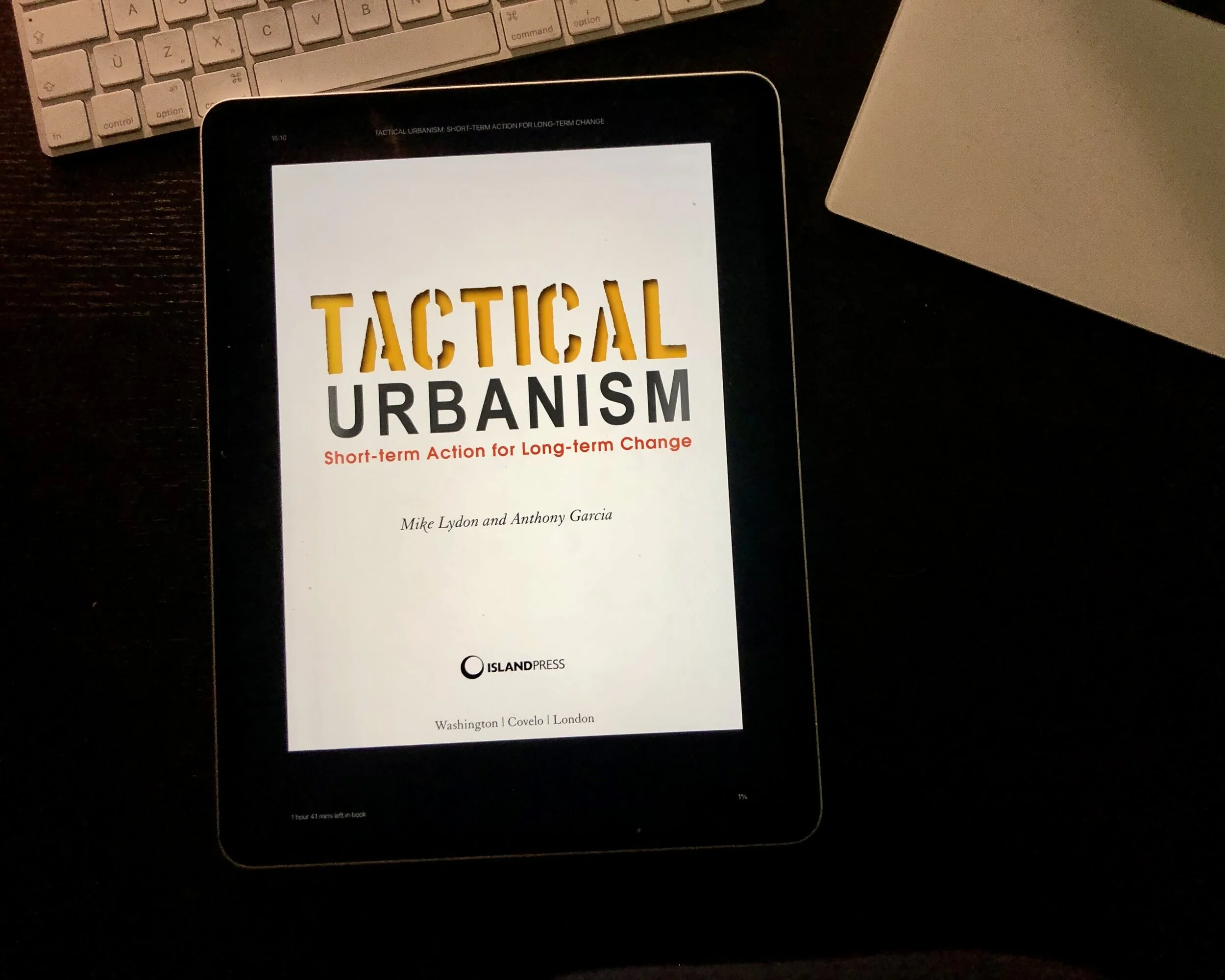Tactical Urbanism—Short-Term Action for Long-Term Change. Mike Lydon and Anthony Garcia, Island Press, 2015, 256 pages [e-book lu sur application Kindle]
La semaine dernière, on avait la chance de passer en revue l’ouvrage du regretté Jaime Lerner et ainsi de constater avec bonheur les possibilités offertes par différents types « d’acupuncture » urbaine. On présentait cette notion un peu comme une forme de proto-urbanisme tactique, des interventions à l’échelle de la rue ou du lot, mais aux bénéfices à l’échelle du quartier ou même de la ville entière, dans le meilleur des cas. L’urbanisme tactique, tel que défini dans ce livre fondateur du domaine, se réclame de cet héritage, tout en formalisant les paramètres de cette notion. Il faut dire que les auteurs et la firme qu’ils ont fini par bâtir sont justement à l’origine de la cristallisation et de la prise de conscience collective (dès les premières années du 21e siècle) autour des opportunités créées par cette prise en charge par des citoyens ou groupes de la société civile des interventions dans l’espace urbain, surtout ici en Amérique du Nord.
Pendant une bonne partie du 20e siècle, urbanisme rythmait avec mégaprojet sur méga-îlot fraîchement généré en faisant table rase de l’existant (le plus vieux, le mieux). On allait enfin réaménager nos villes et quartiers selon les canons infaillibles de la nouvelle modernité portée par les CIAM. En deux-trois-quatre décennies à peine, nos pouvoirs démocratiques se sont laissé capturer par les intérêts des manufacturiers automobiles, à la quasi-exclusion de toute autre priorité collective ou urbaine. Il nous suffit de regarder par la fenêtre pour constater que l’espace public de nos rues, la façon d’aménager et de structurer nos espaces bâtis, est toujours accaparé par cette monomanie automobile.
Entrent en jeu les citoyens (ou groupe citoyen) qui, face à cette négation de la ville, s’organisent pour agir directement sur ou dans l’espace public (parfois même privé) afin de démontrer qu’il est possible de penser, donc de faire autrement. Dans le meilleur des cas même, l’urbanisme tactique est utilisé par les autorités municipales elles-mêmes. Le plus souvent, suite aux pressions et avec la participation des citoyens, afin de démontrer, sur une base expérimentale, temporaire et à une fraction du coût d’un aménagement permanent, les possibilités d’une intervention qui sort des sentiers battus.
Sur les traces de Tactical Urbanism
Les limites des interventions tactiques sont essentiellement celles de l’imagination de celles et ceux qui veulent bien prendre les risques qu’implique ce type d’action. Sous sa forme la plus pure, l’urbanisme tactique est la façon la plus visible et viscérale d’envoyer un message d’une volonté de changement. Dans un sens, c’est aussi le symptôme d’un échec de la gouvernance municipale; que les citoyens soient rendus à l’action directe et matérielle afin de faire valider ce qui est, le plus souvent, un strict minimum de la civilité urbaine, comme des intersections sécurisées ou une utilisation inclusive de l’espace public, devrait faire réfléchir sur l’état de nos démocraties municipales.
Mais il faut aussi bien l’admettre, ces interventions résultent en des projets qui auraient autrement été complexes de faire activer par un organisme municipal. Le livre en donne plusieurs exemples, comme un projet de signalisation, Walk [Your City], qui vise à inciter les gens à marcher dans leurs villes, en passant par ce qui est presque devenu le porte-étendard de l’urbanisme tactique, c’est-à-dire l’activation au niveau du « block » urbain, merveilleusement incarné par l’organisation caritative Better Block Foundation. Dans les municipalités qui se veulent représentatives d’une certaine volonté citoyenne, il existe même des portails facilitant la présentation de projets à la ville ; l’ouvrage fait mention de San Francisco et Los Angeles, mais il y en a probablement d’autres ?
Concernant strictement la Ville de Montréal, il ne semble pas y avoir de ressources spécifiques. Notre ville n’a pas une culture d’accueil des interventions directes, comme pourrait en témoigner le (maintenant) fameux Roadsworth. Le Centre d’écologie urbaine de Montréal, sur son site Bâtir ensemble la ville active, a réalisé une page Web qui donne de bons outils contextuels pour qui aimerait s’organiser, tactiquement parlant.
En dernier lieu, voici trois ouvrages cités et qui apportent un complément aux notions élaborées dans Tactical Urbanism. De Nabeel Hamdi, Small Change—About the Art of Practice and the Limits of Planning in Cities (2004) et The Placemaker’s Guide to Building Community. Pour méditer sur notre situation, avec le recul de l’histoire : The Incorporation of America—Culture and Society in the Gilded Age.