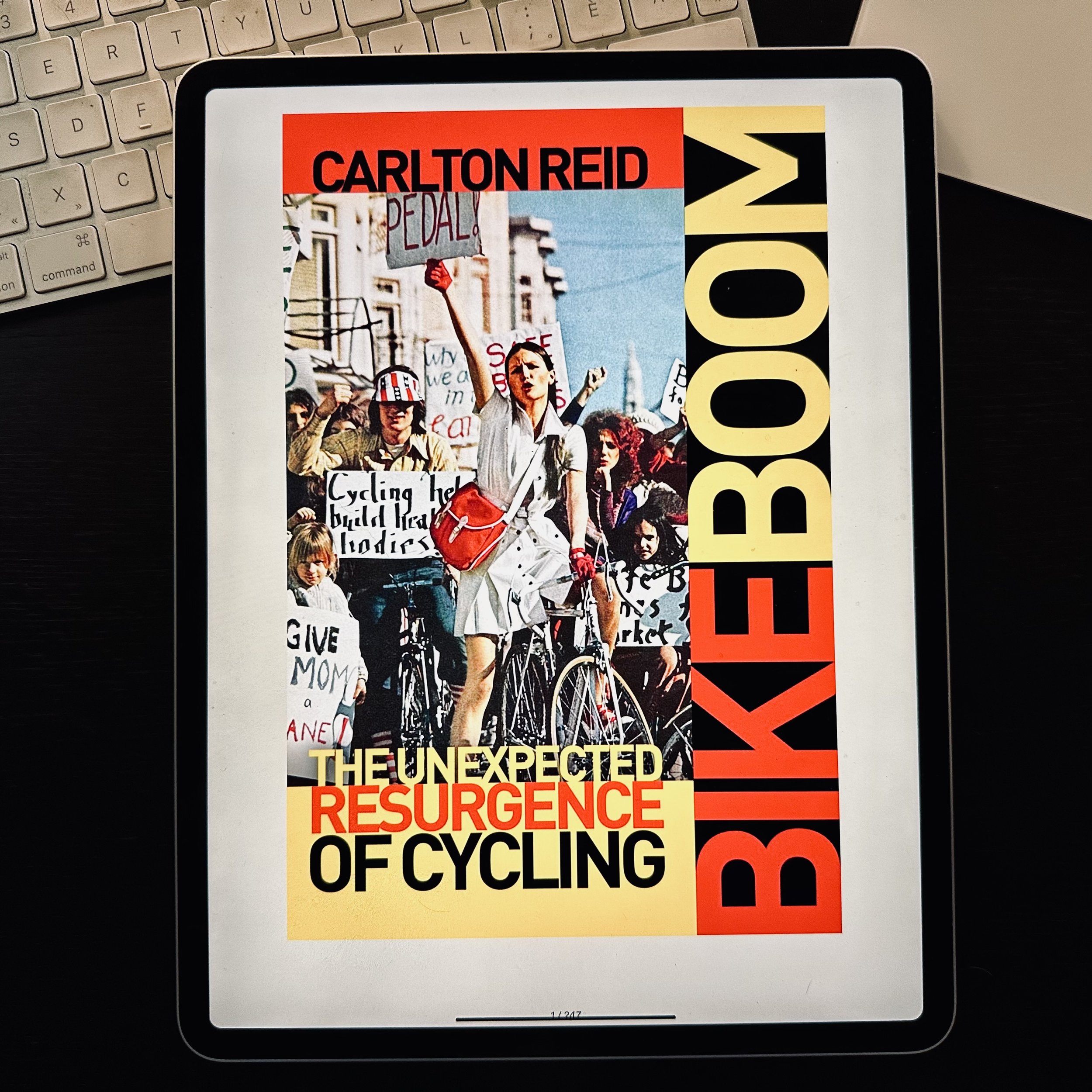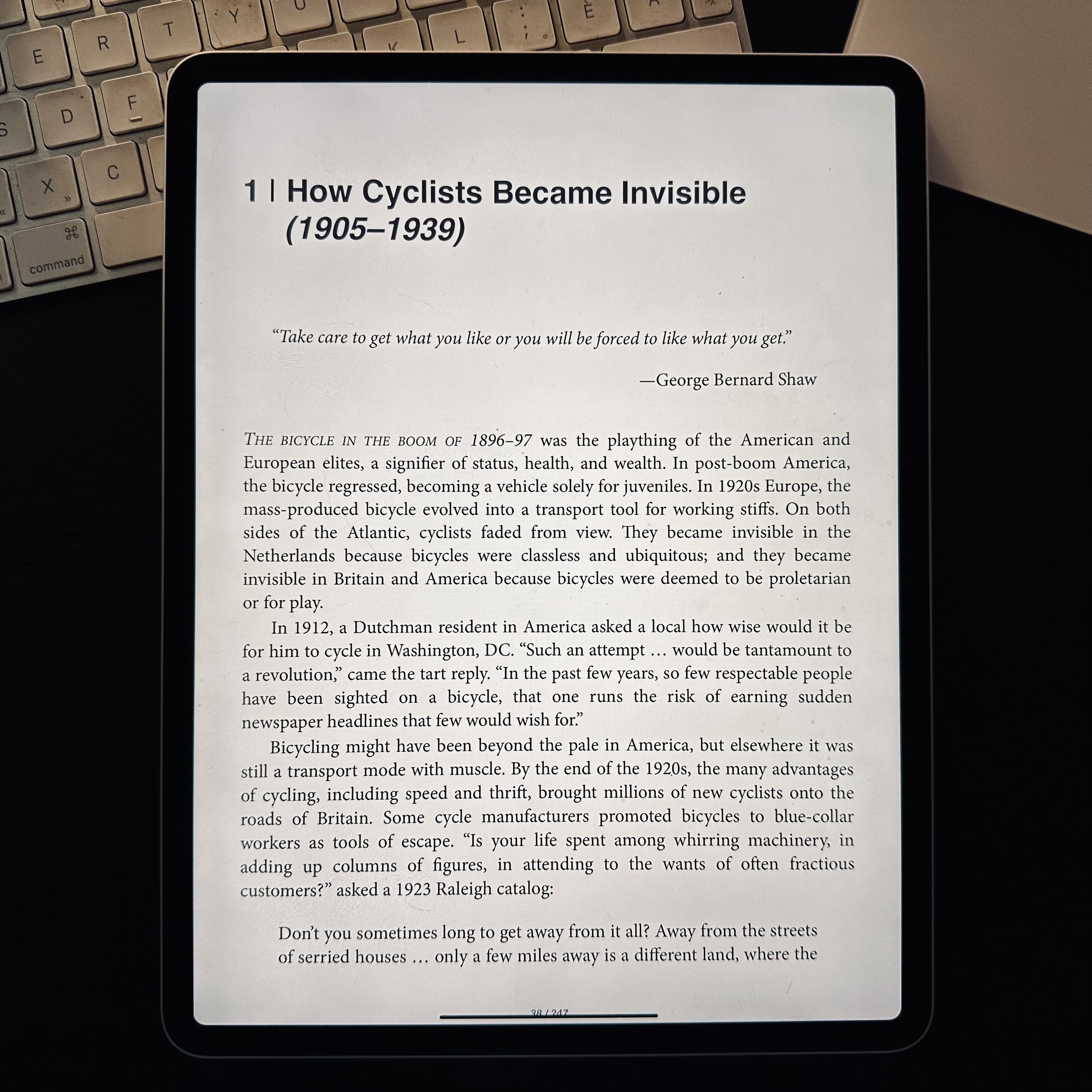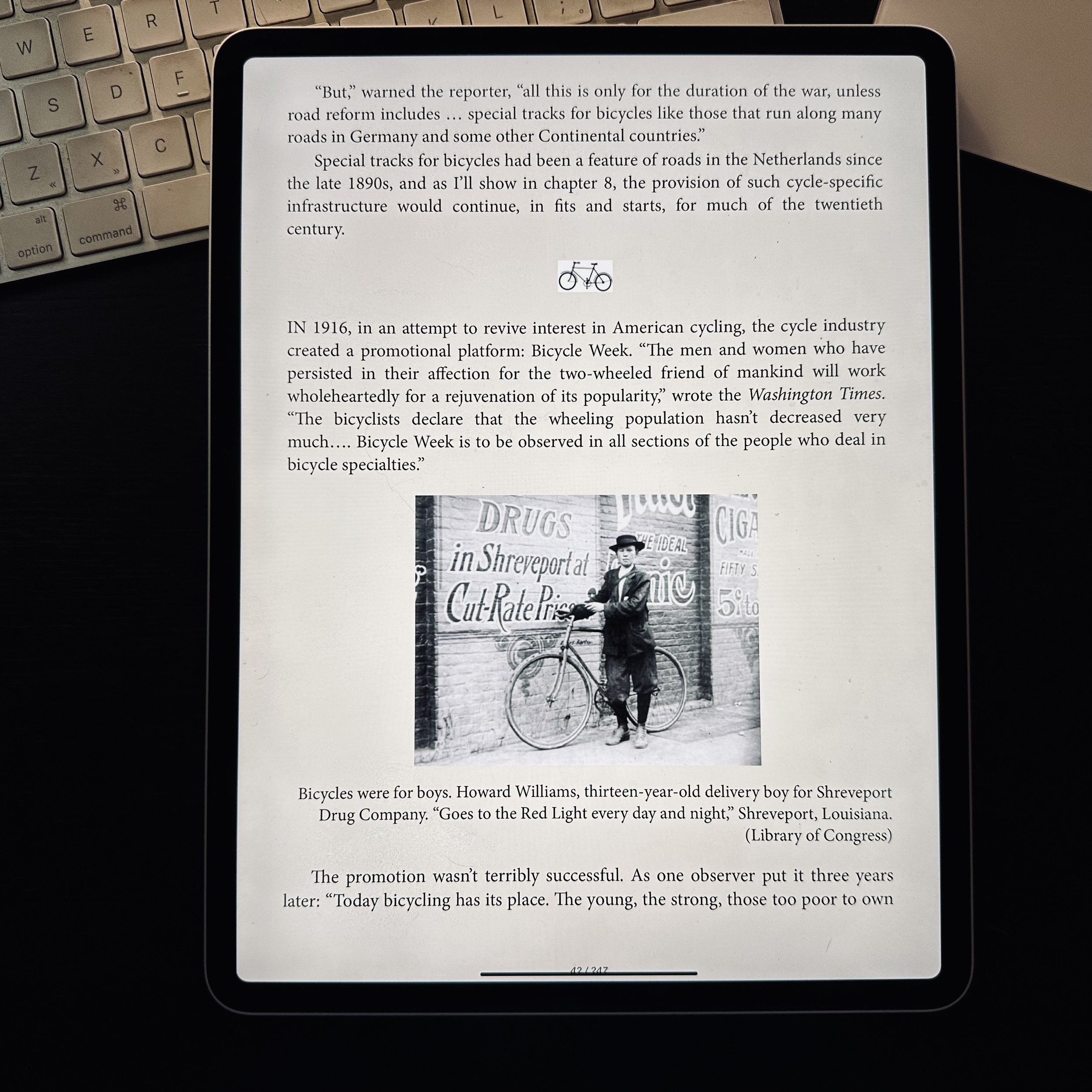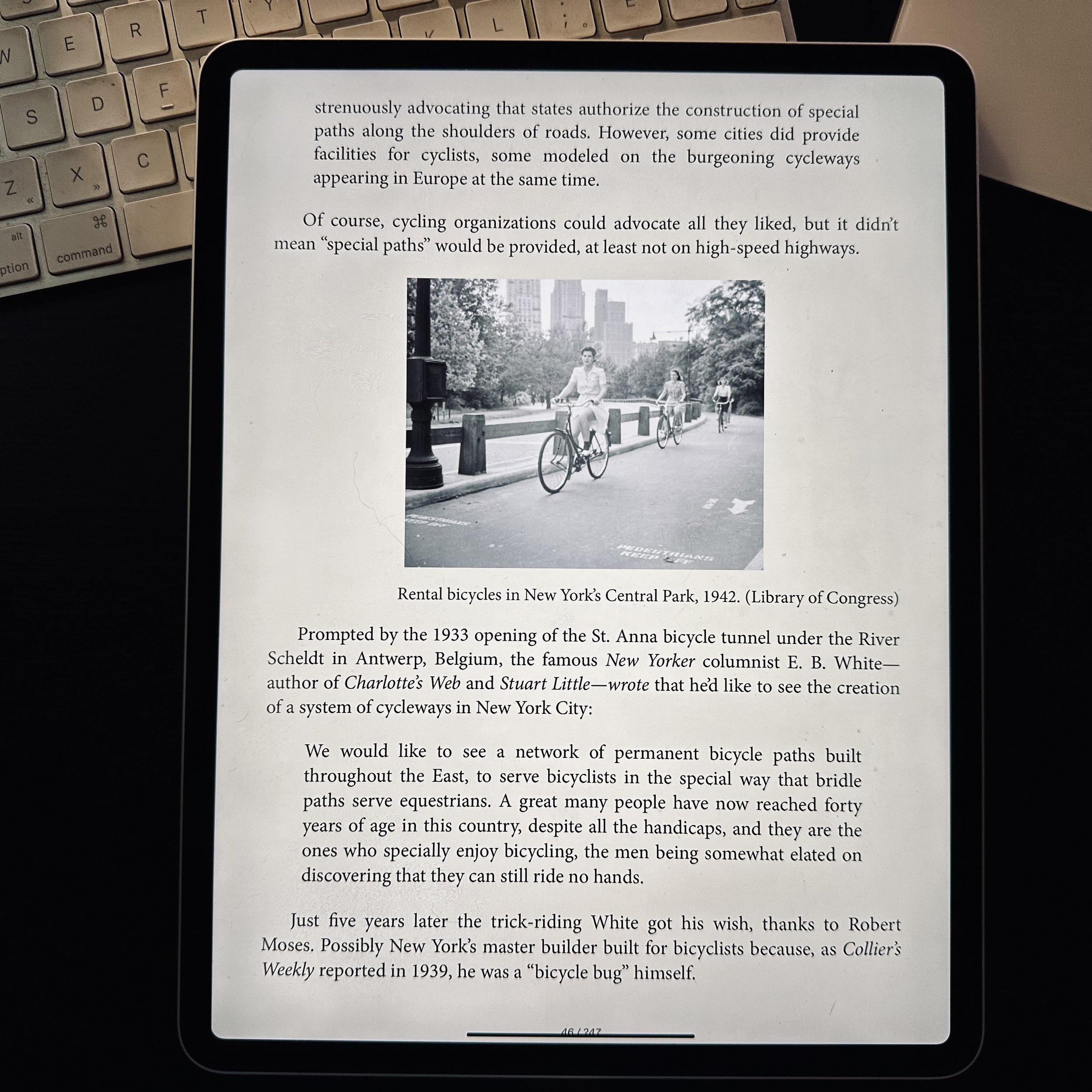Bike Boom—The Unexpected Resurgence of Cycling. Carlton Reid, Island Press, 2017, 272 pages [ebook lu sur support Adobe Digital Editions]
Cette chronique est la deuxième de notre série Le vélo et la ville [2/5]
Si l’on veut voir le bon côté des choses, on peut toujours se dire que nous sommes présentement dans une ère de mini-boomettes-bicyclettes. C’est-à-dire que, du moins si nous avons la chance de vivre dans un arrondissement de la ville de Montréal, autant du côté des autorités municipales que dans la population en général, il y a un enthousiasme pour tout ce qui tourne autour du vélo et des infrastructures qui en facilite une utilisation régulière, banale et quotidienne, que ce soit sur rue ou en site propre. Il était temps, dirions-nous. Enfin, il semble entendu qu’une rue sécurisée pour les cyclistes et les piétons l’est pour tous. Mais le cafouillage aux intersections, la confusion persistante sur les flux et les priorités demeure toujours la règle à Montréal. La prise de conscience sur la nécessité d’évoluer le design, sur le fait de concevoir de manière à contraindre (ralentir) la circulation pour infléchir les comportements commence à faire son chemin. Il est même permis de penser que le réflexe sera bientôt naturel lors de toutes modifications à la voie publique. Nous avons les voies cyclables intégrées à la trame urbaine, il est temps d’universaliser son corollaire, l’intersection protégée.
La pièce manquante mais pourtant essentielle du réseau cyclable urbain à Montréal
Mais pour le moment, le constat le plus réaliste que nous pouvons faire est que nous n’en sommes pas rendus à ce niveau de conscientisation. Aucun problème à implanter un Réseau express vélo (REV), mais rendu à l’intersection, les cyclistes (et les piétons, pour dire vrai) sont laissés à naviguer sans le bénéfice d’une infrastructure protégée conçu pour eux. C’est pourtant exactement à l’endroit où cela serait le plus bénéfique en termes de sécurité et de fluidité, paradoxalement. Il est bon de voir qu’avec le temps, le discours est passé de la « ségrégation » des usages à un autre qui vise plutôt « l’intégration » de ceux-ci. Encore une fois, il faut embrasser le paradoxe d’une intégration des usages multiples dans la voie publique afin de maîtriser (par le design) ce ballet urbain (pour paraphraser) au bénéfice de tous. De cette cohésion nouvelle, c’est les activités de la ville contemporaine qui en sortiront gagnantes.
Sur les traces de Bike Boom
Pour autant, si nous persistons en ce sens, avec de plus en plus de voies cyclables dédiées et intégrées aux rues et artères urbaines, avec des intersections dûment protégées et aménagées de façon appropriée, assisterons-nous à un «changement de paradigme», une évolution vers un pourcentage substantiel (45 %!) accaparé par le vélo? En lisant la page Web de la Ville de Montréal consacré au REV, on constate que leur objectif est de porter celui-ci à 15 % d’ici 2027 (il était de 5 % au centre de l’île en 2021). L’auteur de ce livre (d’ailleurs le même que la semaine dernière, le thème étant pour lui comme une suite logique) nous apprend qu’aux Pays-Bas, la part modale du vélo était de 26 % en 2016 (elle réside maintenant autour de 36 %), mais que s’il faut en croire les chiffres historiques, ce pourcentage est moins de la moitié de ce qu’il était dans les années 1920; aucun doute, l’emprise de l’automobile y était embryonnaire à l’époque. Mais il est aussi facile d’imaginer que même si l’emprise de l’automobile était assez restreinte à Montréal dans les mêmes années, il n’y a probablement jamais eu de contexte où le vélo constituait une part appréciable des déplacements annualisés.
Cela nous ramène sur le champ conceptuel principal abordé par l’auteur, soit l’apport de la «culturel» dans l’évolution de la part modale des différents moyens de transport. Carlton Reid fait principalement le contraste entre l’Angleterre, les Pays-Bas et le « basket case » que représente les États-Unis quand vient le temps d’évaluer la fraction vélo du cocktail transport. Bien entendu, nous vivons ici à Montréal de façon quasi unique les après-chocs du Great American Bike Boom que furent les années 1970-1974, avec la création d’organismes de pression comme Vélo Québec et un peu plus tard, le Monde à bicyclette. L’auteur consacre même une annexe (Vive la Vélorution!) à l’histoire exceptionnelle de Montréal par rapport au vélo et fait un tour du militantisme à bicyclette avec le regretté Bob Silverman.
Ce que ce livre nous rappelle surtout est que la participation dans les transports actifs est autant une question de culture que d’infrastructure. À bon entendeur,…