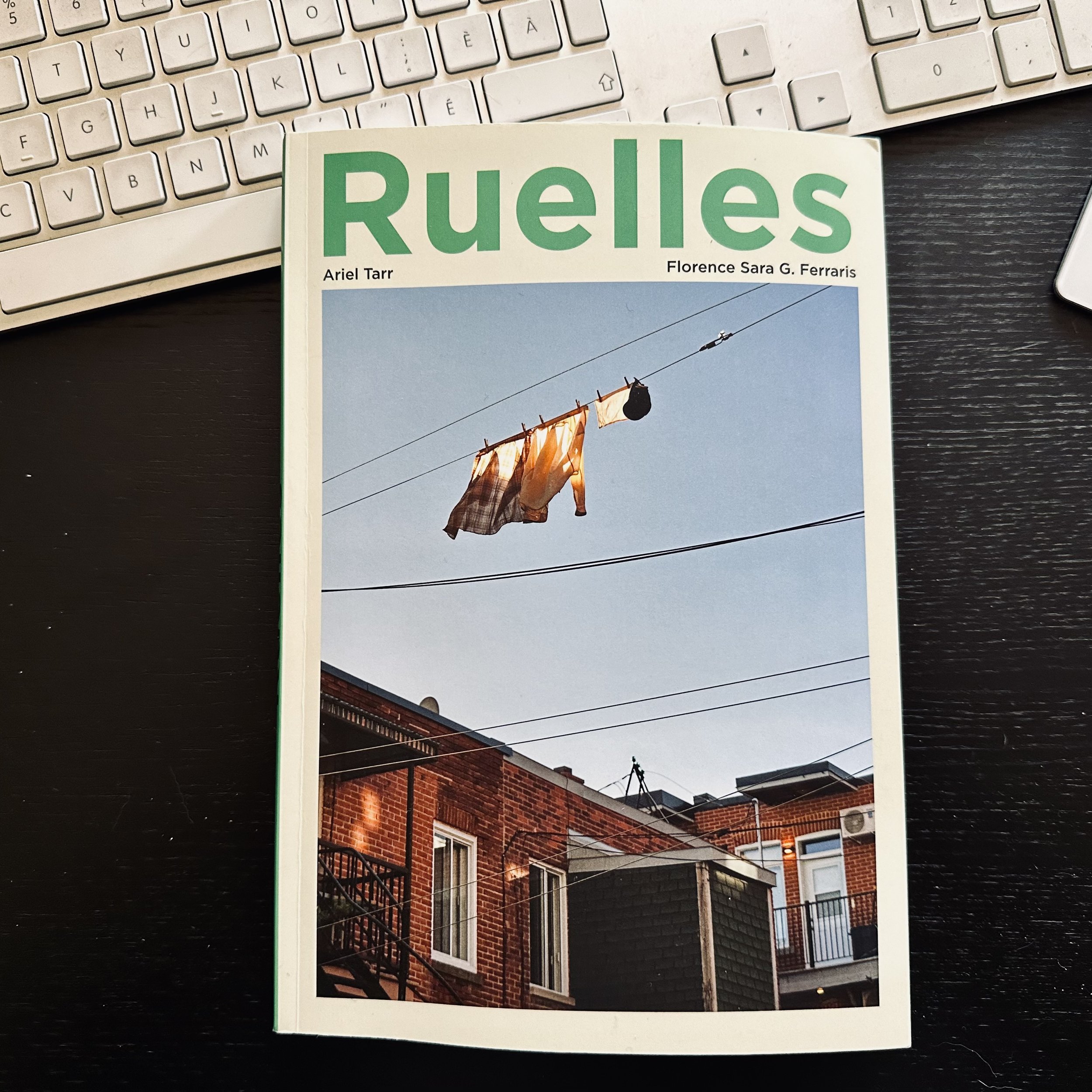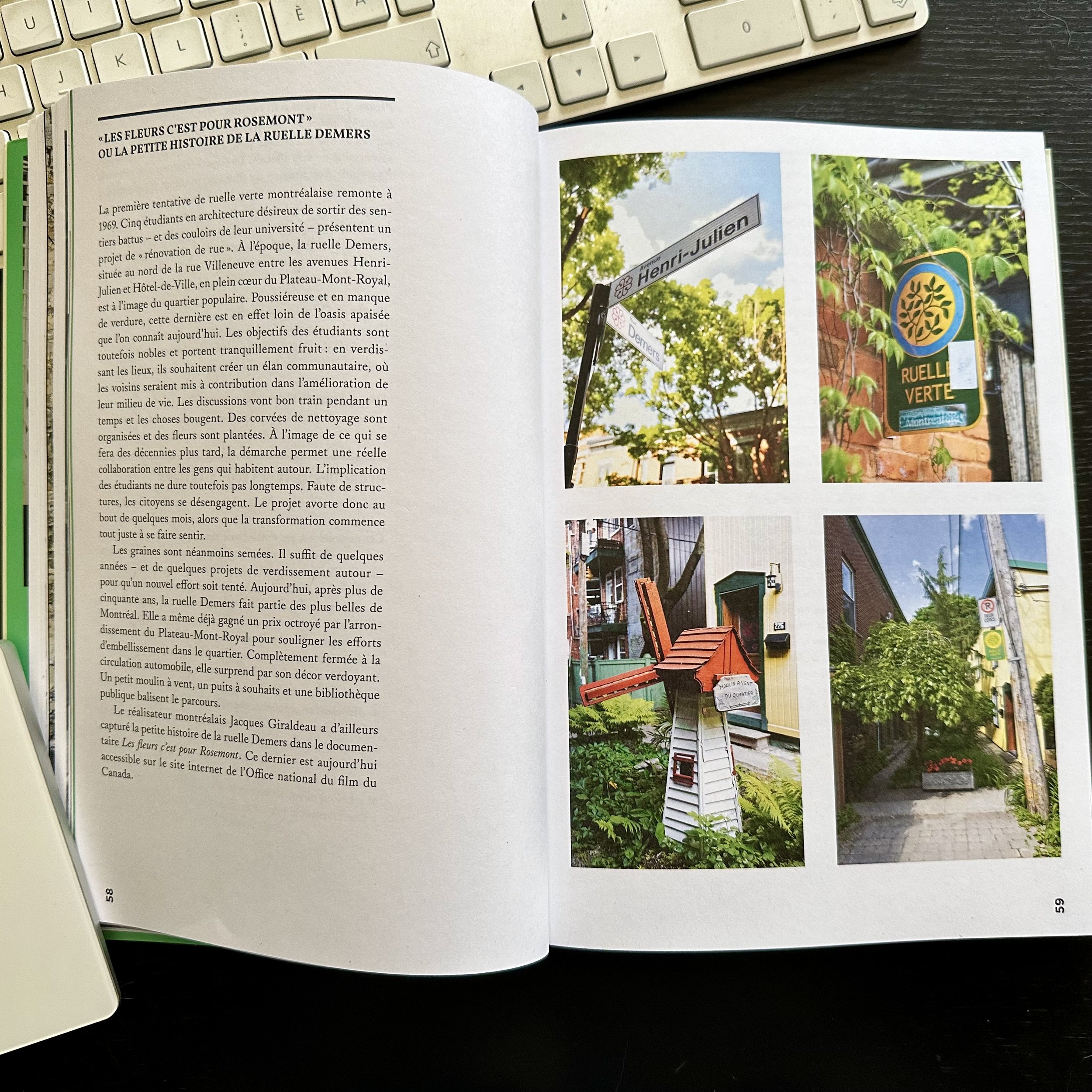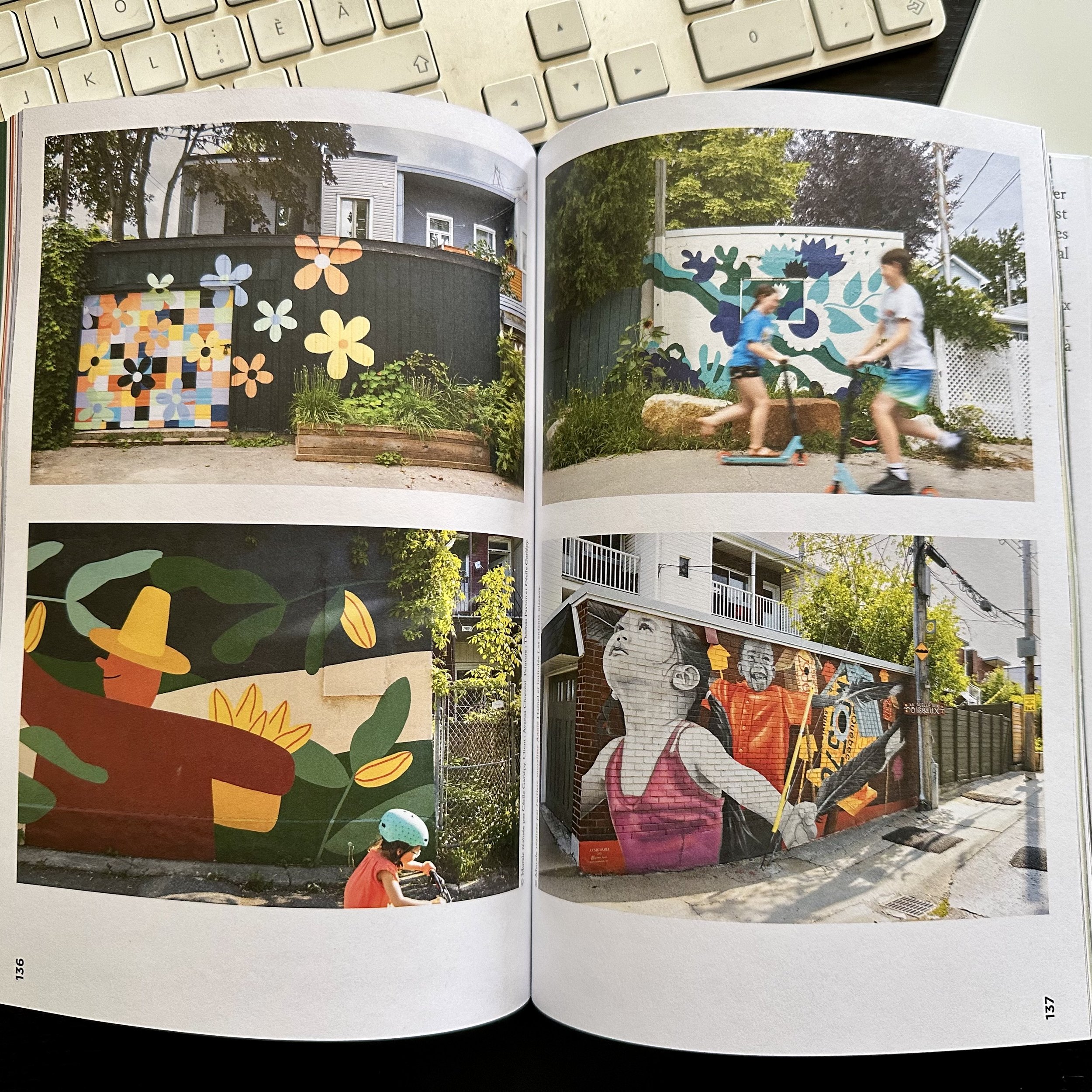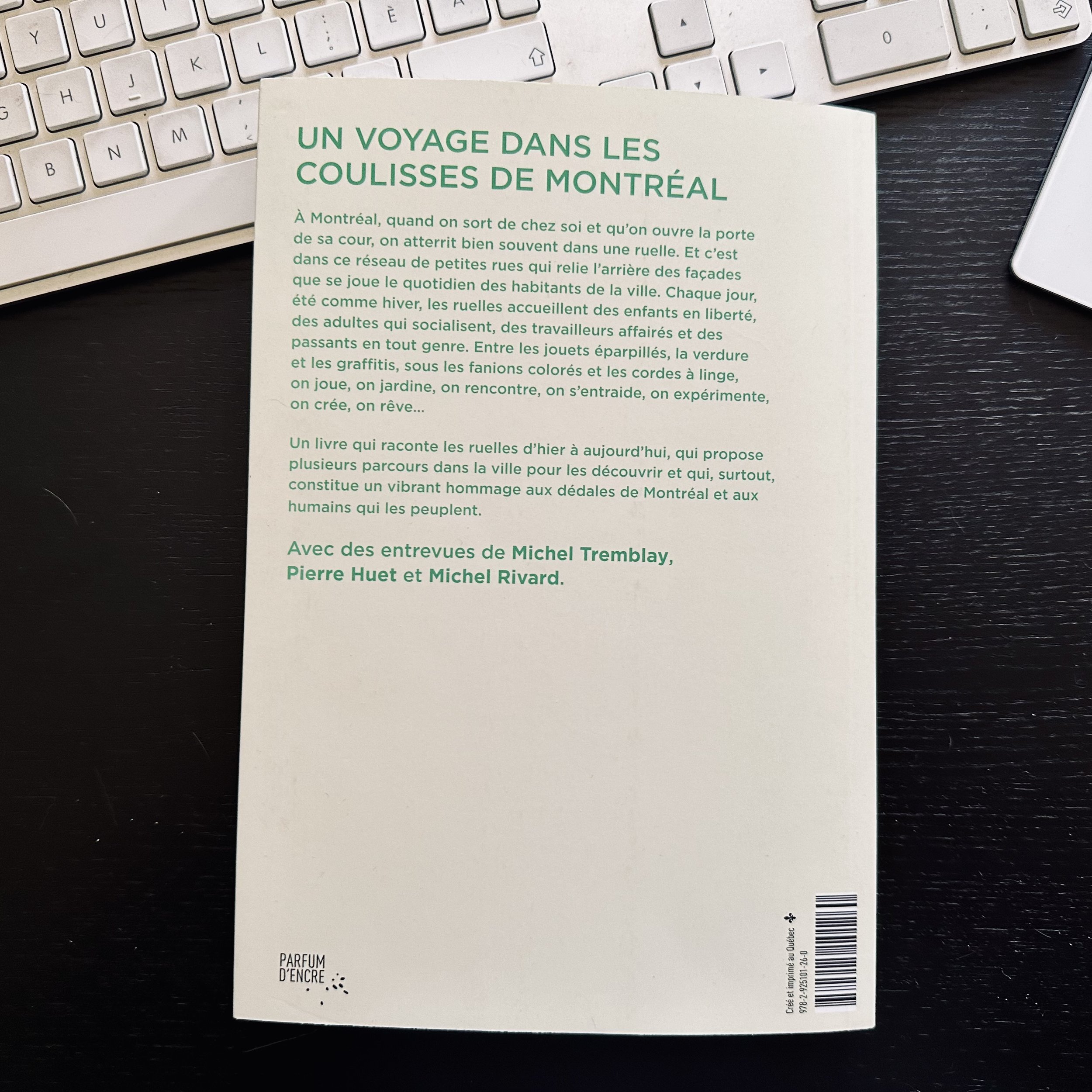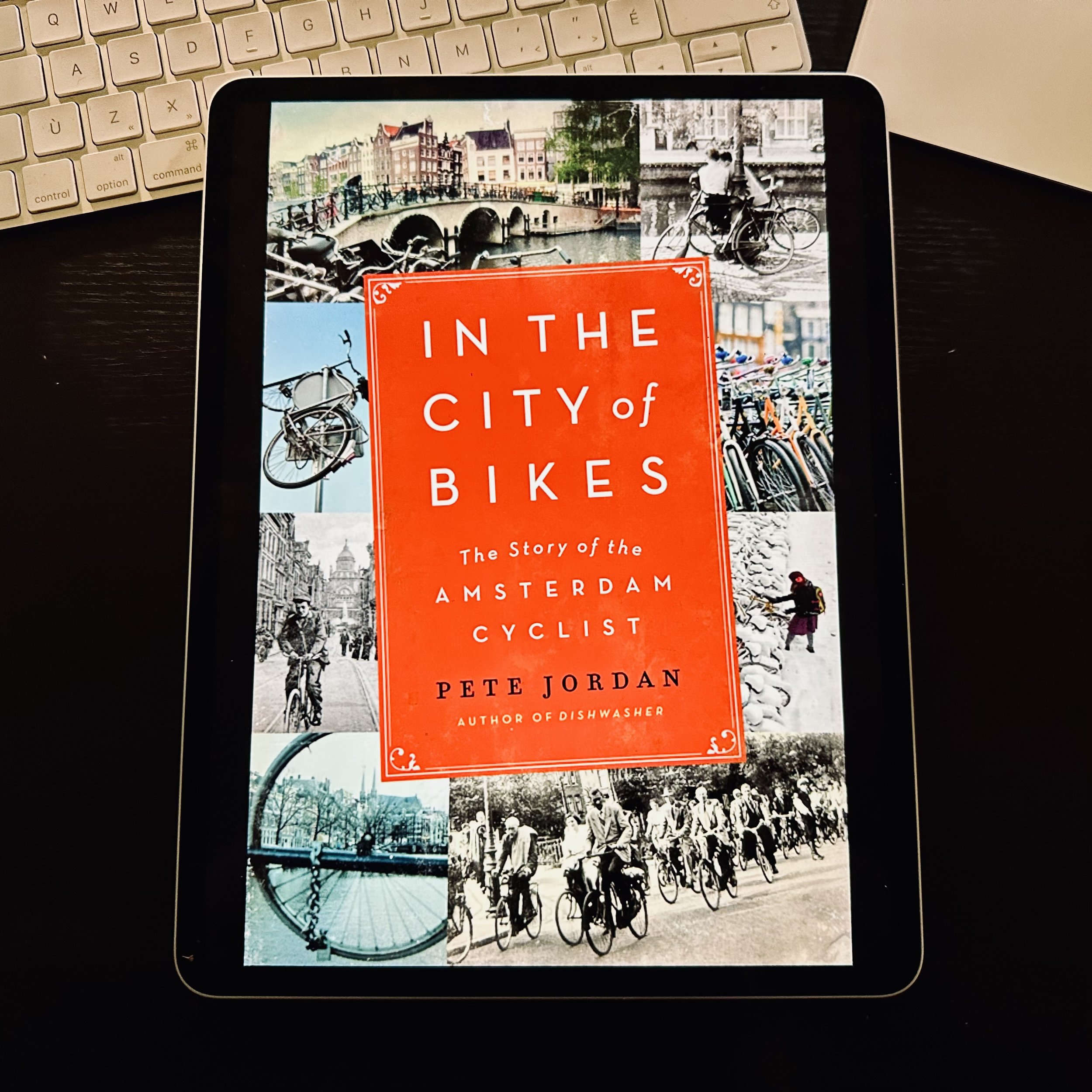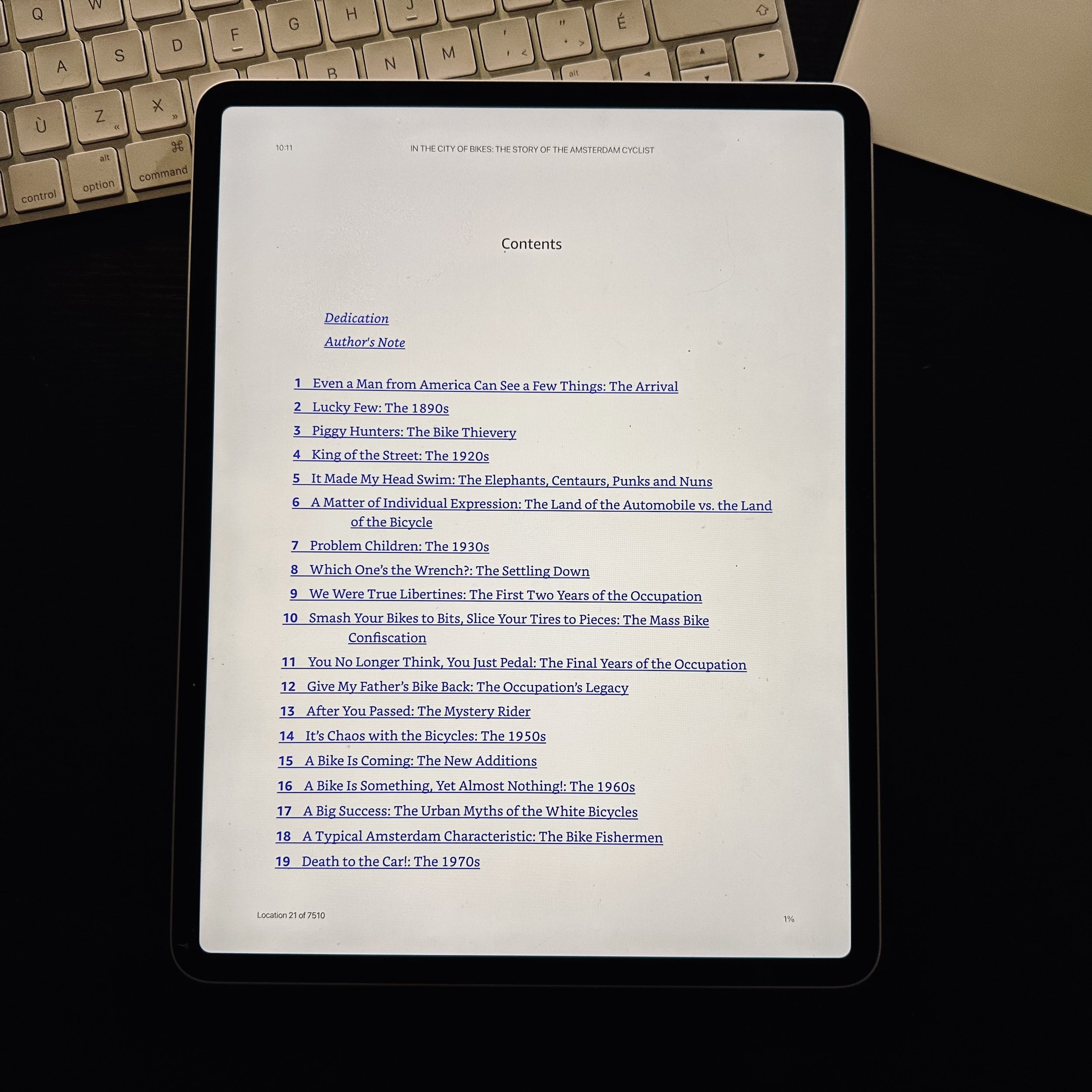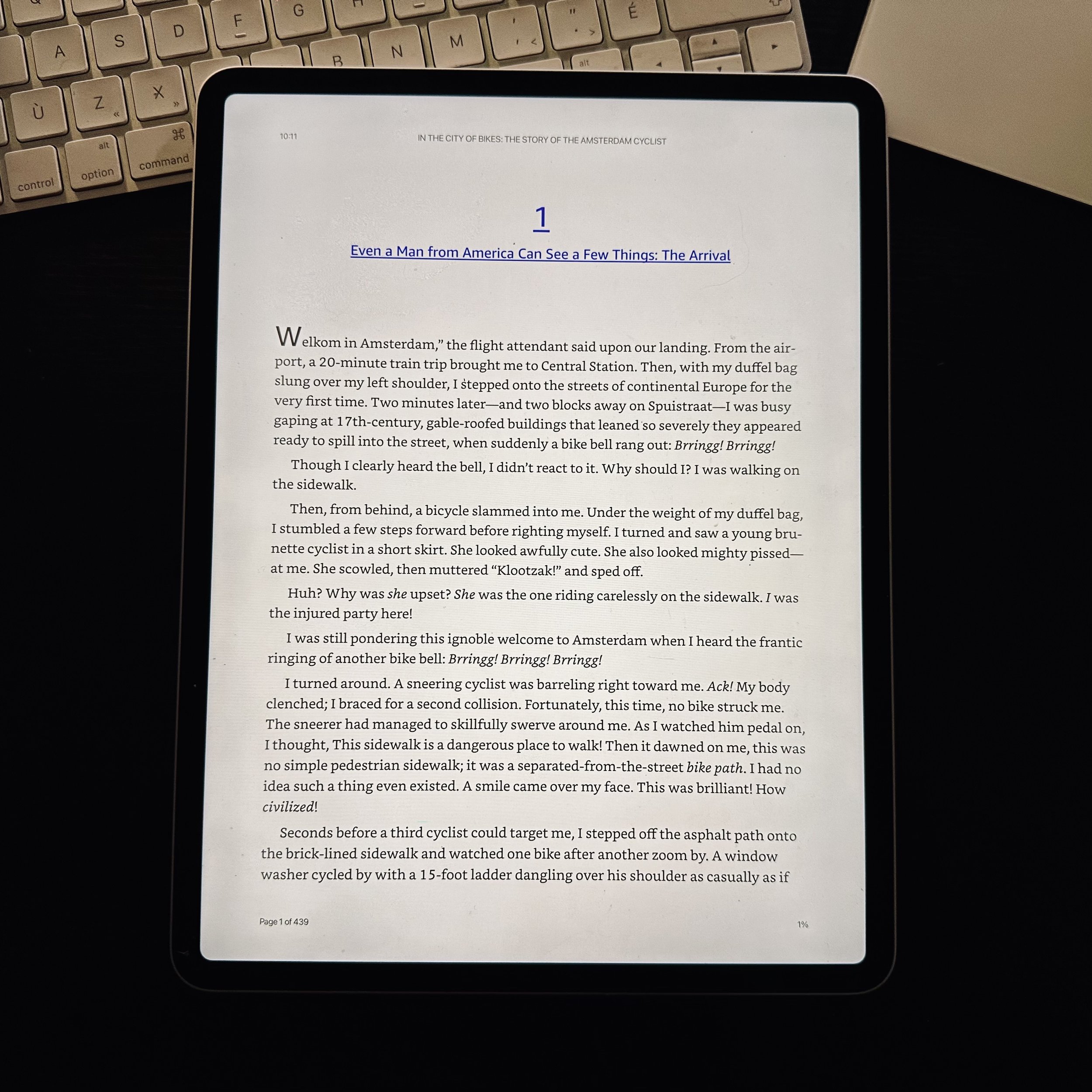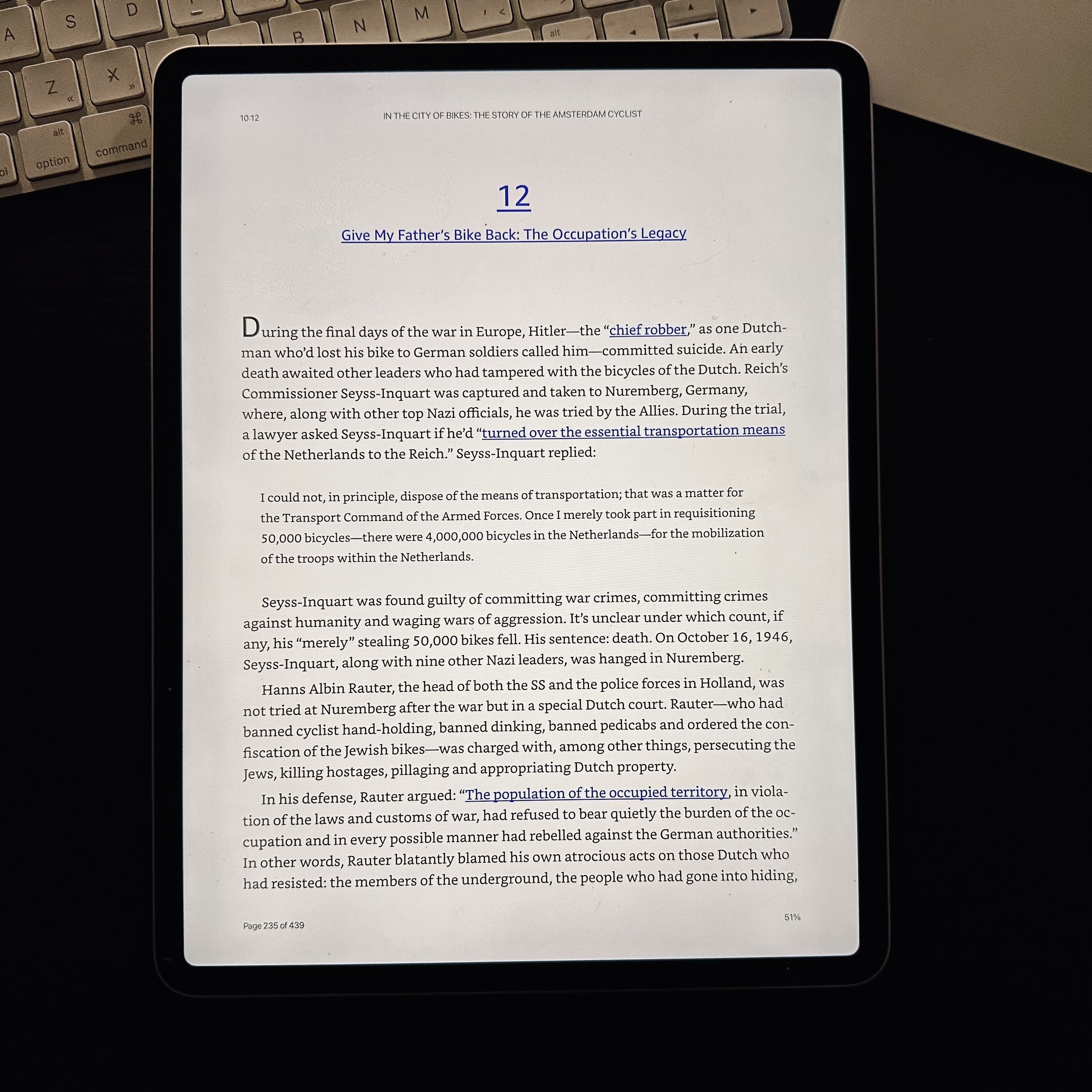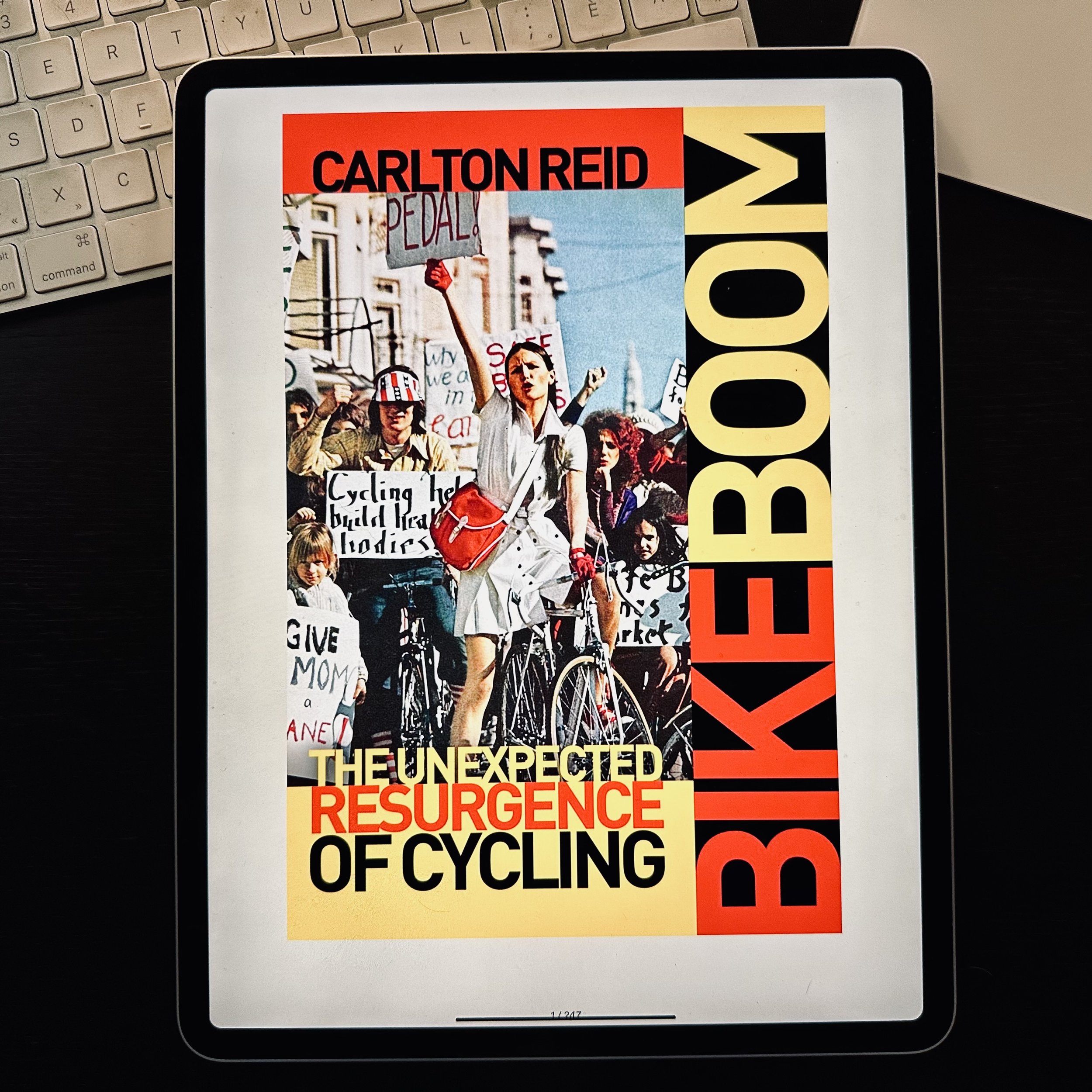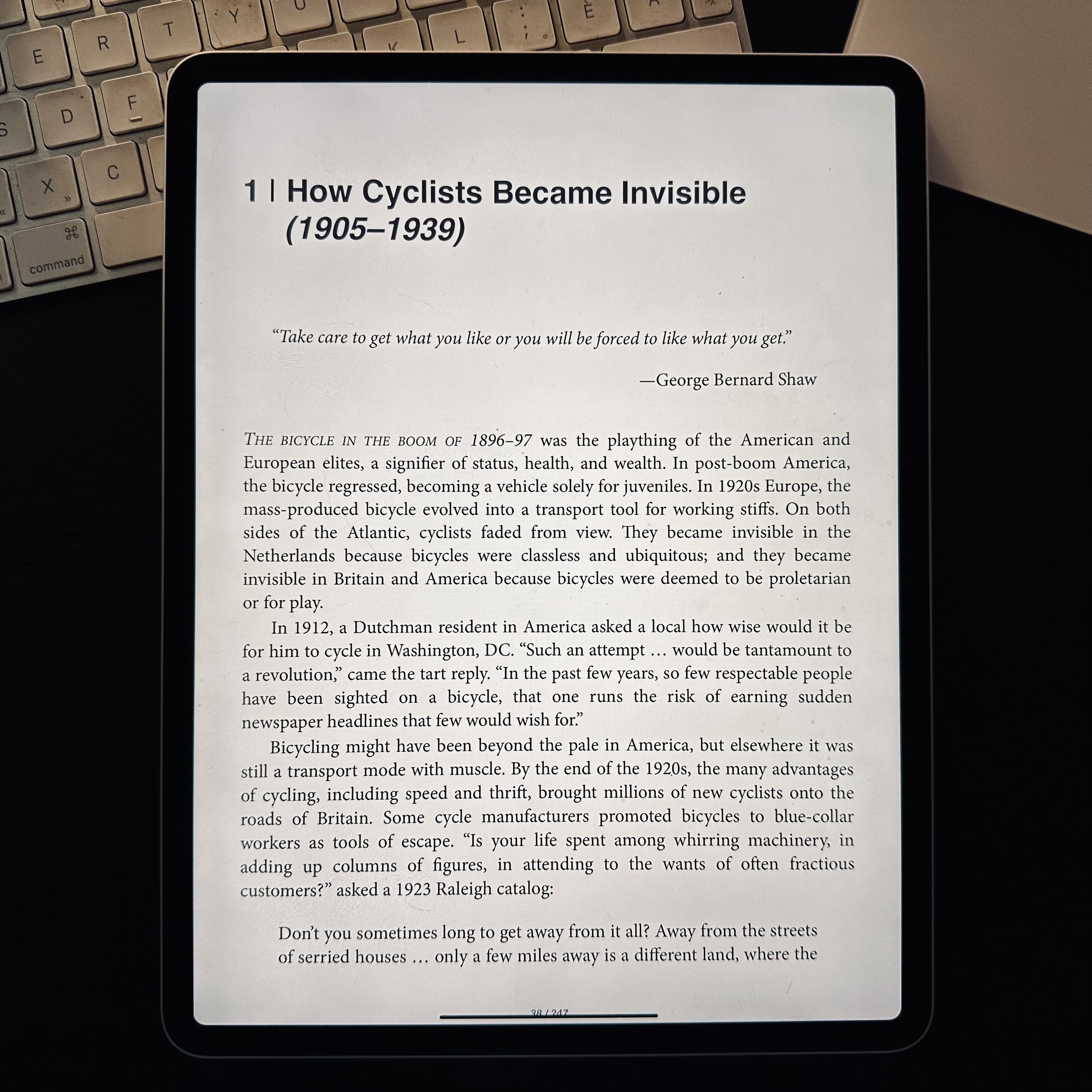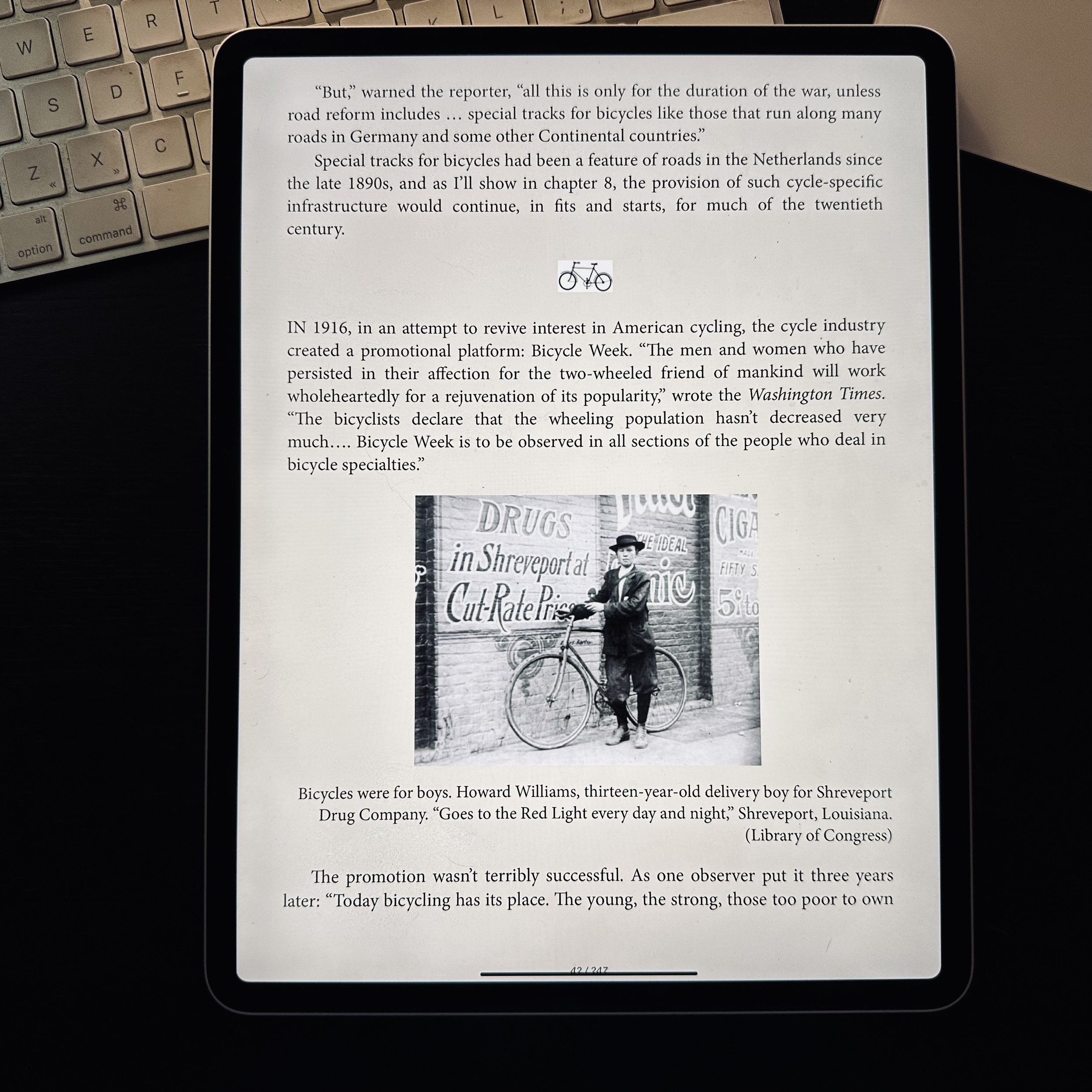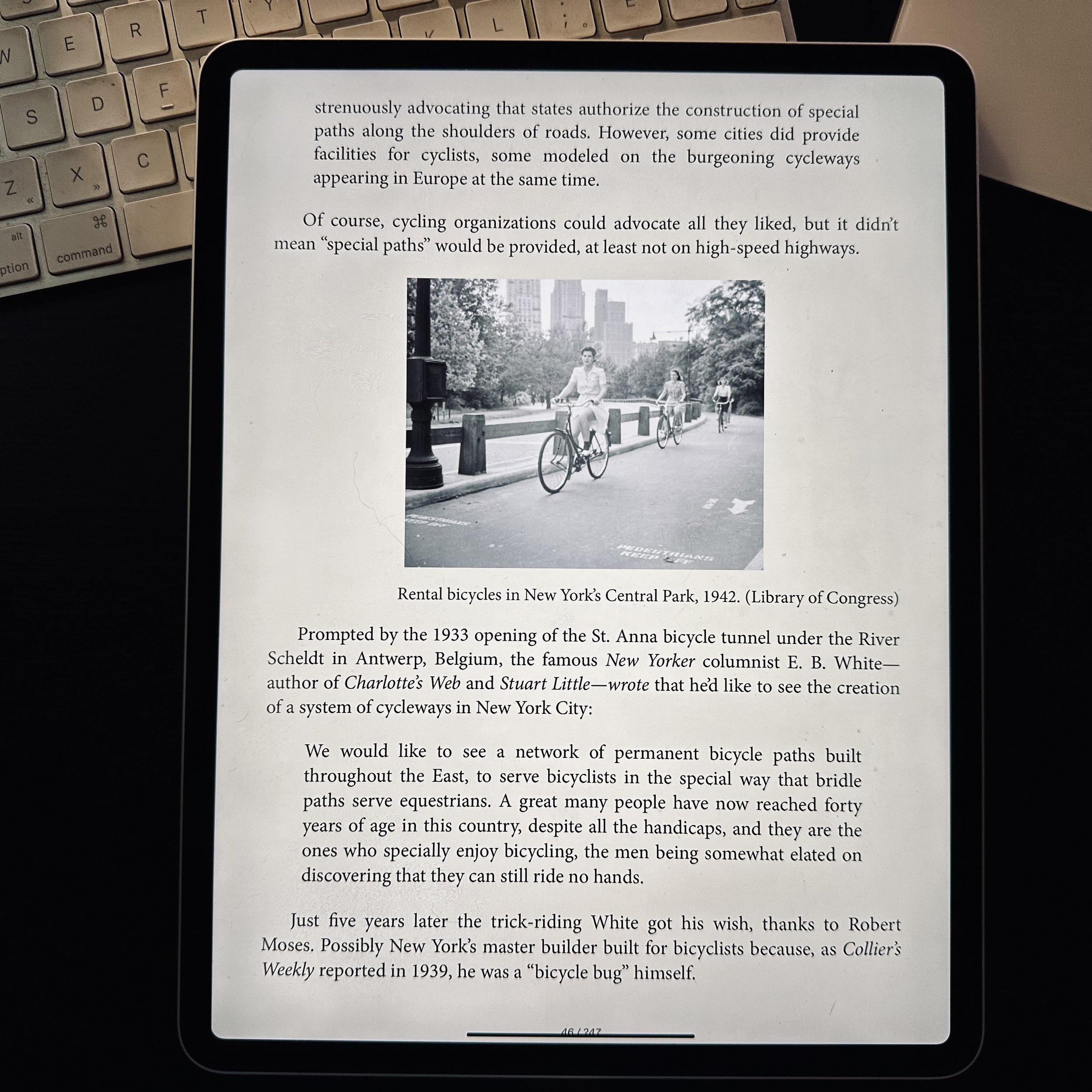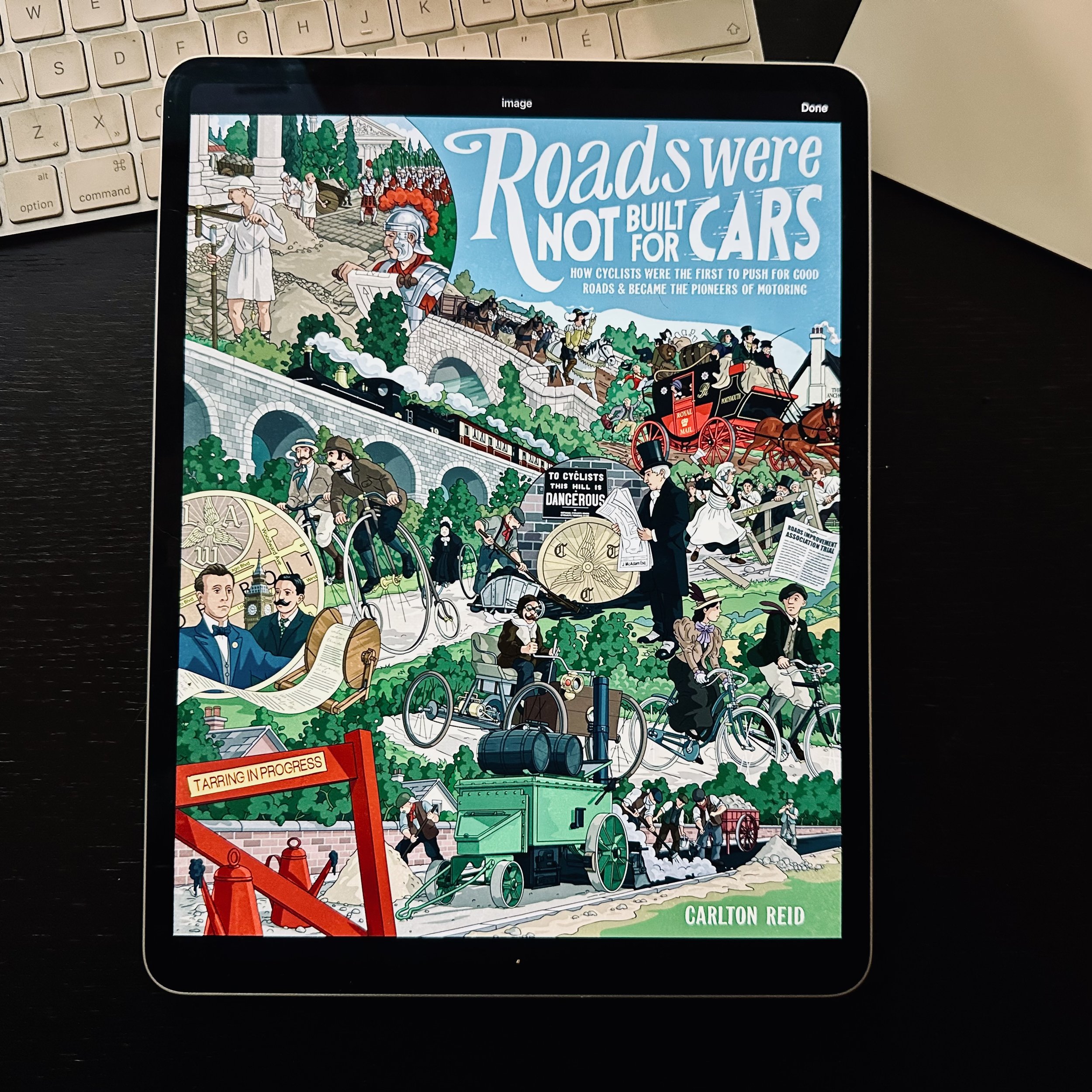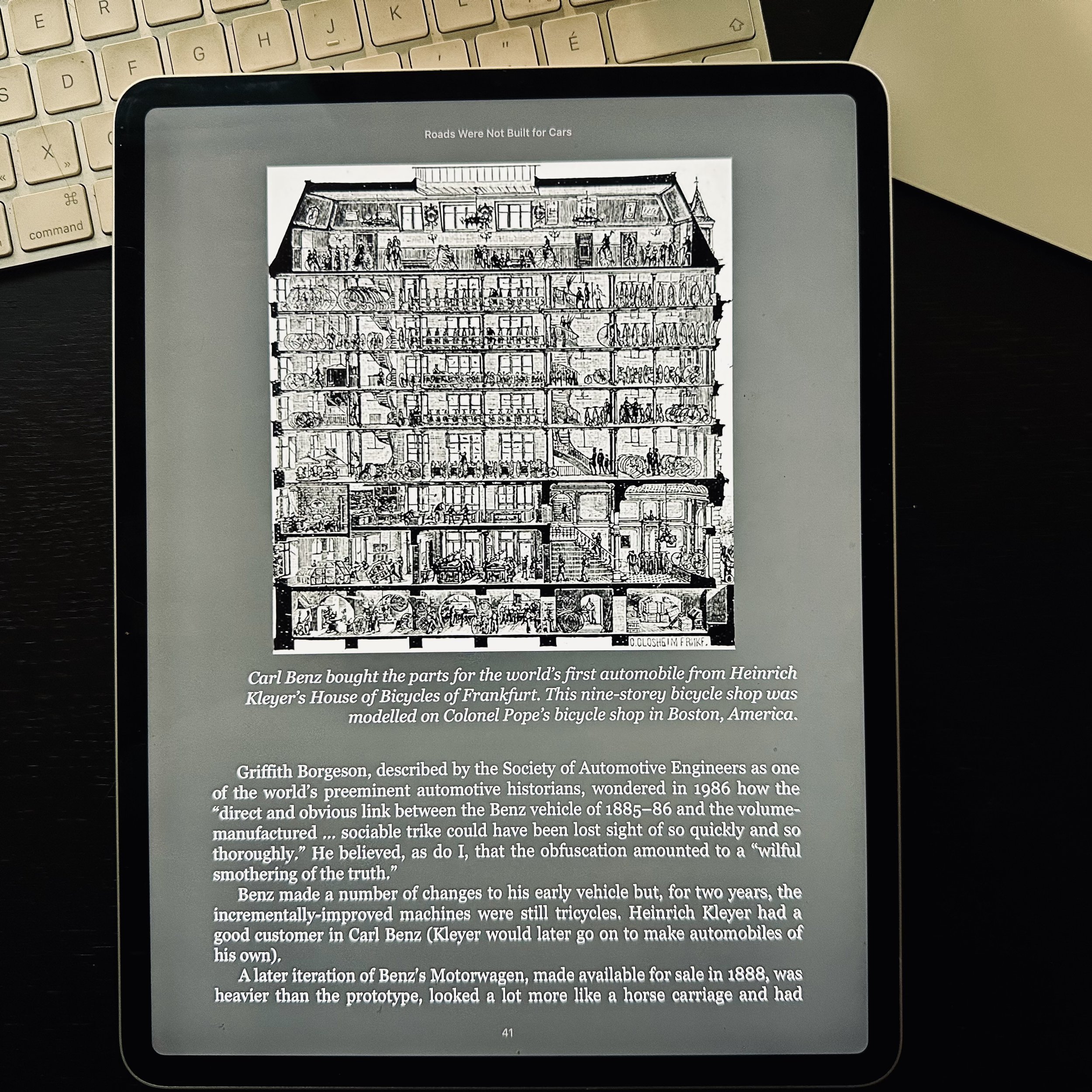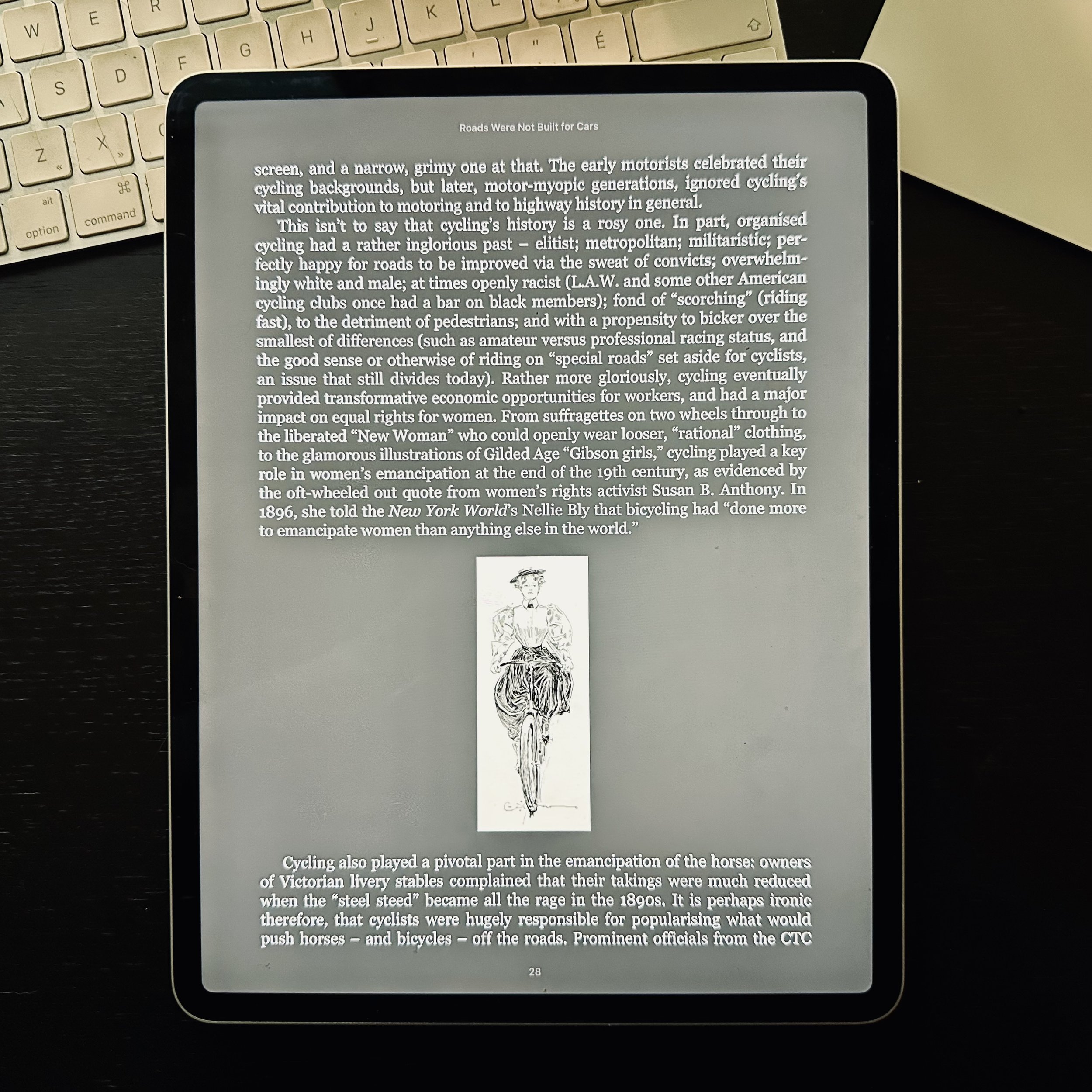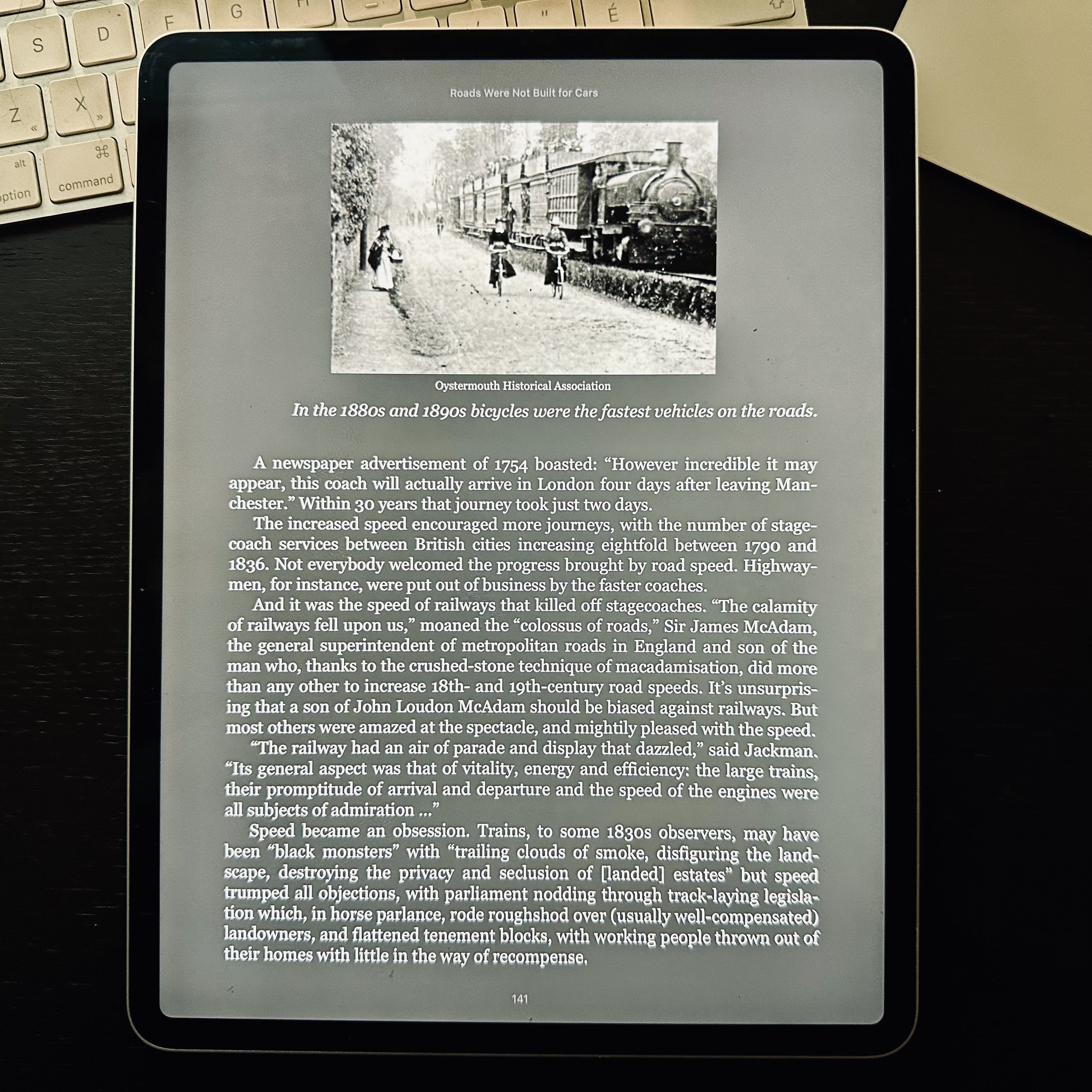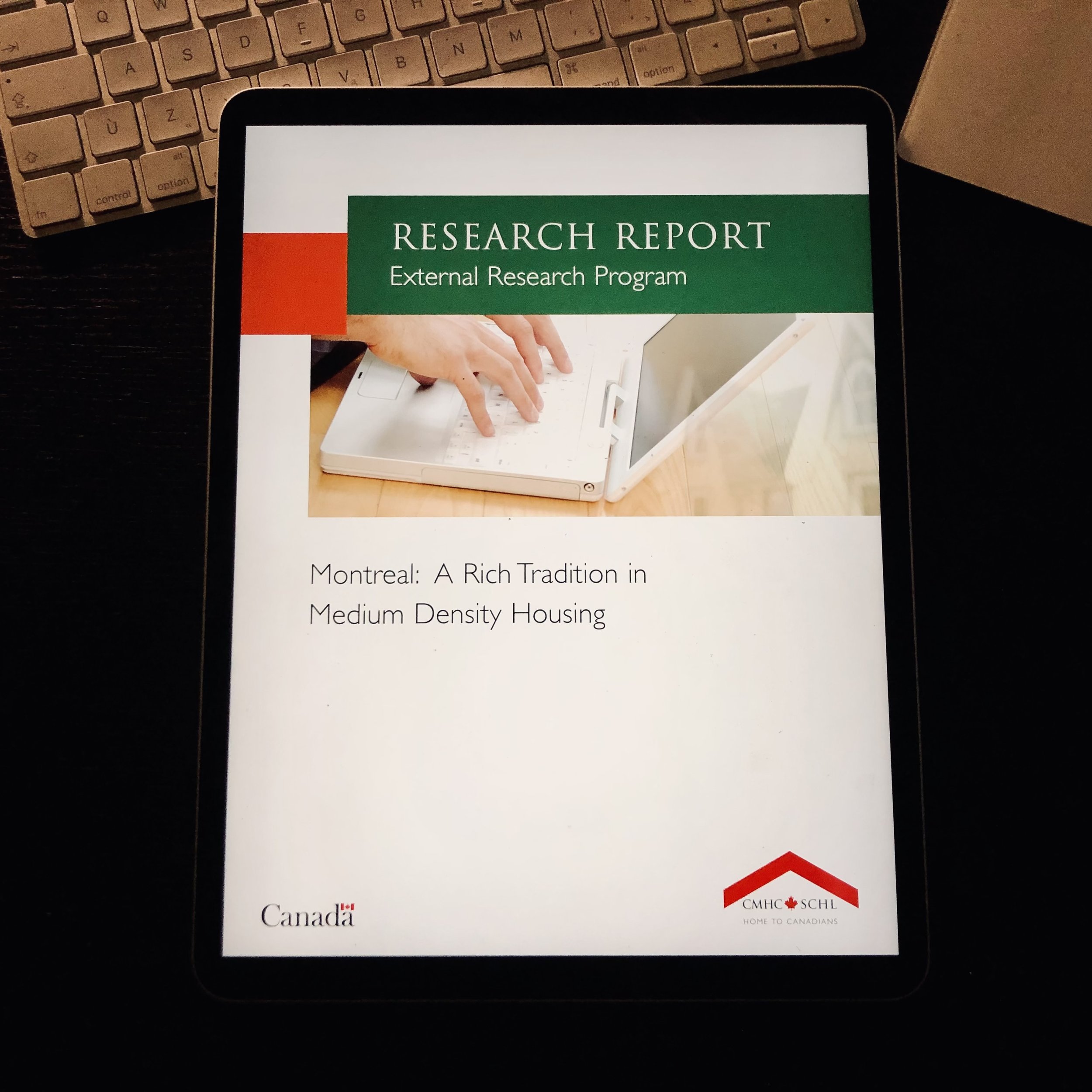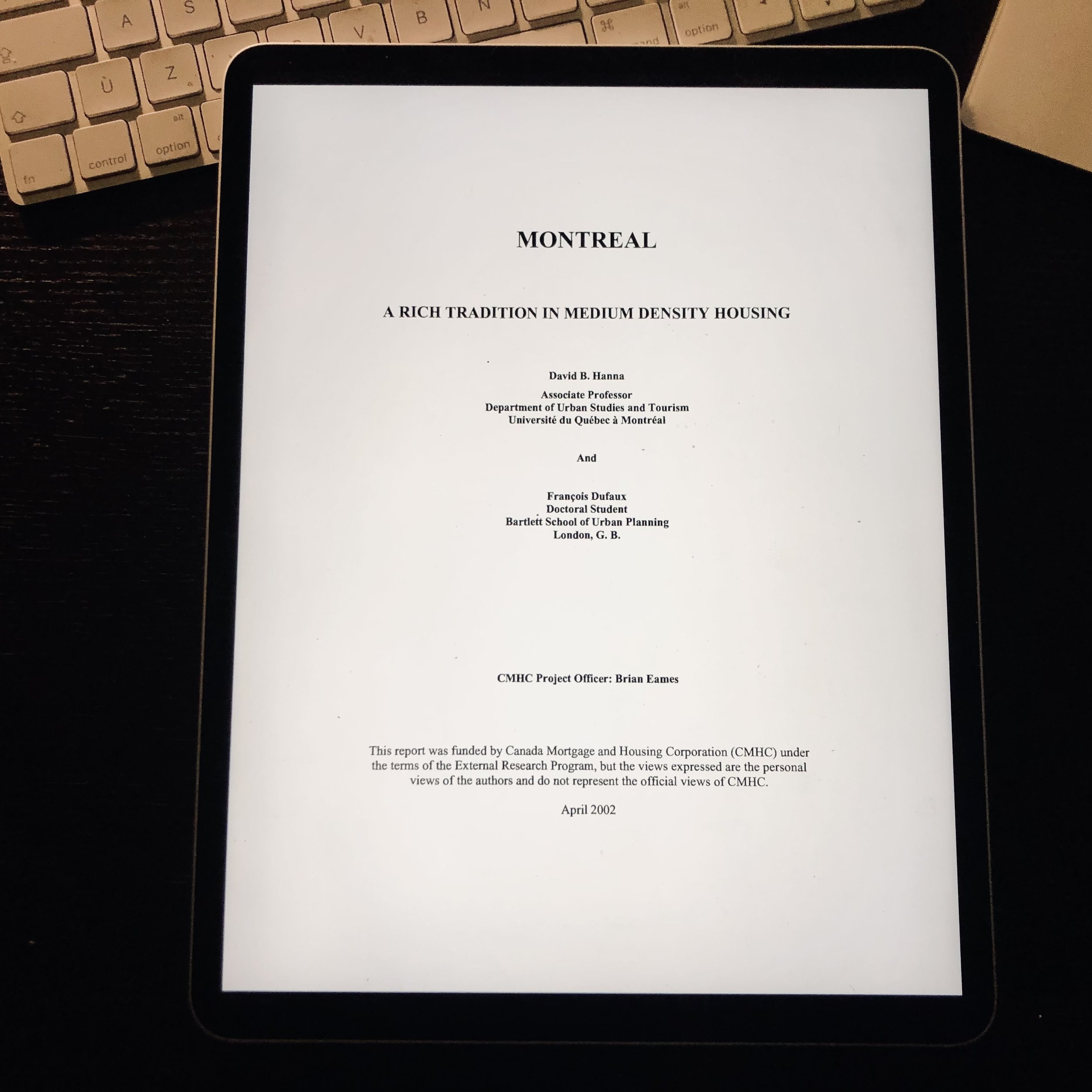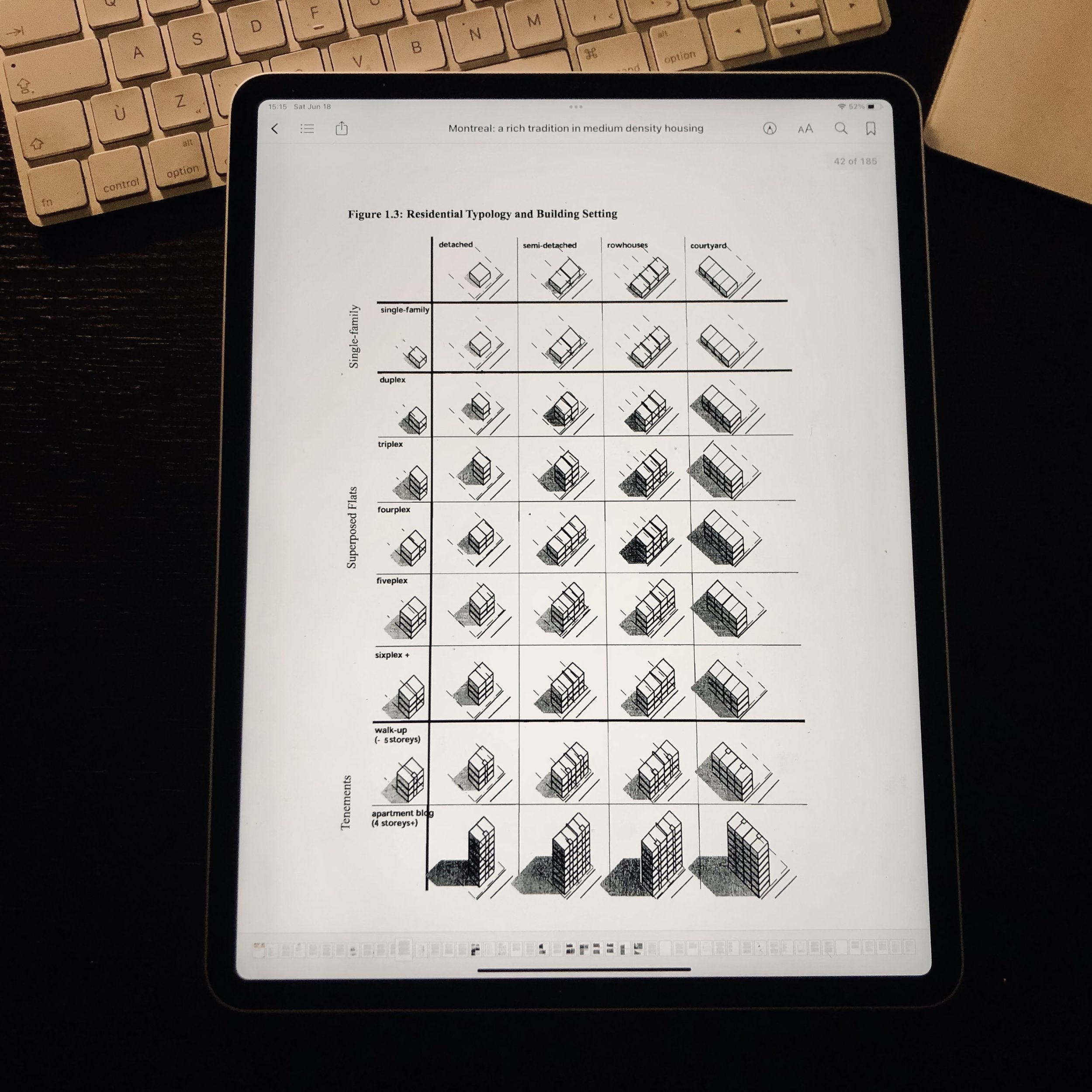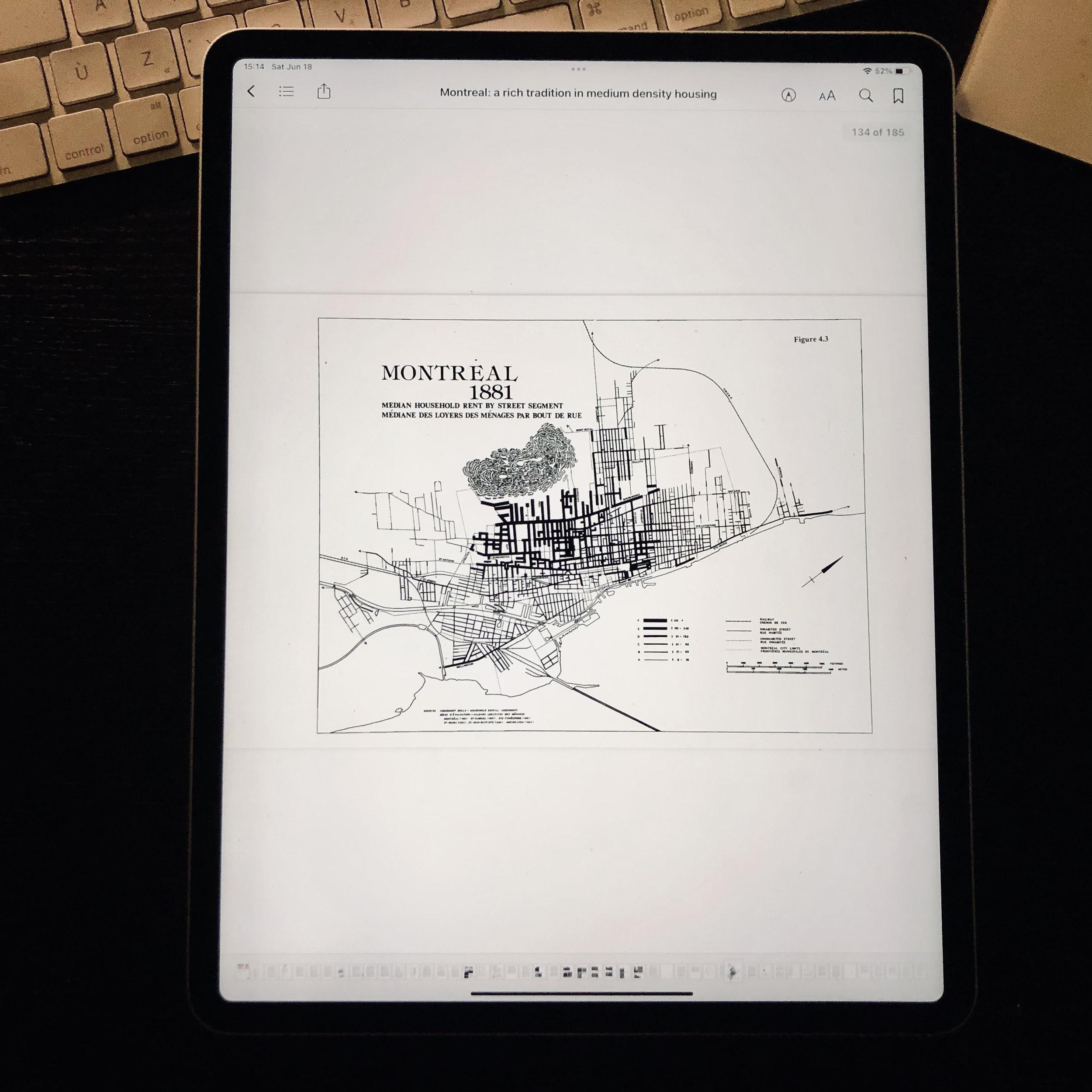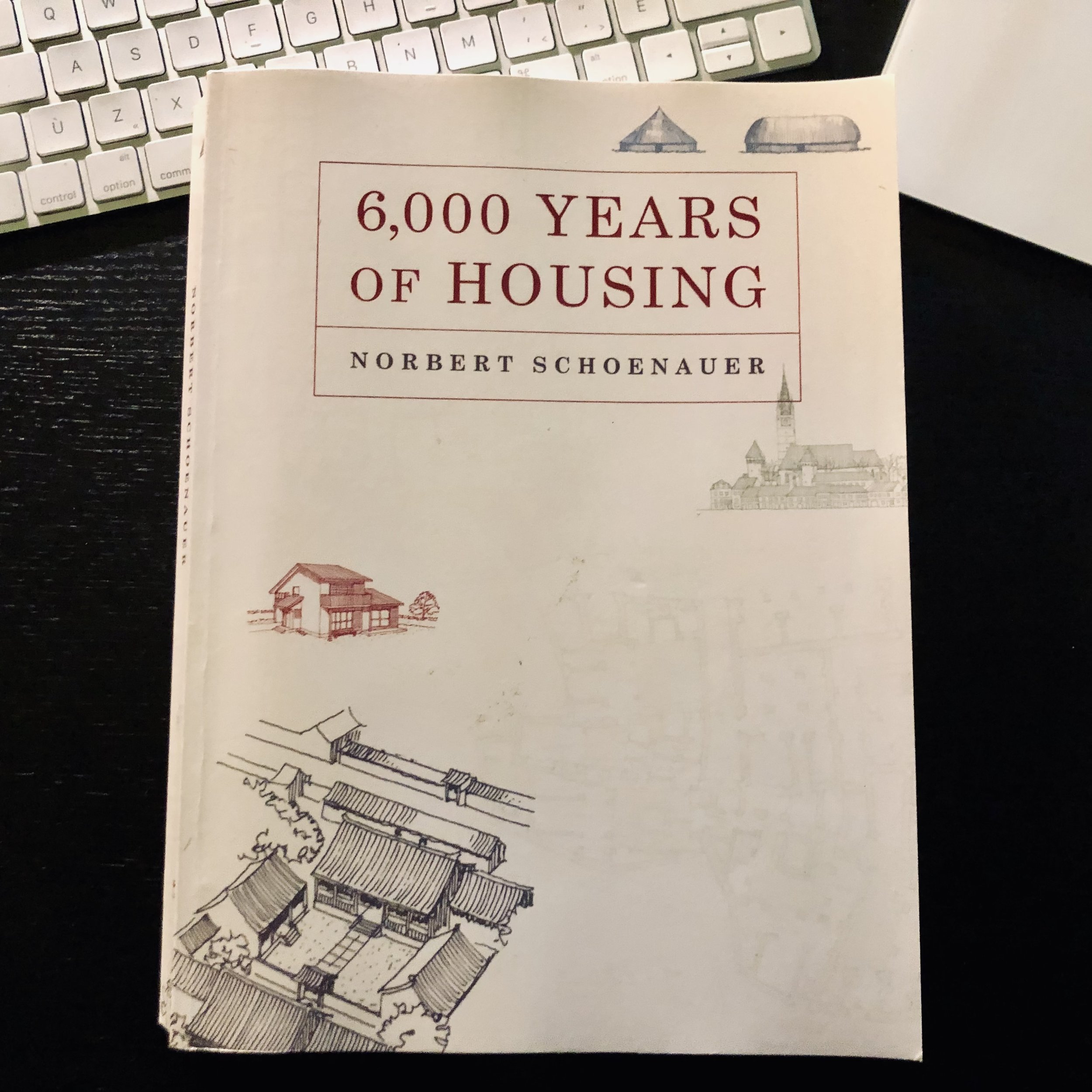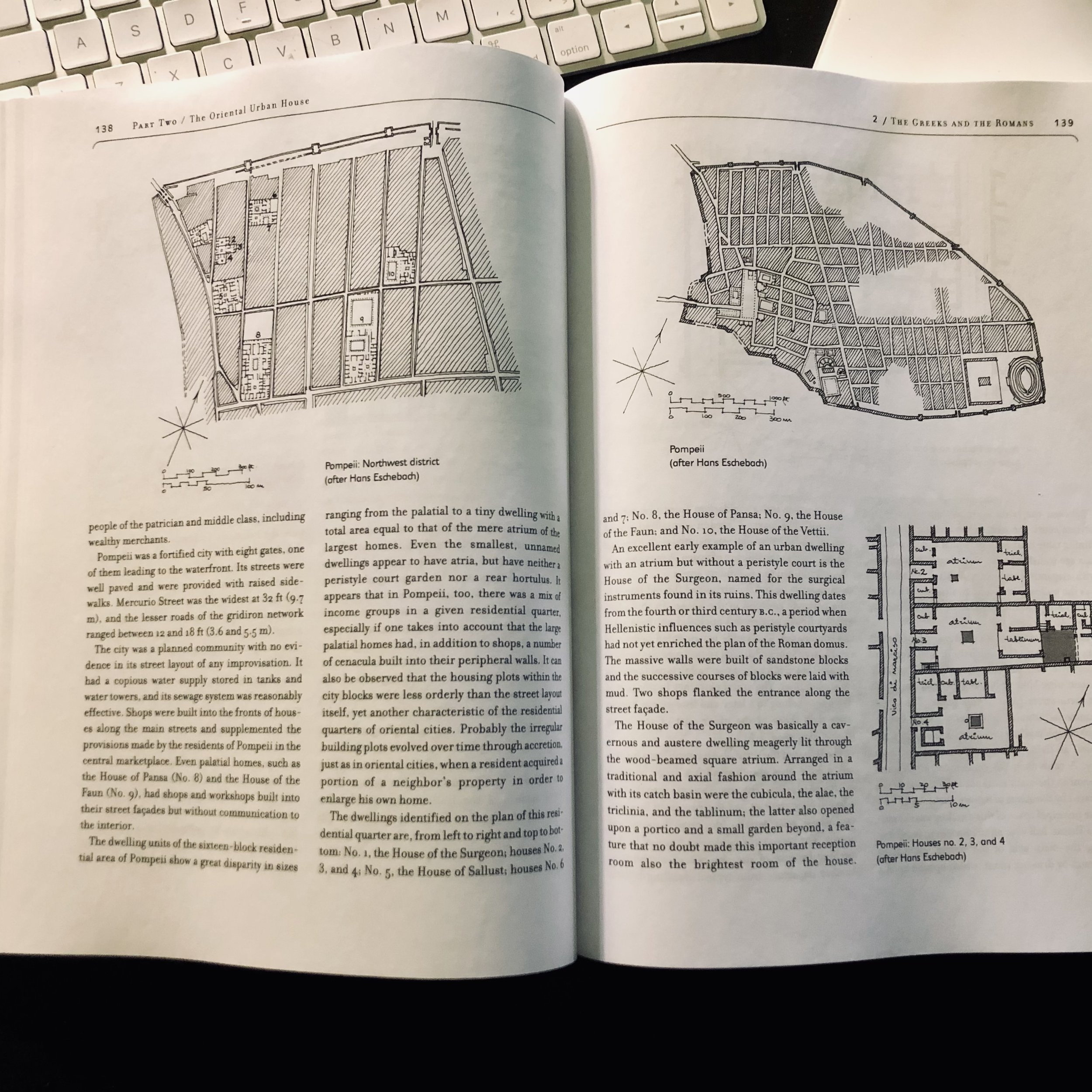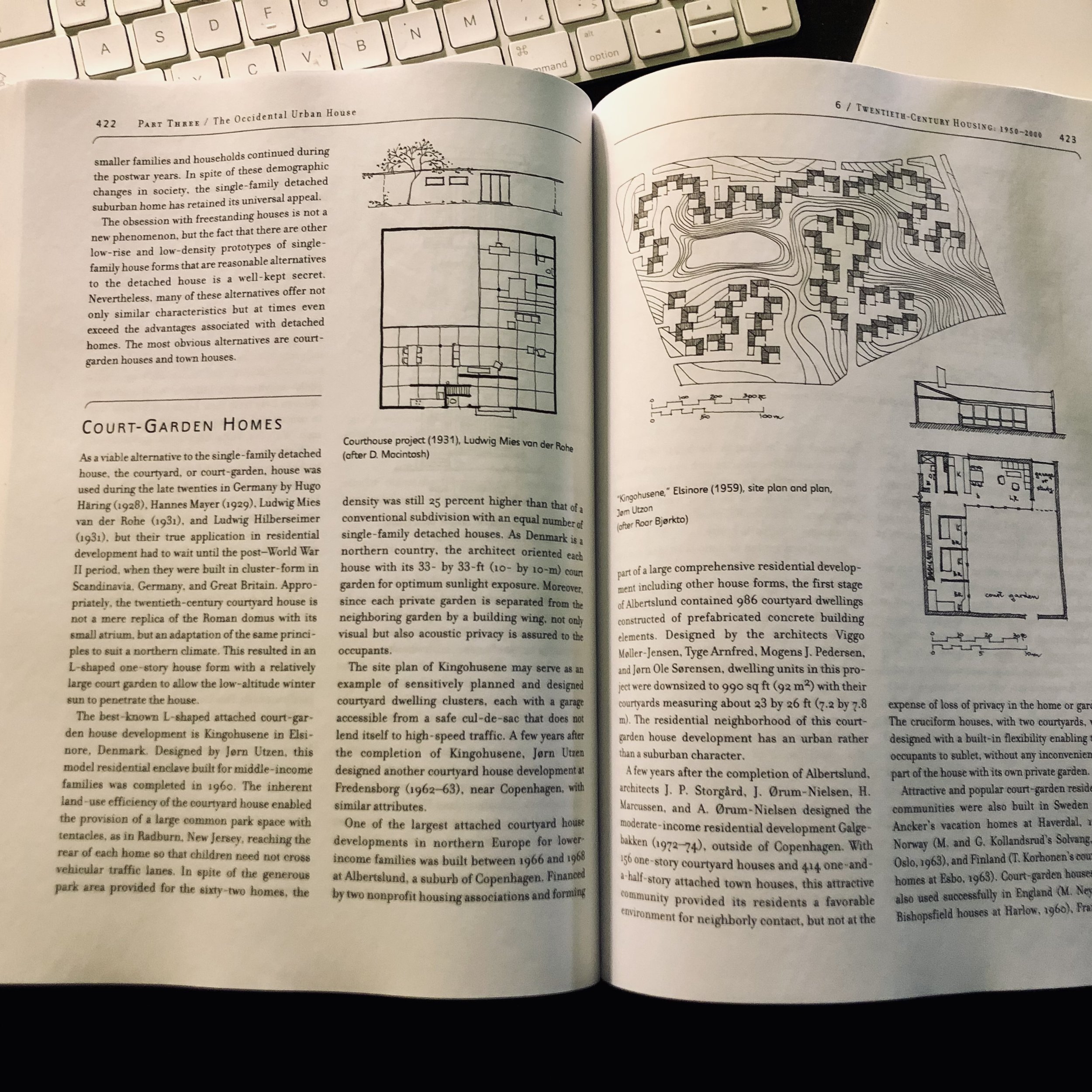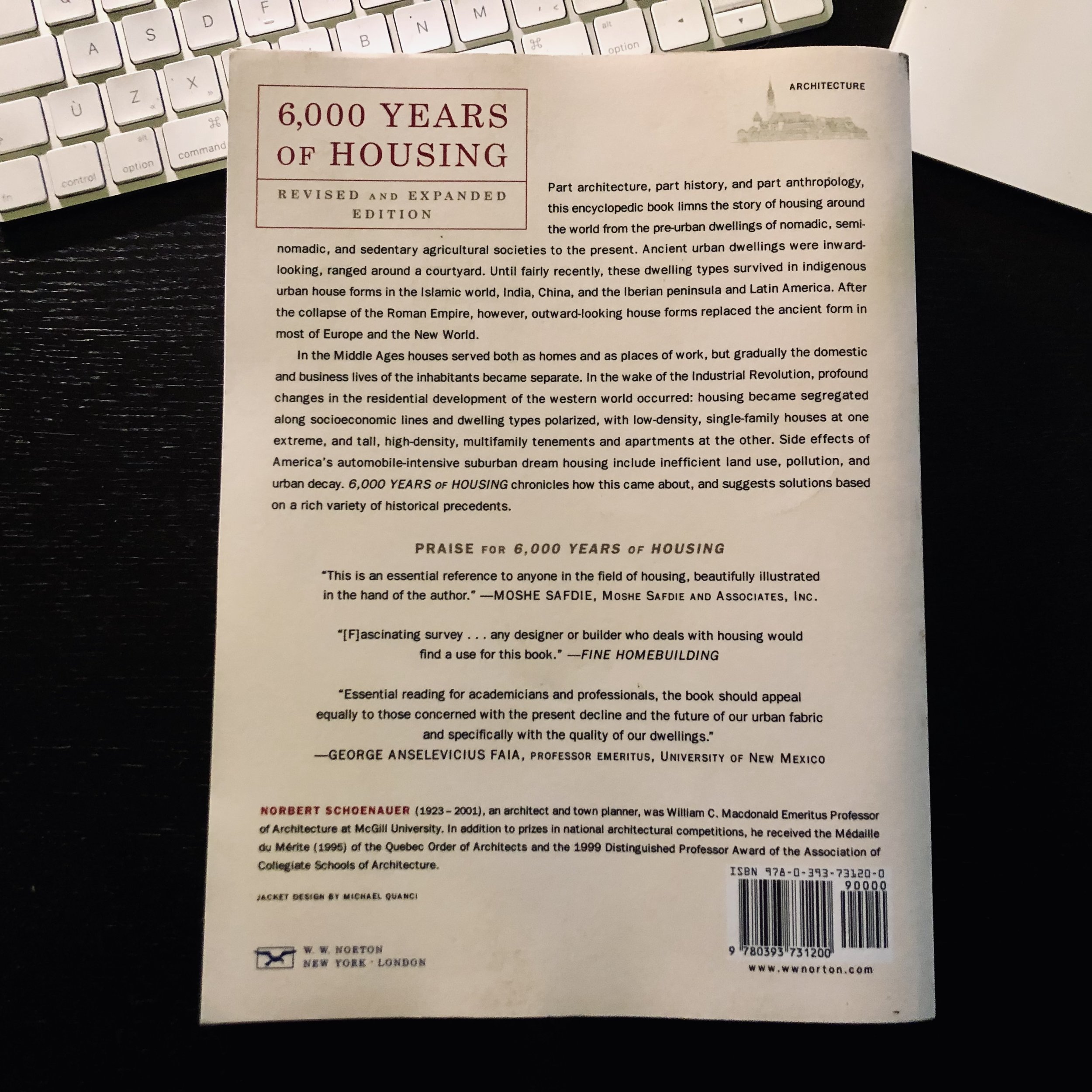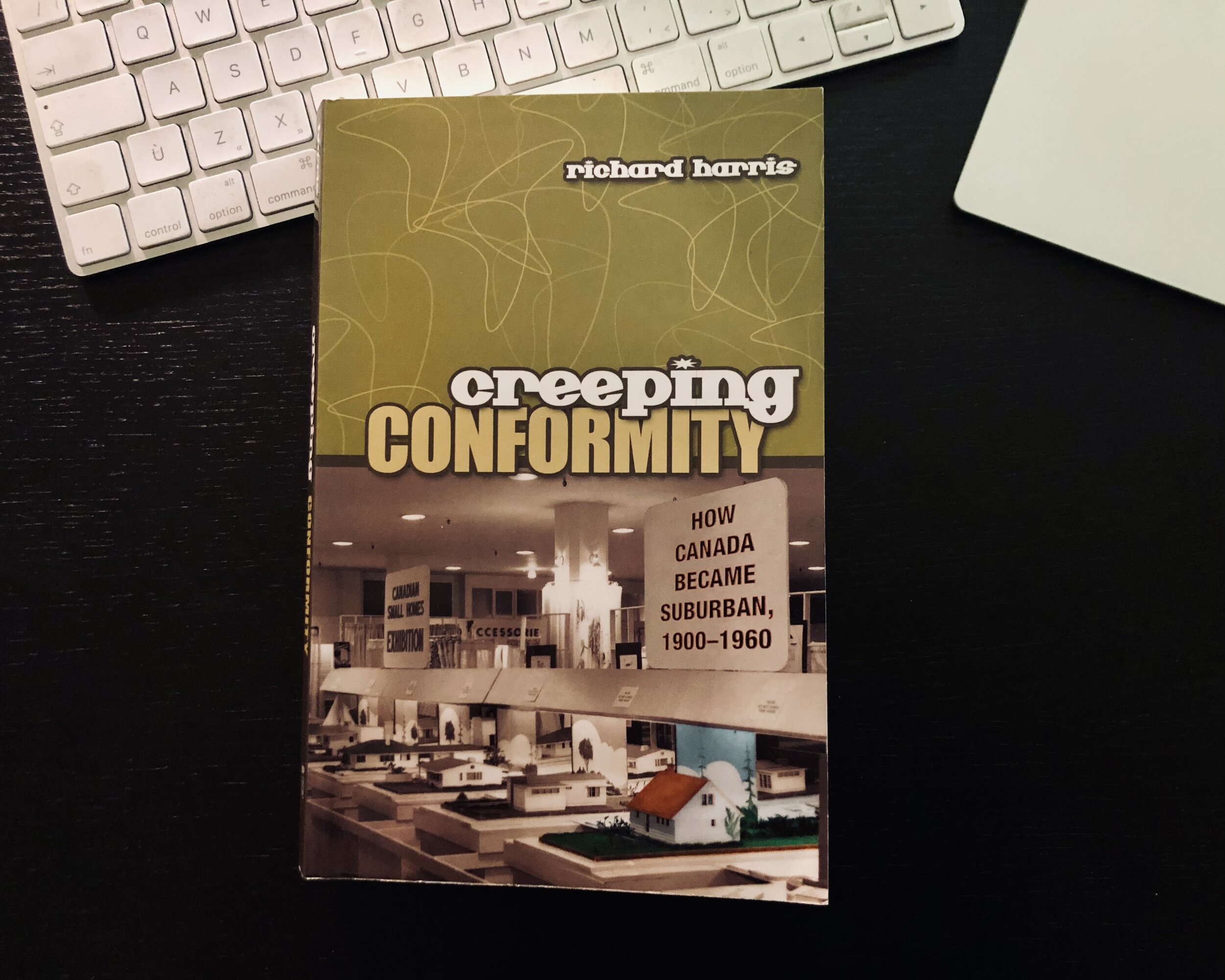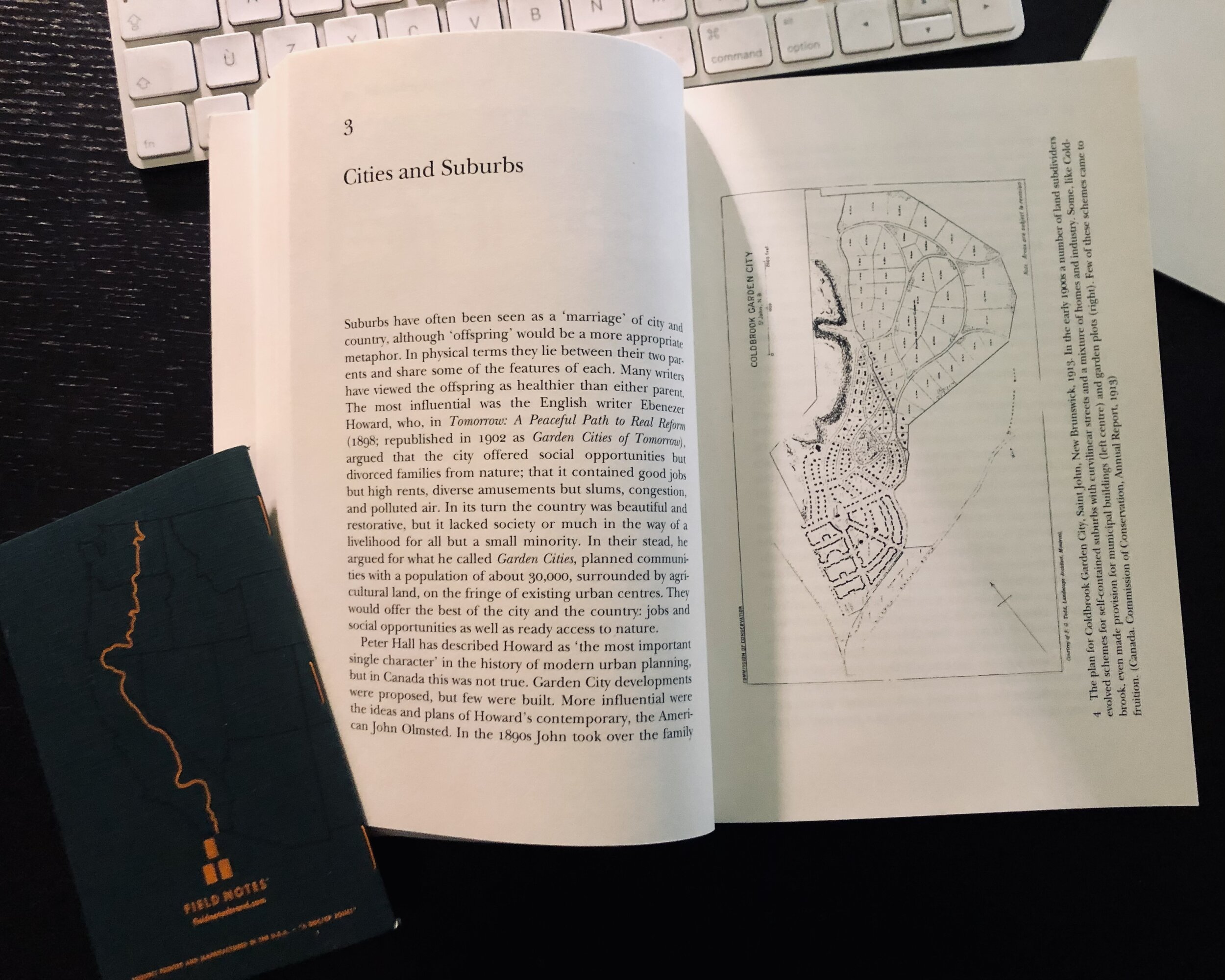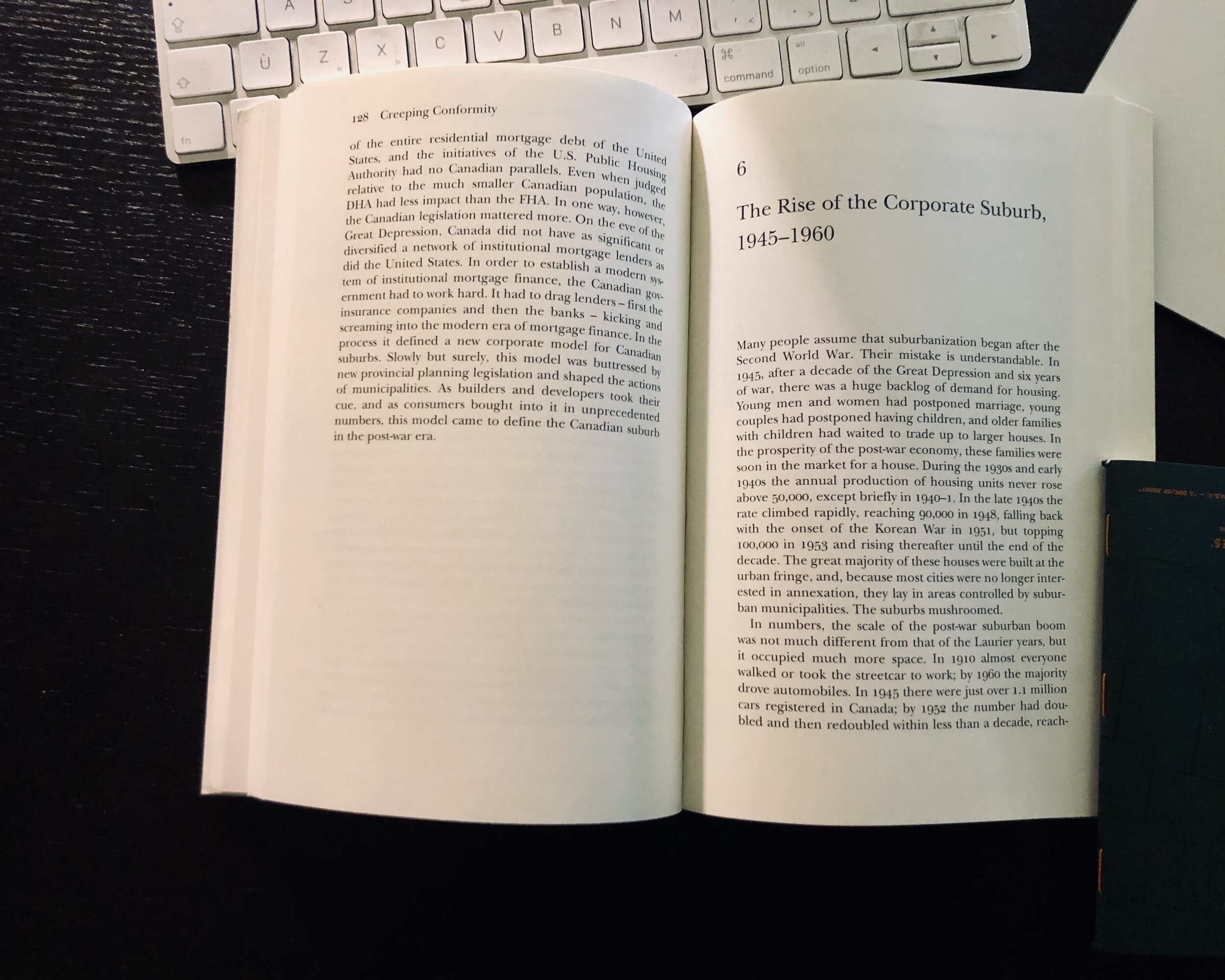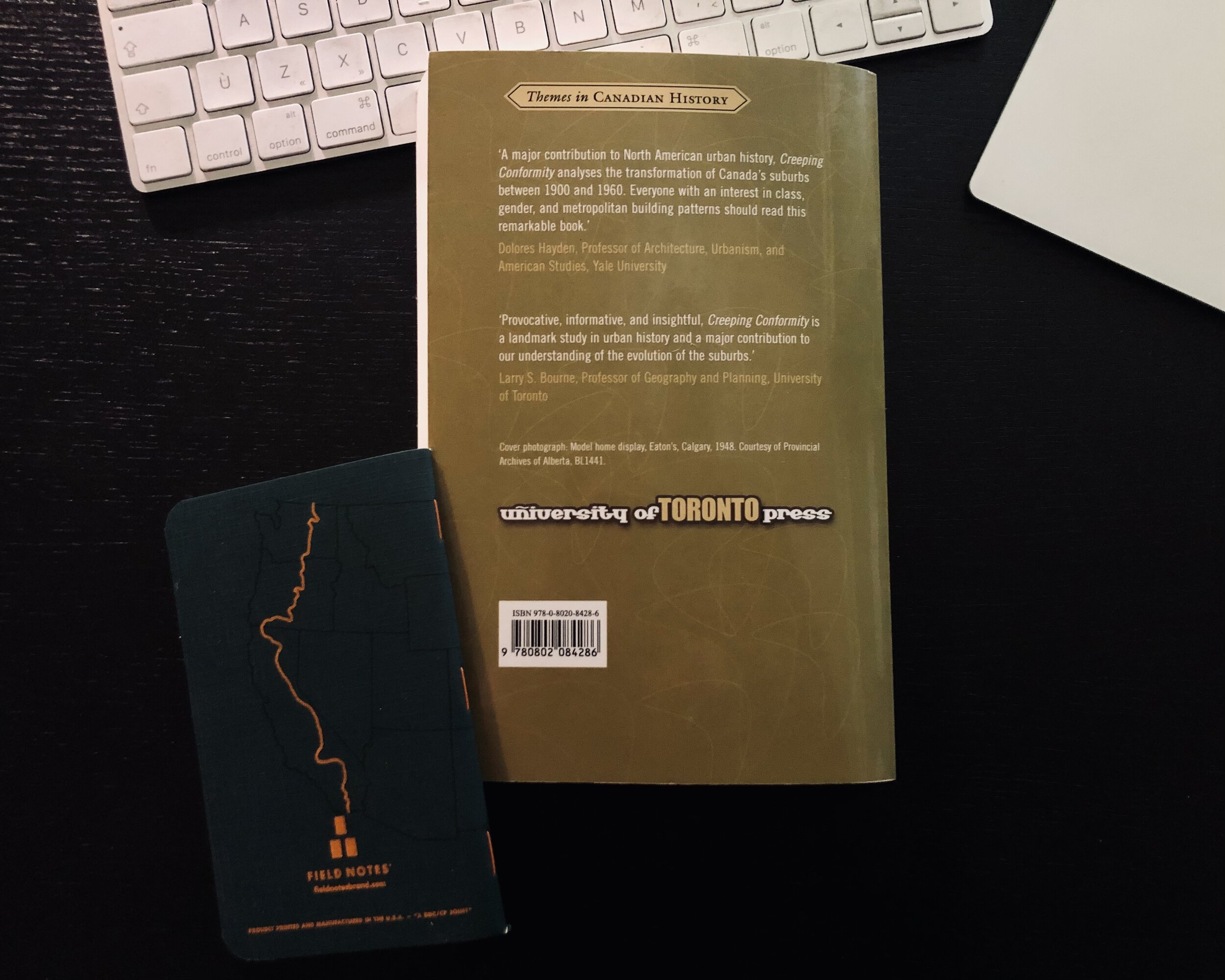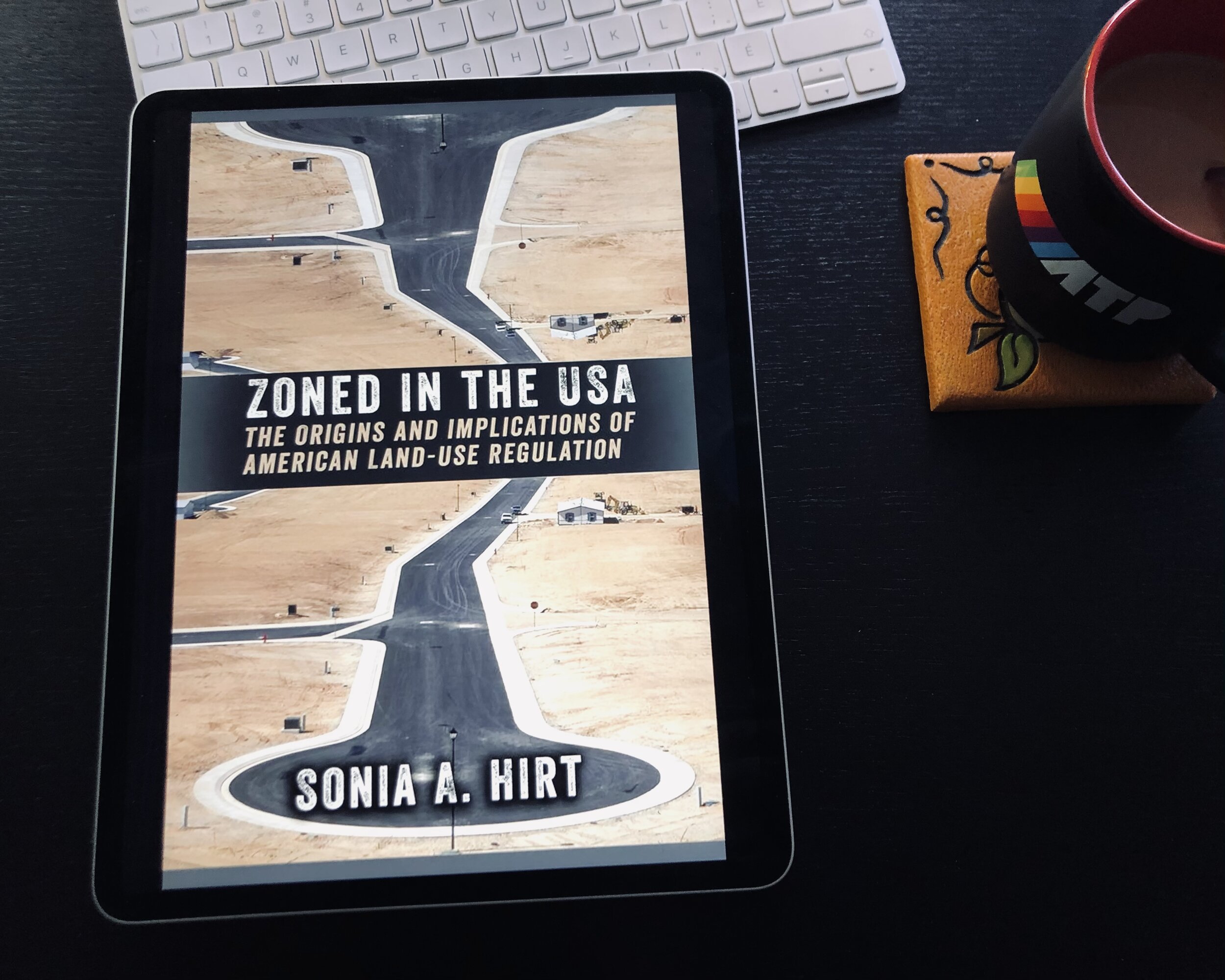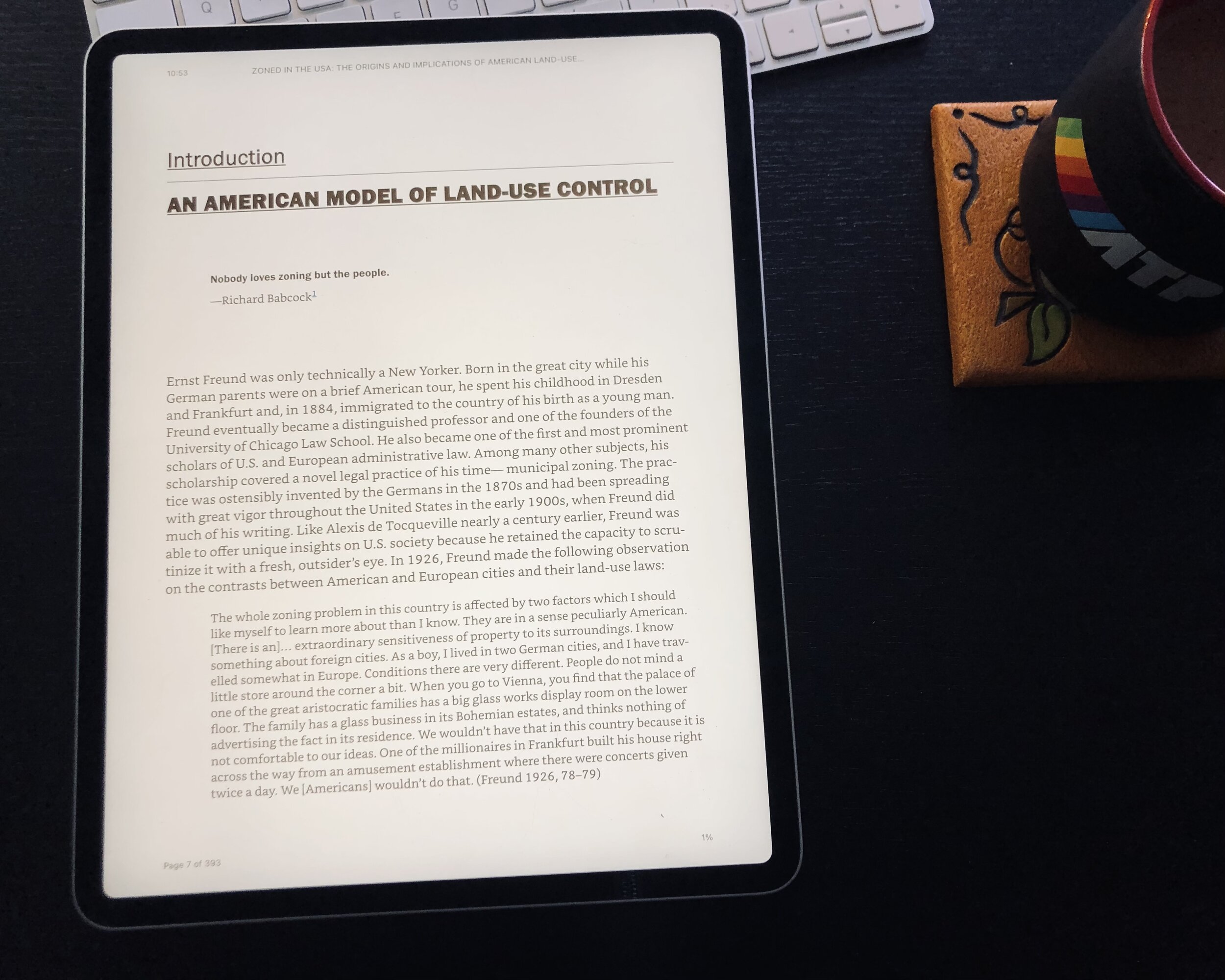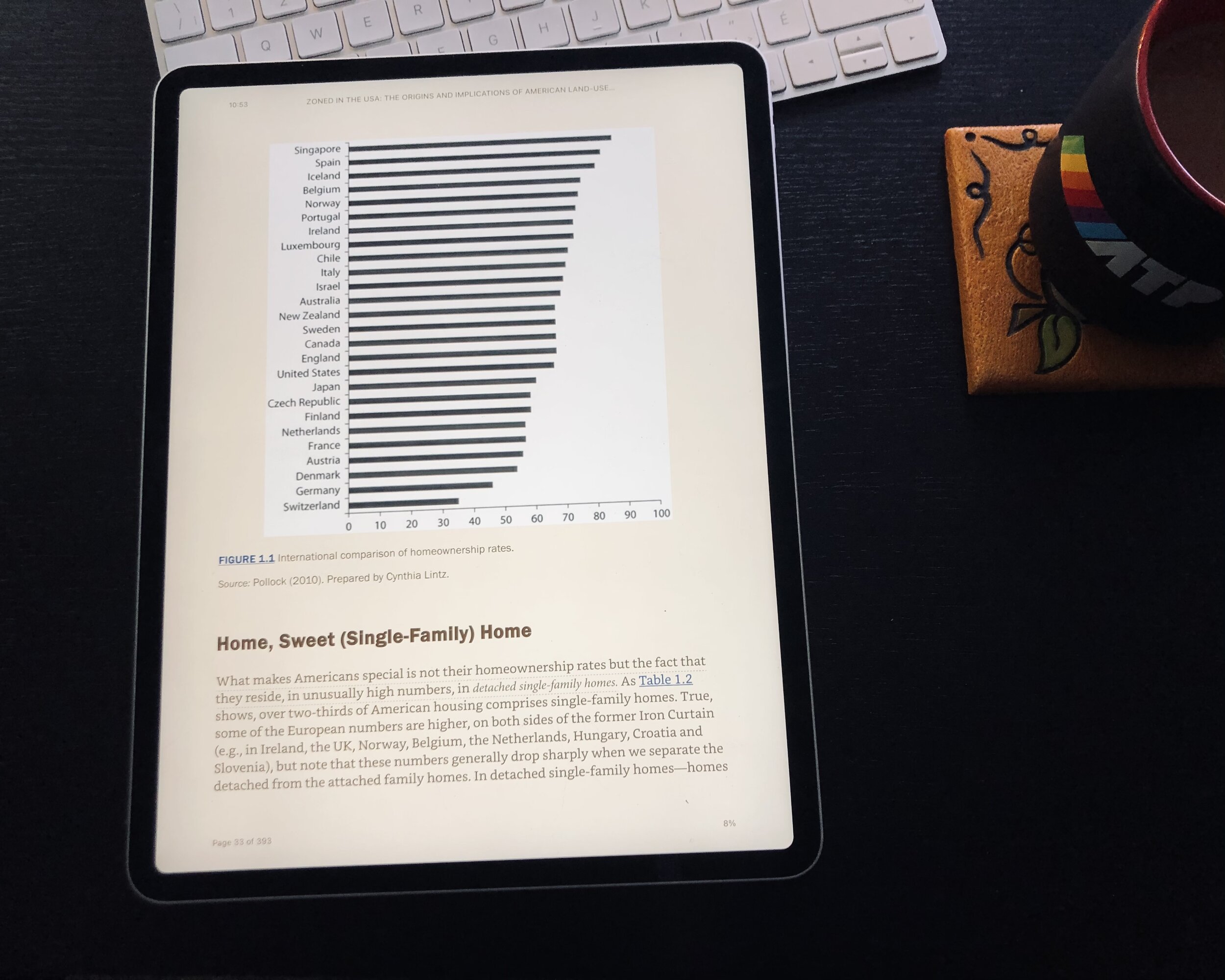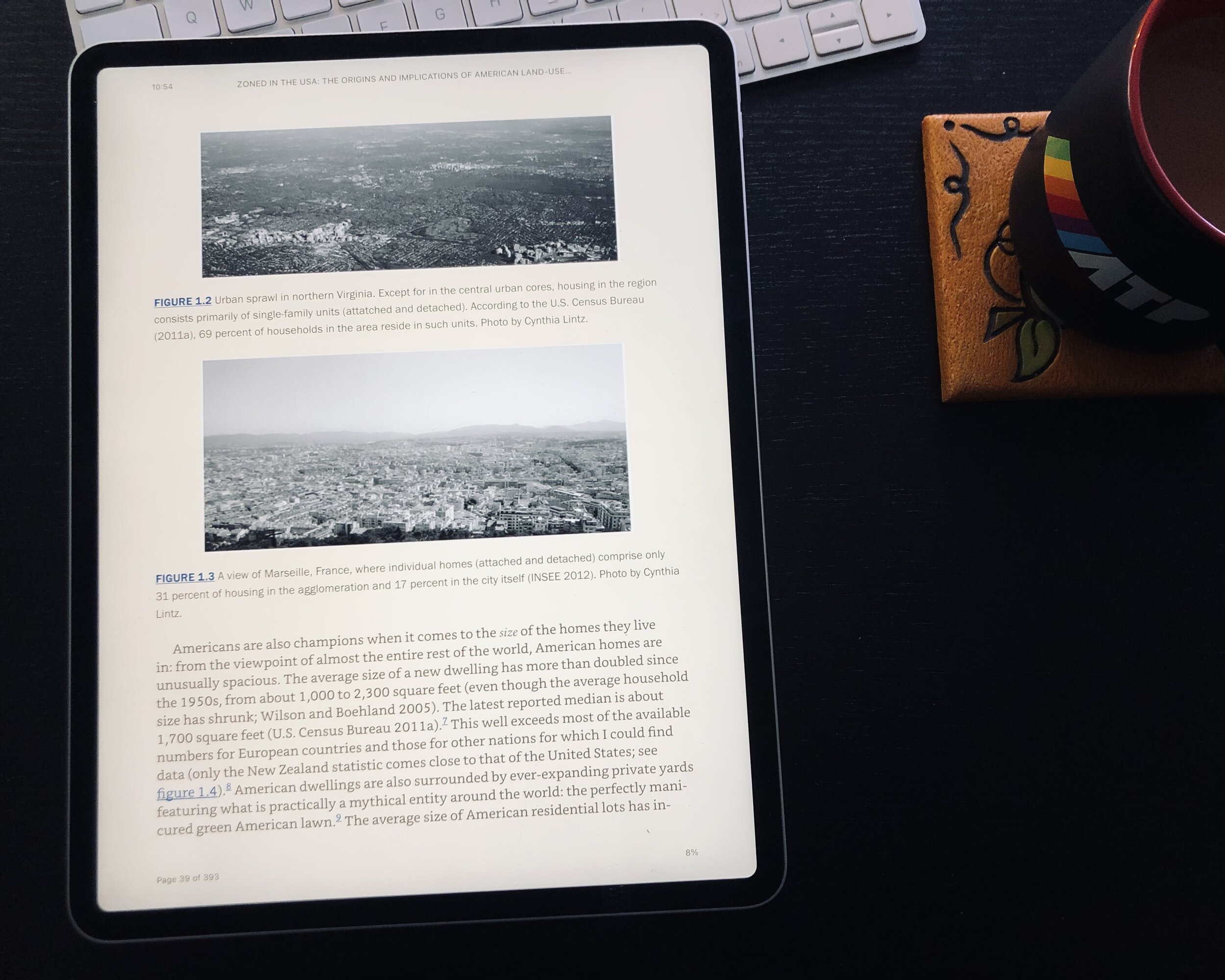The Exploding Metropolis. William H. Whyte (Editor), foreword by Sam Bass Warner, Jr., University of California Press, 1993 (1957-58), 193 pages.
Cette chronique fait partie d’une série sur l’auteur urbain William H. Whyte (1917-1999)
Sur les cinq auteurs donc les textes sont rassemblés pour former les propos de cet ouvrage, seuls deux noms nous sont encore bien connus, soit celui de Jane Jacobs, bien entendu et, dans une moindre mesure, celui de William H. Whyte, qui est aussi l’éditeur de cette collection. La publication originale est parue en 1957, soit juste avant le déploiement, avec l’argent du gouvernement fédéral américain, du réseau des « interstates ». Une fois complété à l’échelle nationale, après 15 ou 20 ans, selon les endroits, ce réseau allait finir par traverser et relier tous les états continentaux des États-Unis. Bien entendu, ces autoroutes devaient aboutir, et encore grâce à l’argent du fédéral (90 % des coûts) et au contrôle des départements de transport des États [1], cela se faisait au détriment des pourtours et des centres urbains. Au moment de la réédition de l’ouvrage, en 1993, le réseau autoroutier national (et même international, puisqu’il traverse les frontières de tous les États-nations des Amériques) était essentiellement complété. Mais il est remarquable que seul deux des auteurs (Holly Whyte et Jane Jacobs, justement) pouvaient entrevoir l’irréversible poindre à l’horizon. Nous vivons tous maintenant sous le soleil cuisant de cette tragédie quotidienne.
L’édition 1993 contient aussi un avant-propos de Sam Bass Warner Jr, un nom qui sera peut-être reconnu par ceux qui auront eu la chance d’être en contact avec son ouvrage sur les « streetcar suburbs » et comment ceux-ci ont aidé dans le développement de Boston. Sa perspective fraiche, écrite avec plus de trente ans de recul sur la publication originale, lui donnera l’opportunité de faire des remarques essentielles. Comme sur la « crise du logement » et le fait qu’en ce domaine, il était même alors notoire qu’autant l’entreprise privée que l’initiative personnelle étaient des échecs, et que laissé à eux-mêmes, ne pourront jamais répondre à la demande. Est-ce la raison que même dans un ouvrage écrit à presque 70 ans de nous, dans le chapitre Are Cities un-American?, le propos de Whyte est occupé par les questions d’insuffisances de logis, de sa piètre qualité et d’un manque dans la diversité du parc de logements offert aux ménages urbains de 1957? Plus généralement, il s’interroge sur la dégradation des standards de design qui faisait que les nouveaux ensembles d’habitation ne semblaient plus miser sur les forces inhérentes à la ville, soit sa densité et sa capacité à rapprocher les gens et services, en intégrant ceux-ci à même les bâtiments.
Sur les traces de The Exploding Metropolis
Cette concentration (pour ne pas dire cette densité) des emplois, des services et des attractions, n’est-ce pas là le milieu parfait pour élever une famille, vivre une vie de bohème ou poursuivre une existence bien remplie sans les encombrements et l’ancrage matériel dépensier généré par une vie en deuxième, troisième ou même quatrième couronne? Surtout depuis qu’il est nécessaire d’assumer soi-même tous ses déplacements, l’accessibilité aux emplois et aux services étant entièrement privatisée via l’automobile? Dans les circonstances, n’est-il pas logique qu’un ménage avec ou sans enfants puisse souhaiter bénéficier de l’autonomie d’une existence urbaine centrale, dans un environnement où tout est accessible à pied, en transport actif ou en commun? En 1957, Whyte expose ces questions dans le premier chapitre et arrive à cette conclusion, mais qui, semble-t-il, doit toujours être réaffirmé : la ville est gagnante lorsqu’elle mise sur ce qui fait sa force, la raison de son existence, soit sa capacité à rassembler une pluralité d’intérêt dans un lieu géographique relativement concentré. Dans ce livre dont il est l’éditeur, William H. Whyte réussit, avec un questionnement toujours pertinent pour notre vingt-et-unième siècle, à faire passer ce point essentiel. Il est de plus appuyé brillamment dans cette tâche par Jane Jacob, dans son chapitre, Downtown Is for People. Elle nous rappelle que tuer l’énergie frénétique de la rue équivaut à éteindre la ville, qu’il faut que les gens puissent vivre, travailler, commercer et produire en ville et que l’attention experte sur l’efficacité des fonctions (circulation, zonage, usages, etc.) de la ville et la volonté de « clarifier » et « d’ordonner » celles-ci est certainement ce qui nous aveugle sur les besoins des véritables moteurs de la ville, c’est-à-dire les gens.
Les auteurs de l’ouvrage contemplaient la ville qui avait été rêvé au début des années 1930, avec une place généreuse à l’automobile et en constataient déjà les périls. Autant les trois autres auteurs parlent des pathologies qui affectaient les espaces métropolitains, autant cette lecture relève plus, pour nous maintenant, de l’épistémologie. Ai-je besoin de dire que cela ne nous couvre pas de gloire? Le chapitre 2 est presque un plaidoyer pour une meilleure accommodation de l’automobile et le chapitre 4, sur les « slums », est entièrement encapsulé par les orbières de son temps.
On prend connaissance de ce livre pour extraire le meilleur des analyses simples et claires de William H. Whyte, de Jane Jacobs et, comme si besoin il y avait, du travail colossal encore nécessaire.
[1] Trop heureux partout de faire du même coup du « slum clearance » et du « Urban Renewal » qui était tout sauf;