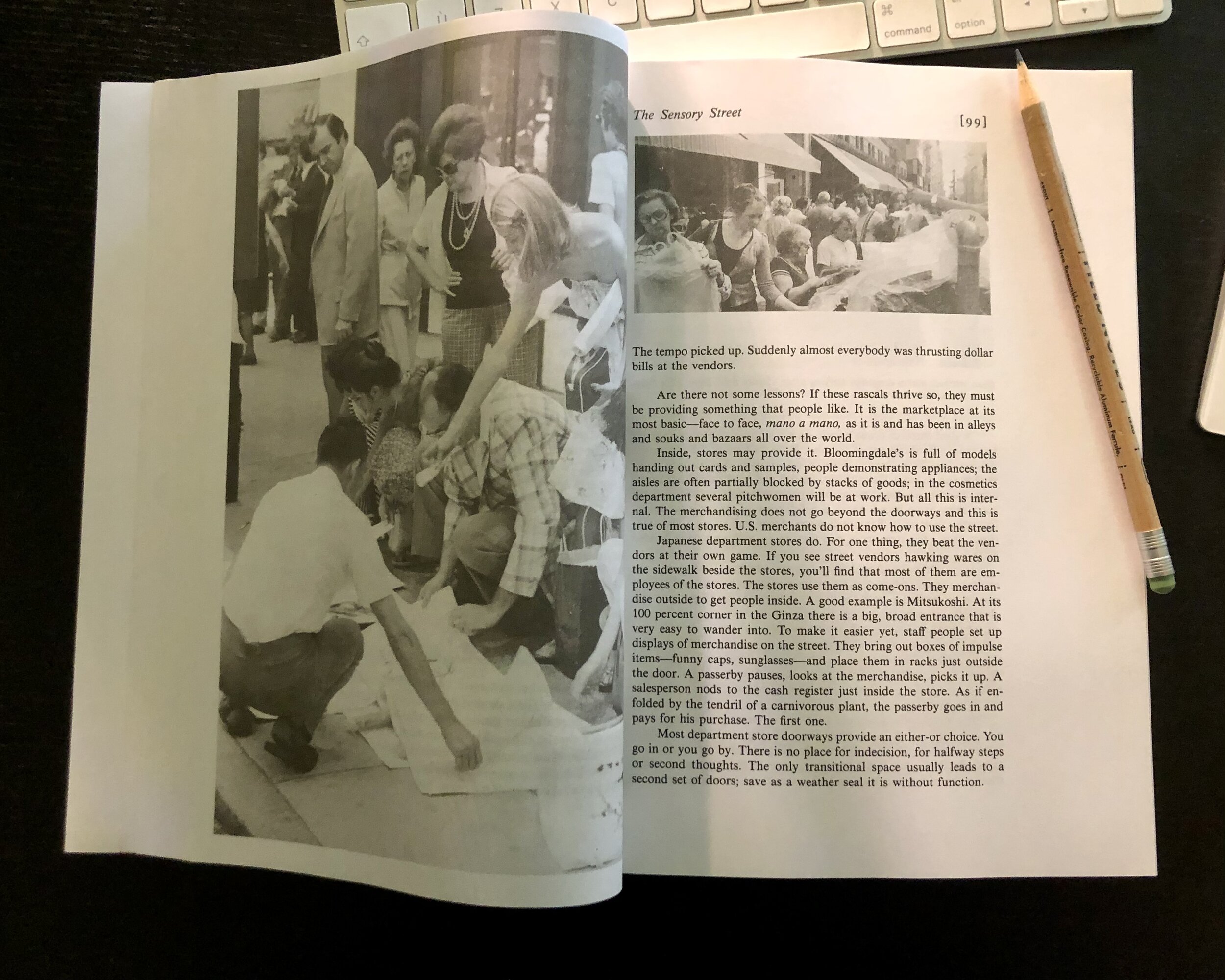The Social Life of Small Urban Spaces. William H. Whyte, Project for Public Spaces, 1980, 125 pages.
Cette chronique est la dernière d’une série sur l’auteur urbain William H. Whyte (1917-1999).
Ce livre de William H. Whyte est paru il y a maintenant plus de 40 ans. Il demeure l’un des outils le plus pratique et concret auquel les urbanistes, architectes paysagistes et architectes-concepteurs peuvent se référer lorsque vient le temps de poser les bases du design d’espaces et de places publiques. Aucun doute n’existe que si, dans 40 ans, on veut toujours consulter le meilleur de ce qui s’est produit sur la façon de réussir une interface heureuse entre un petit espace et l’environnement urbain, les enseignements de Whyte se retrouveront sur le dessus de la pile. En fait, on doit les situer parallèlement à ceux de l’architecte danois Jan Gehl. À peu près à la même époque et avec des méthodes équivalentes, il en arrivait à des conclusions analogues (mais avec, cette fois, une saveur tout européenne). Whyte reconnaît d’ailleurs la contemporanéité de leurs démarches similaires et la convergence de leurs résultats.
Le doute qui se manifeste sur la pérennité des enseignements de Whyte se traduit plus par la difficulté d’incorporer ce qui est, après tout, une leçon constante d’humilité applicable à tous nos gestes. Toutefois, cette application doit se réaliser sans perdre la confiance nécessaire à l’avancement matériel et conceptuel des domaines de l’aménagement et du design urbain. Il est bien connu, par exemple, que la plaza de l’édifice Seagram à NY est, depuis son ouverture, une des plus fréquentée et utilisée, autant par le public de bureau que des touristes. Pour les immeubles de Midtown Manhattan, c’est d’ailleurs le succès de cette plaza qui a entrainé la standardisation, dans le code de zonage, de la formule d’échange « place publique contre superficie de bureaux ». Cela dit, combien savent que le premier surpris par cette fréquentation du public de ce qui se voulait avant tout un « joyau » à vocation purement esthétique fut certainement son concepteur principal, Mies van der Rohe (comme nous le rappelle Whyte en citant son assistant, Philip Johnson [1]). En d’autres termes, certaines plazas urbaines sont vite adoptées et fréquentées, mais la question sera toujours : comment tirer le meilleur parti des éléments de design qui encourage cette fréquentation active, marque d’un véritable succès? Avant cet ouvrage de Whyte, si même c’était une question qu’on souhaitait explorer, la résolution passait le plus souvent par un processus itératif de longue haleine. Surtout, d’accepter que la première fois ne serait pas la bonne. Finalement, avec cet ouvrage, on peut envisager de mettre un maximum de chance de son côté.
Sur les traces de The Social Life of Small Urban Spaces
Le programme qui permettait l’aménagement d’une plaza contre un gain en superficie (dans le nombre d’étages) pour l’immeuble sur même lot a, bien sûr, donné naissance à une période, durant les années 1960 et jusqu’au crash immobilier du milieu des années 1970, où les promoteurs ont fourni ces espaces nouveaux genres. Mais bien souvent, par manque d’une codification minimale des exigences, la ville se retrouvait avec un rectangle minéralisé qui demeurait aussi vide qu’un paysage lunaire, même si en bordure d’une avenue passante. Au début des années 1970, les autorités de la ville finissent par chercher à codifier des standards minimaux encourageant une fréquentation par le public pour lequel ces plazas étaient nominalement destinées. Encore fallait-il démontrer que ces critères de design allaient avoir une chance de renverser la tendance et d’encourager l’intégration souhaitée. Il ne faut pas oublier qu’on parle ici d’espaces localisés dans ce qui est certainement le centre urbain (Midtown Manhattan) avec la plus grande densité d’activités en Amérique du Nord. Une des personnes consultées pour relever ce défi est justement William H. Whyte. Il procède de manière innovante, avec un équipement à la fine pointe de la technologie pour l’époque, même si en réalité sa méthodologie consiste tout bonnement en une observation méticuleuse des comportements humains dans l’espace urbain. Ce travail, qui s’échelonnera sur presque 10 ans, lui permettra de formuler plusieurs pistes fertiles de design qui s’appliquent presque universellement, si on porte une attention particulière au contexte. Par exemple, une ville de 10-20, 100-200 et même cinq cent mille habitants n’est pas simplement une ville de 3 millions d’habitants à échelle réduite. La plupart des aménagements « de grandes villes » ne trouvent pas la densité de public nécessaire pour les activer en d’autres milieux.
Certaines places, « pocket parks » et même, comme on le comprend maintenant, certaines parties de rues (intersections aux configurations particulières, cases de stationnement riverain à des locaux commerciaux de destination ou des restaurants) développent une affluence « naturelle » qui leurs est propres, mais qui est souvent, si on observe de près, aussi le résultat d’une programmation intense, voulu et à l’écoute des circonstances. William H. Whyte ne le dit pas explicitement dans l’ouvrage, mais on fini par réaliser que les éléments d’un espace fréquenté et activé, d’une place à succès en harmonie avec son milieu sont, ironiquement, ceux qui invitent et guident subtilement le public tout en lui laissant un sentiment de contrôle ludique sur son environnement.
[1] MVDR, cité pas Philip Johnson, en parlant des bords des deux vastes plans d’eau rectangulaire où se l’on trouve toujours une petite foule, commente : “I know it. It never crossed Mies’s mind. Mies told me afterward, ‘I never dreamt people would want to sit there’”;