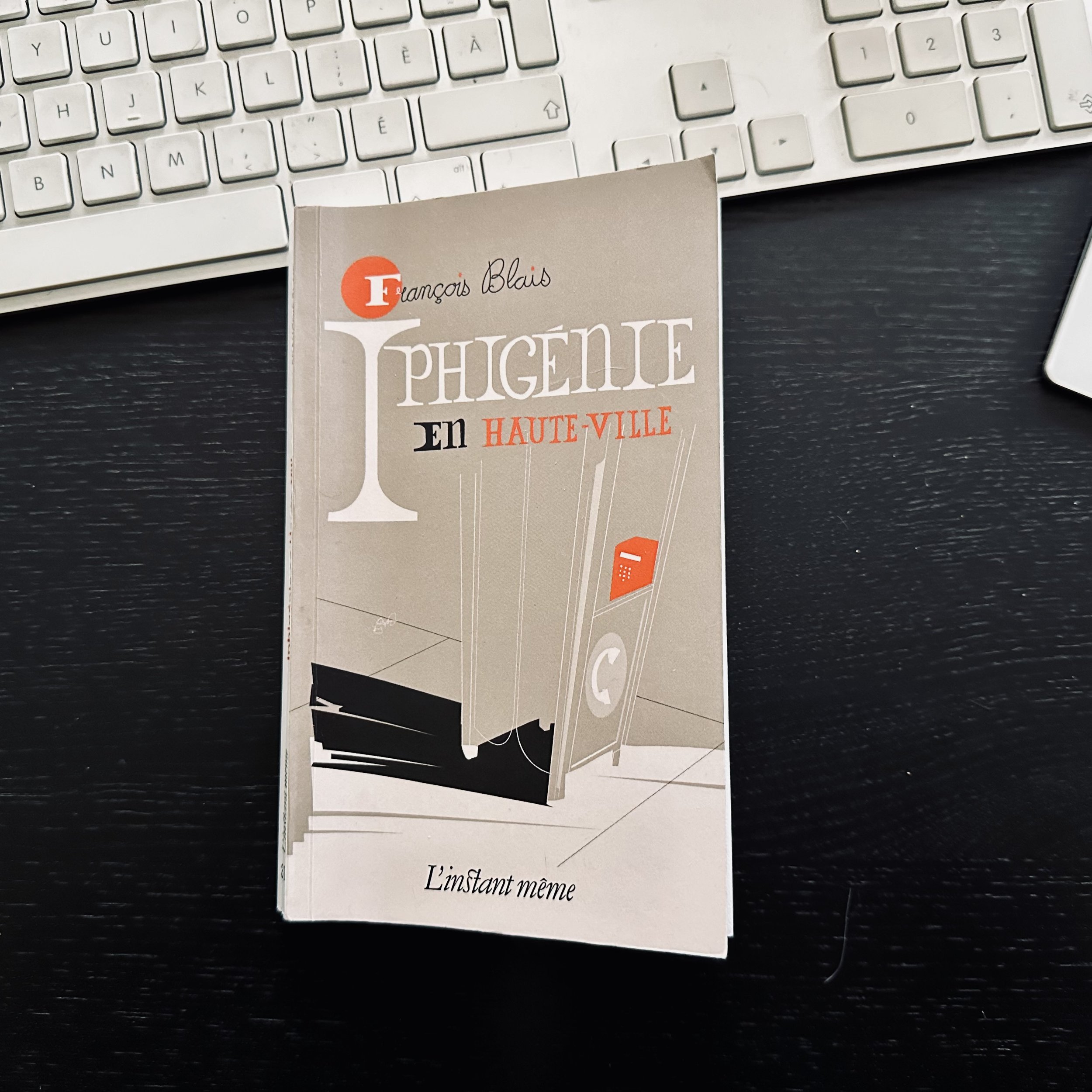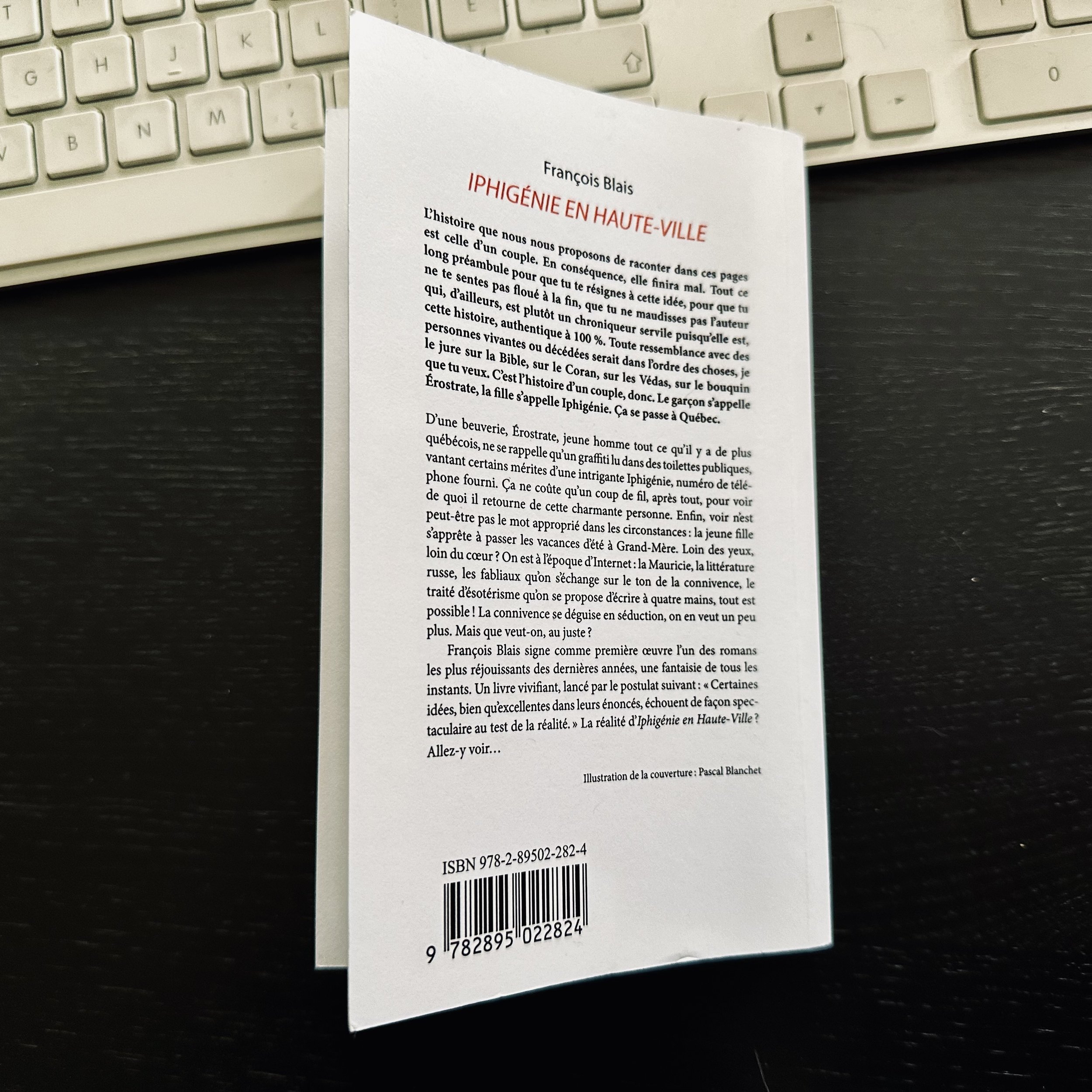Iphigénie en Haute-Ville. François Blais, L’instant même, 2009, 200 pages.
Série fiction — À tous les deux mois
Deux jolis et sympathiques mensonges de romancier viennent ponctuer cette virée dans les profondeurs de nos âmes contemporaines, offert ici par François Blais. De un, il ne s’agit en rien d’un roman à l’eau de rose, comme il l’est écrit sous le titre indéchiffrable (Iphigénie en Haute-Ville) en troisième de couverture. Cette épithète aurait même de quoi choquer les personnages! De deux, ça (leur histoire) ne se passe pas vraiment Québec, même si un message laissé dans une chiotte d’un bar de la Grande Allée sert de catalyseur pour la chronique épistolaire (les « e-mails ») qui composeront l’essentiel du récit. Les deux héros, Iphigénie et Érostrate, s’entrechoquent le temps d’un été dans un des plus vifs échanges de banalités sans lendemain qu’il puisse être donné de lire. Et puisque c’est l’histoire d’un couple qui est destiné à finir mal (dixit le narrateur) et à ne jamais se rencontrer (consciemment), l’énergie de ces jeunes personnages, « authentique à 100 % », ne trouvera finalement d’autre exutoire que celui de leurs propres récits, fait de fiction/réalité. Malgré des tentatives aussi sincères qu’héroïque de la part de l’auteur de rendre saillant les hauts lieux de la vie étudiante à Québec, on peut garantir que personne ne tournera les pages de ce roman pour s’en absorber. L’action du récit, tel qu’il est, se consomme par la suite principalement à Grand-Mère, dans la Mauricie, et même si cette ville finit par s’incarner avec plus de relief pour nos deux héros (et le lecteur, incidemment), encore une fois, nous n’en sommes pas ici au niveau du roman à l’urbanité atmosphérique d’ambiance. Le narrateur de ce récit, à la fois omniscient, intrusif et avec son propre programme qu’il aimerait bien « vendre » au lecteur, nous présente ce monde légèrement déséquilibré par rapport au nôtre. Le monde du roman est un reflet fidèle du nôtre, mais les prénoms à consonance hellénique des personnages lui confèrent juste assez de décalage pour insuffler une tension mythique et vitale aux contes qui servent de véhicule de communication entre nos héros. La mythologie du récit est celle de notre monde contemporain, qui se vit maintenant, sérieusement, mais où existent contes, récits et fables (appelés « fabliau » par nos héros, comme si ces petits récits en vers faisaient encore fureur). Mis bout à bout afin de servir au dialogue entretenu, le temps d’un été, entre nos deux héros, ils sont ce qui donne à ce roman un incontournable frisson narratif.