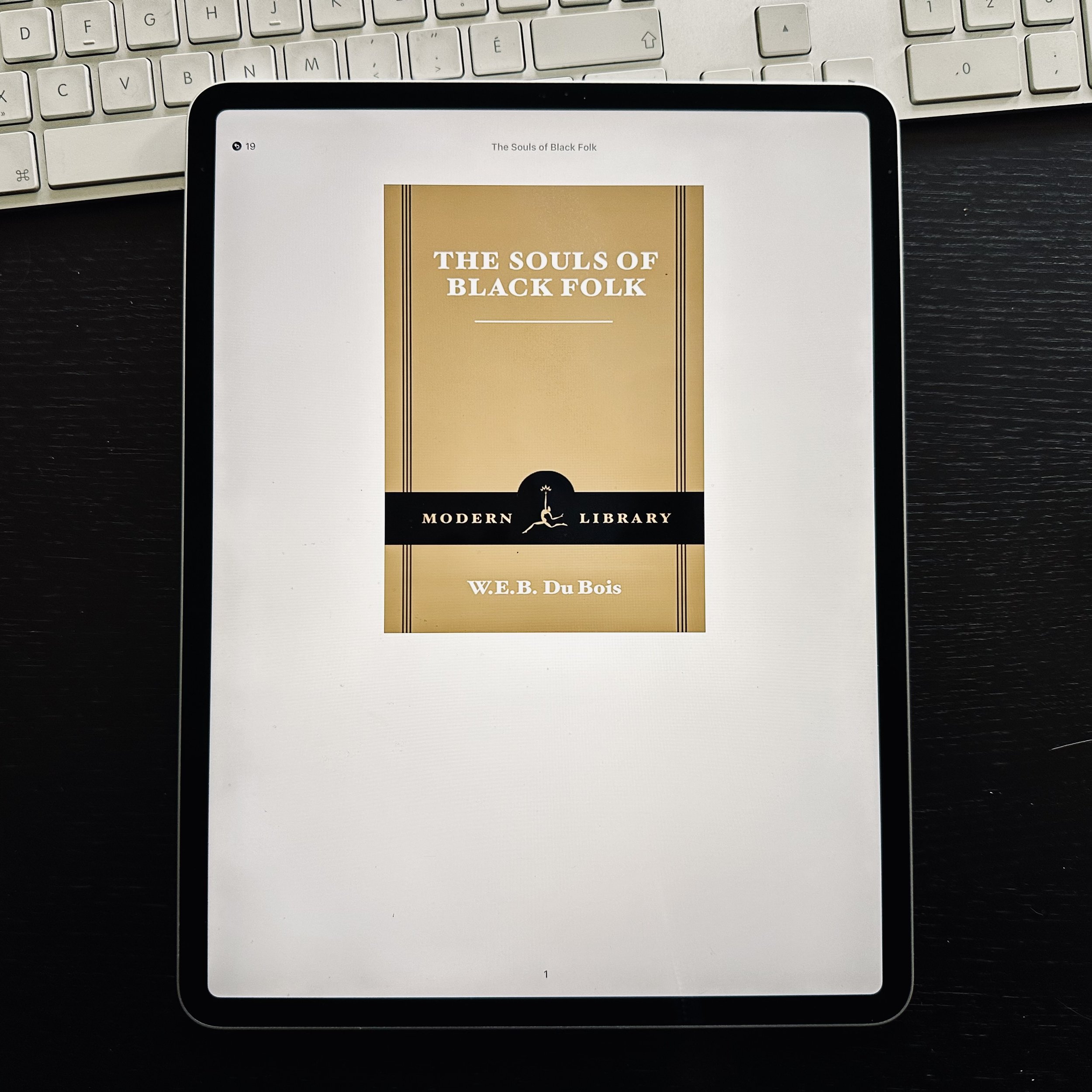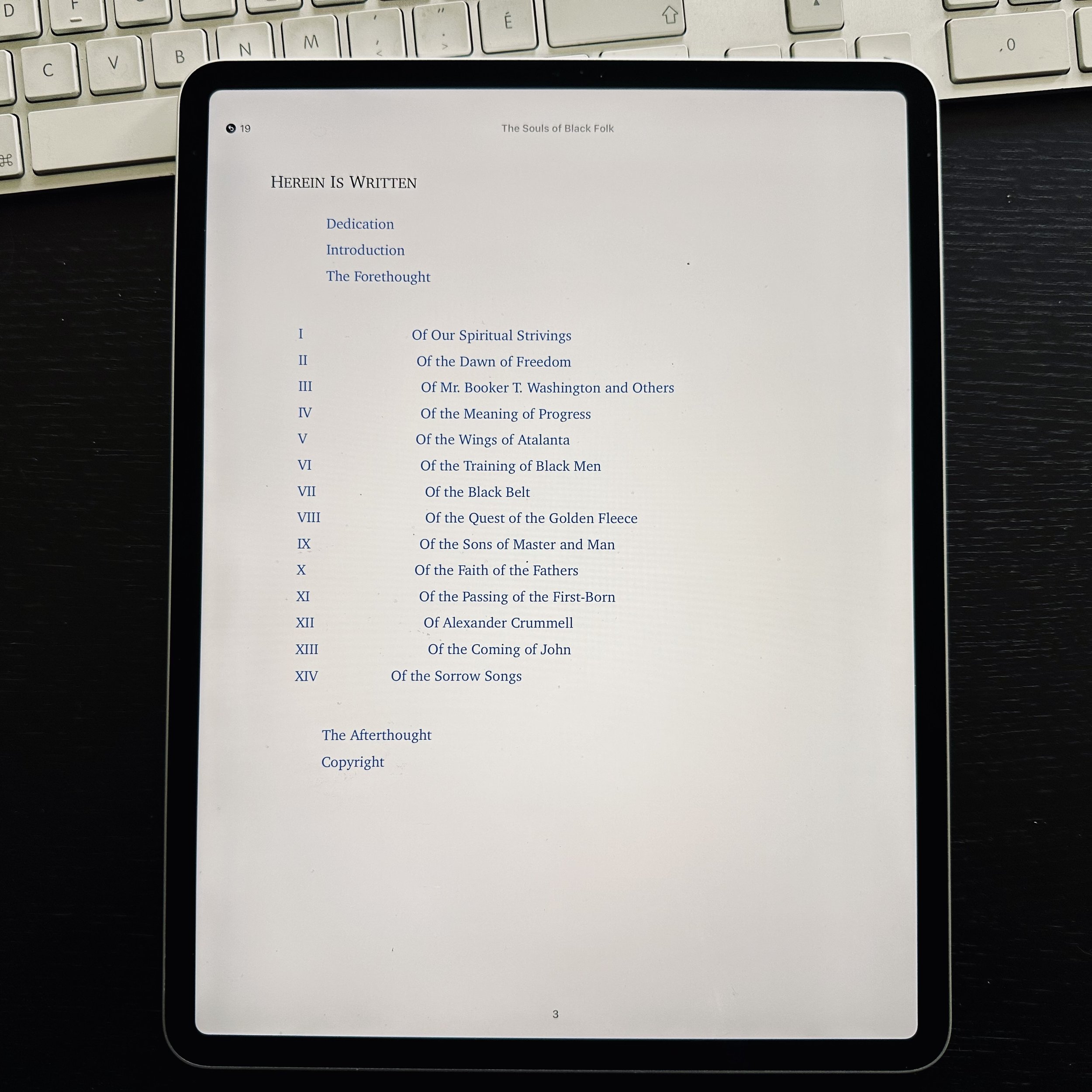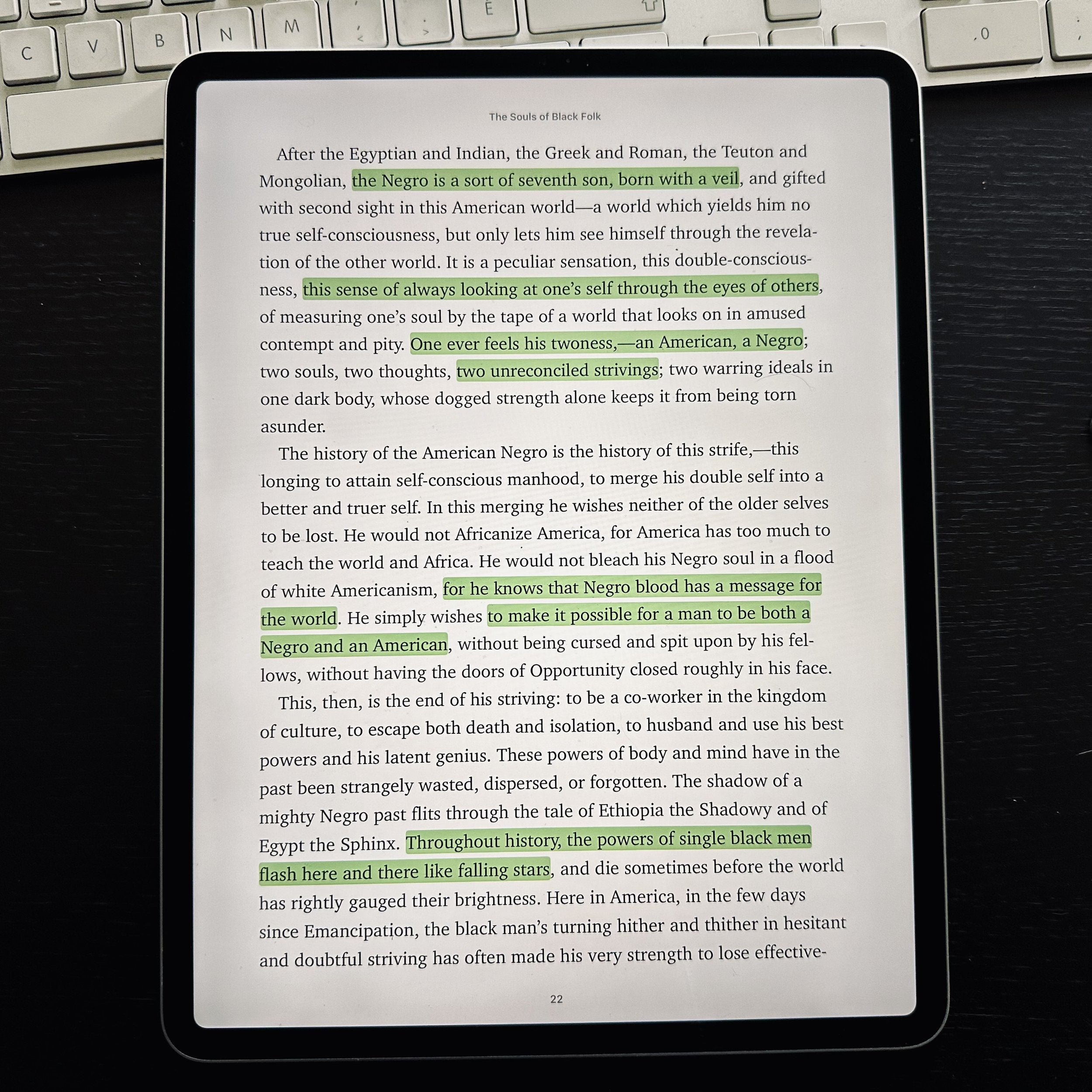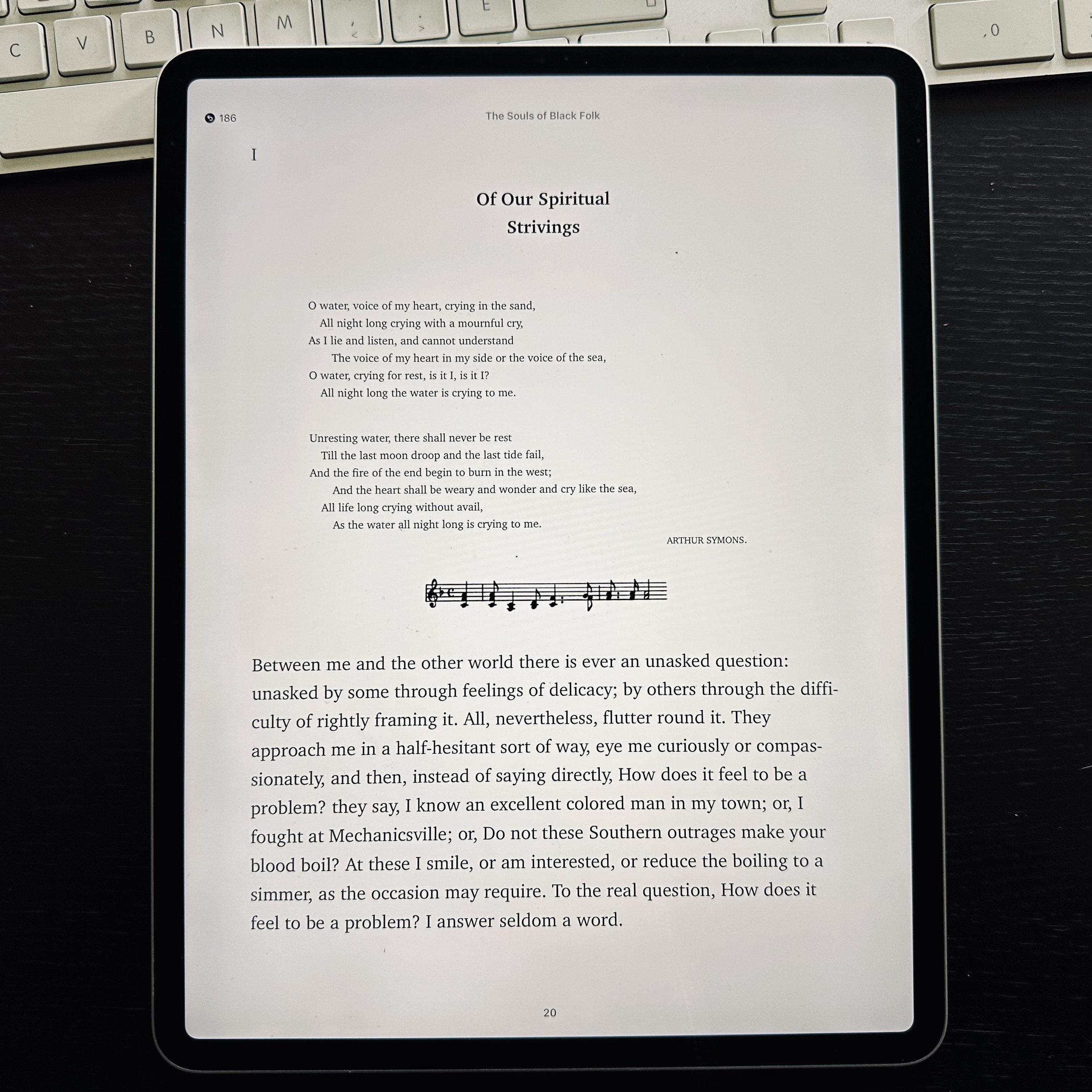The Souls of Black Folk. Introduction by Davis Levering Lewis. W. E. B. Du Bois, Modern Library, Centennial Edition, 2003 [1903], 320 pages [lu en format ebook]
Série essais historique — A tous les deux mois
The Souls of the Black Folk est un de ces livres qui marque un « avant » et un « après » dans la vie de celui qui veut bien s’en laisser imprégner. Pour utiliser une expression propre à l’ouvrage, c’est un des rares moments que nous avons de contempler l’existence « beyond the Veil », ce voile invisible qui fait qu’il nous est possible de passer nos vies tout en ignorant, ou dans le pire des cas, en perpétuant ce semblant d’ignorance qui est la porte ouverte à toutes les dégradations. Pour nous porter à l’intérieur de l’univers des ignominies qui se déroule juste de l’autre côté, il y a l’écriture, la voix d’un autre siècle (le livre est sorti en 1903) qui par la résonance juste, équitable et honnête de son propos, retient l’attention du lecteur durant ses quatorze brefs chapitres. Des chapitres qui sont autant de toiles dans la vie de l’auteur, qui raconte cette adversité quotidienne, emprunt de mesquineries, de tricheries, cette brutalité sans répit, qui s’est souvent révélée mortelle. En parcourant ces chapitres, on lit l’urgence dans le propos, qui devait entrainer le lecteur d’alors tout autant que le lecteur contemporain à questionner la nature et l’existence même de son humanité.
Paru presque quarante ans après la fin de la guerre de sécession américaine, c’est comme si l’auteur, William Edward Burghardt (W.E.B.) Du Bois nous rend la chronique d’un pays qui s’est enfoncé de manière encore plus inextricable dans ce que l’homme a de plus destructeur et ravageur à faire subir à son prochain, si ce dernier à la moindre nuance de noir sur sa peau. W.E.B. Du Bois est né après cette guerre (1868), dans le Nord. Il n’a donc pas eu à grandir au cœur du Black Belt, qui coïncide aussi avec le cœur des anciens états esclavagistes du Sud et la région qui sera le sujet de ce « car-window sociologist », comme il se qualifie drôlement lui-même. Ce moment dans l’histoire américaine est parfaitement illustré par cette carte, qui permet à W.E.B. Du Bois d’écrire, dans le premier paragraphe du livre : « for the problem of the Twentieth Century is the problem of the color line. »
La zone de la Black Belt au États-Unis selon le recensement de 1900, dix avant avec le début de la Great Migration qui changera tout à partir de 1910; Image Wikipedia.
La définition de ce « color line » est probablement moins évidente et surtout, le voile est devenu à la fois plus opaque et translucide (ce qui permet même à certains d’affirmer qu’il n’existe plus), mais la volonté implacable d’asservissement, d’humiliation et de ségrégation entre les gens et groupes de différentes cultures, de culture polymorphe ou cosmopolite, et de différentes nuances capillaires est encore bien vigoureuse dans nos sociétés modernes. Voilà pourquoi The Souls of the Black Folk nous chante toujours aujourd’hui, cent vingt et un ans après sa parution.
Sur les traces of The Souls of Black Folk
W.E.B. Du Bois finira par obtenir des diplômes de l’université Fisk (un HBCU), à Berlin et de Harvard (son PhD). Un des combats de son existence, qui le conduira même à un vif désaccord avec l’une des plus grandes figures de son époque, Booker T. Washington, portera sur l’importance de faciliter à ceux qui le peuvent (dans les communautés noires) la possibilité de poursuivre des études supérieures dans les arts, les lettres, la philosophe, l’histoire, bref, les arts libéraux. Mais selon Washington, si on était pour offrir la moindre éducation aux jeunes noirs du Sud, elle devait se limiter aux apprentissages pratiques et techniques, puisque l’autonomie et la viabilité économique devaient primer avant tout. Le fait que cinq des quatorze chapitres soient consacrés à discuter plusieurs nuances de cette question en dit beaucoup sur sa centralité pour Du Bois. Ce qu’il cherche à faire entendre au lecteur, c’est qu’en étant noir aux États-Unis, tout sujet de discussion doit être abordé avec « this double consciousness, this sense of always looking at one’s self through the eyes of others, of measuring one’s soul by the tape of a world that looks on in amused contempt and pity. One ever feels his two-ness—an America, a Negro; two souls, two thoughts, two unreconciled strivings; two warring ideals in one dark body, […]. »
Si ces paroles ne sont pas assez pour comprendre l’irréductibilité de la situation pour la population noire des États-Unis, voici ce que le sénateur Benjamin Tillman de Caroline du Sud a dit en apprenant que le président américain avait reçu Booker T. Washington pour un souper à la Maison-Blanche : « The action of President Roosevelt in entertaining that nigger will necessitate our killing a thousand niggers in the South before they will learn their place again. » Ce sénateur parlait ainsi du principal avocat pour une approche « lente » de l’intégration de l’homme noir au sein de la société du Sud, principalement pour éviter un « harsh, white backlash. » Ce « deadening and disastrous effect of a color-prejudice » permet également à Du Boise de mentionner, sans autre explication, les noms de Phillis Wheatley et Sam Hose; deux extrêmes de l’horreur « beyond the Veil ». L’avant-dernier chapitre de l’ouvrage, XIII Of the Coming of John, raconte en quelque sorte cette réconciliation impossible. On lira aussi pour le « discours » du juge à sa table de cuisine. Cela se termine par un lynchage.
En 1935, W.E.B. Du Bois fait paraitre Black Reconstruction, une reconsidération de la douzaine d’années après la fin de la guerre civile américaine. Il faudra attendre les décennies 1980-90, avec Eric Foner en tête, pour que les arguments de l’ouvrage commencent à être pris au sérieux par les historiens et mènent à une relecture de cette période. Nous allons nous intéresser à ce livre lors de la prochaine chronique de non-fiction, le dernier mardi, dans deux mois.