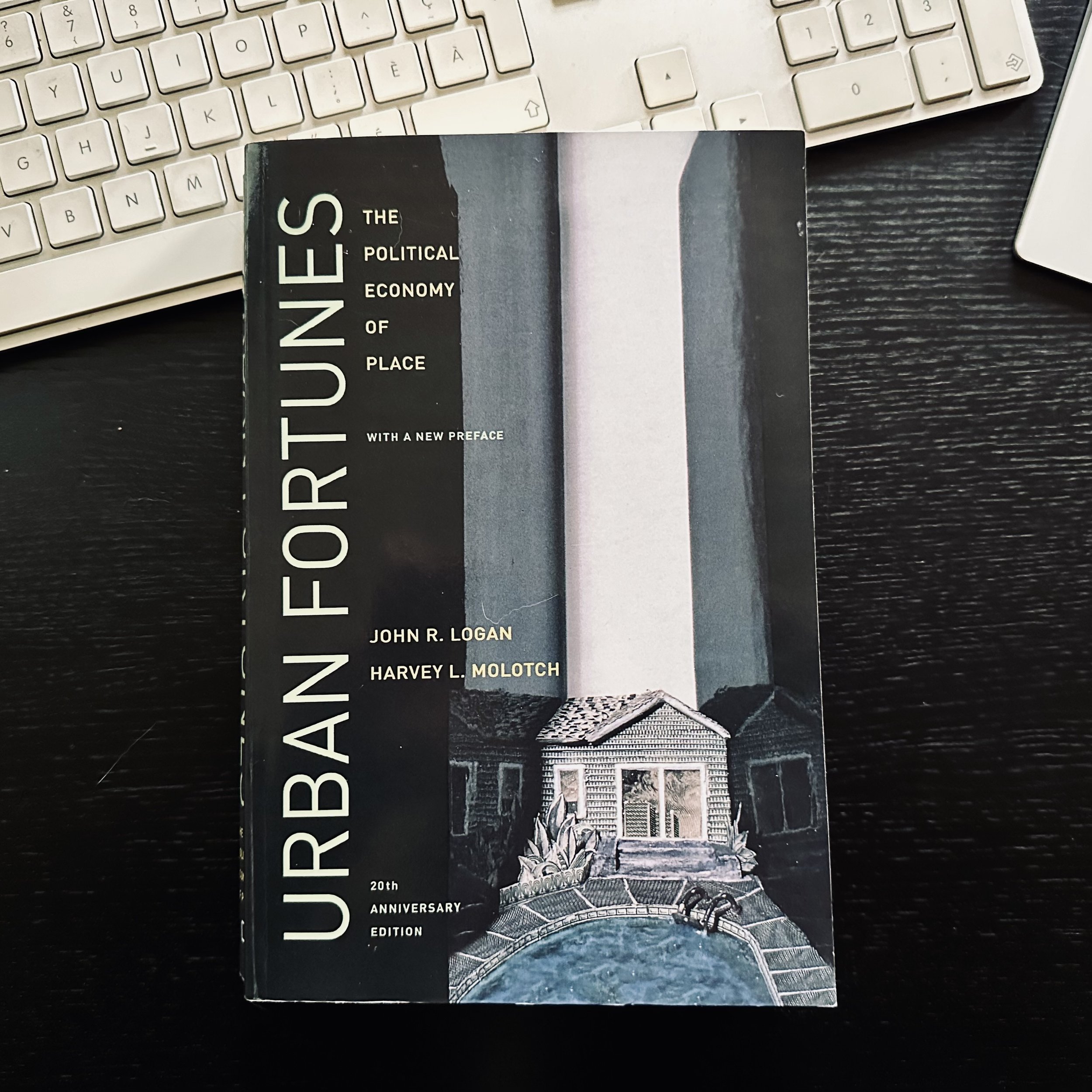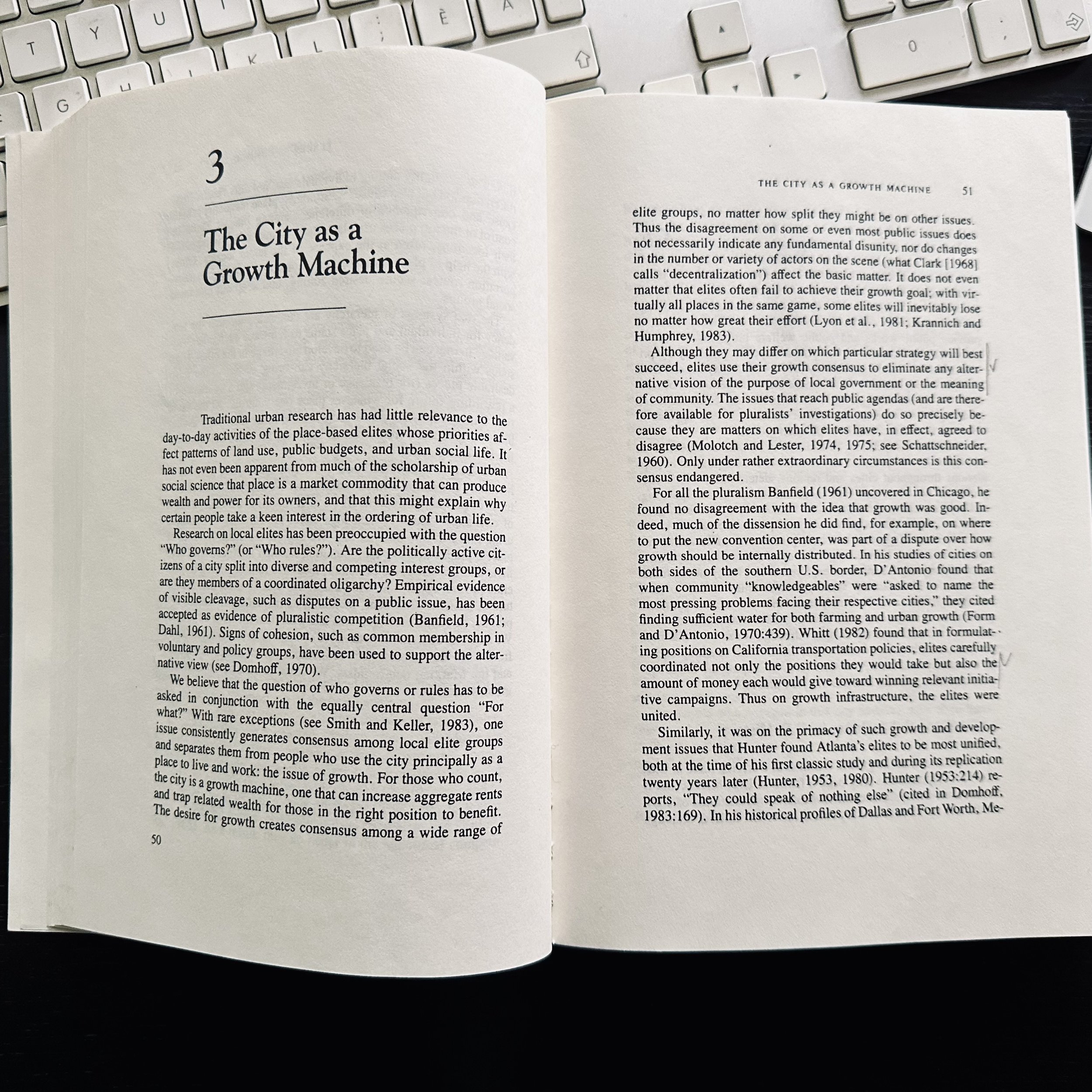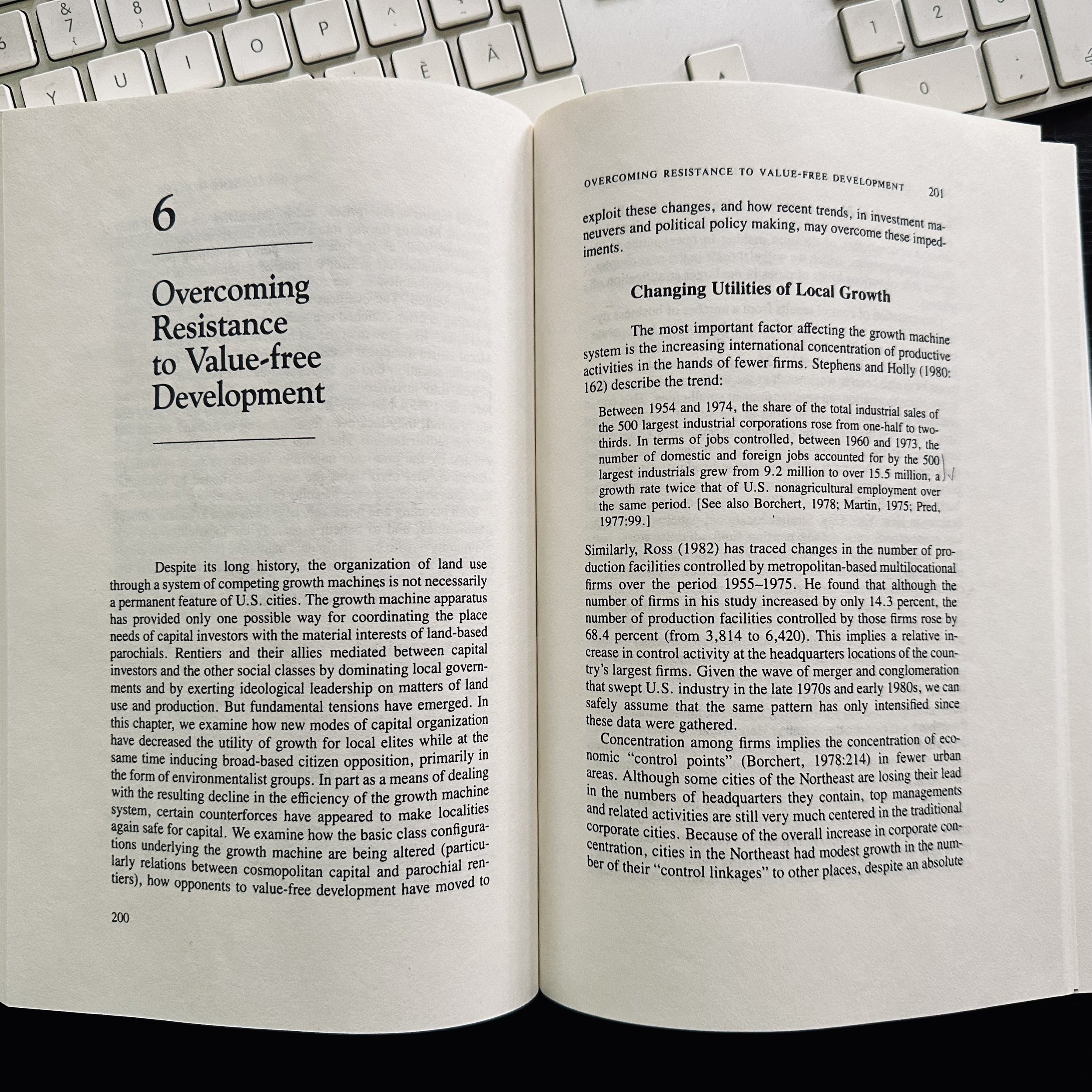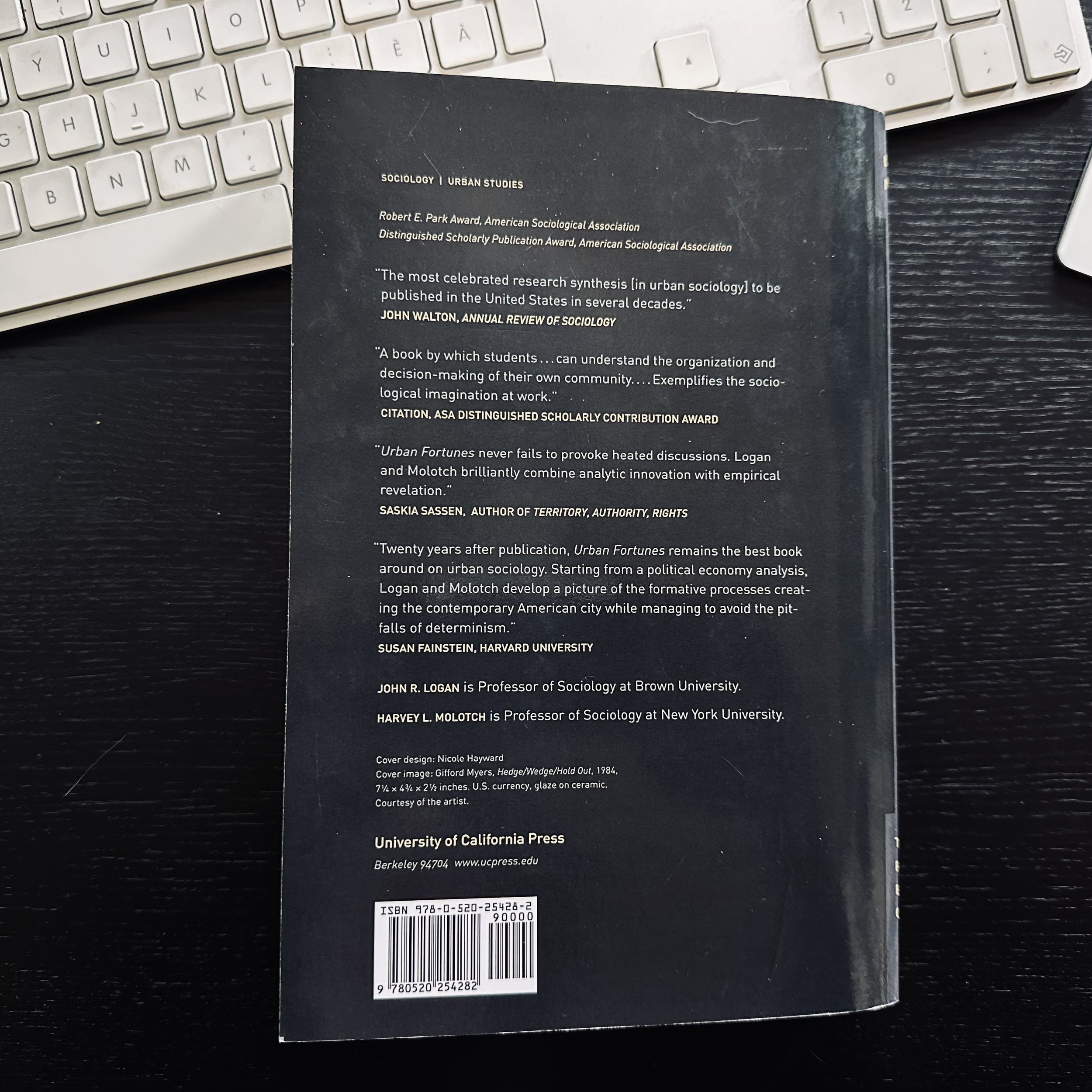Urban Fortunes—The Political Economy of Place—With a New Preface—20th Anniversary Edition. John R. Logan & Harvey L. Molotch, University of California Press, 2007, 383 pages.
Cette chronique est un bonus dans notre série sur la ville de Los Angeles.
On imagine aisément que dans chaque ville, village, zone rurale, province ou pays, existent des groupes d’intérêts pour qui l’essor économique et un développement sans contraintes sont des impératifs de premier plan. Les chambres de commerce, sociétés de développement et autres clubs de croissance font leur travail en essayant de mousser les atouts locaux et régionaux auprès des entrepreneurs, producteurs et investisseurs potentiels sensibles à cette offre avantageuse. Dans le même sillage, le pouvoir politique de tous les paliers de gouvernement voit de façon positive le contrôle d’une région qui est reconnue en tant qu’engin de croissance et de prospérité pour ses commettants. Il peut donc parfois se développer une symbiose, qui peut vite devenir malsaine, entre l’élite politique et les groupes que les auteurs de l’ouvrage, par exemple, appellent la « machine de croissance » (The Growth Machine), dans toutes ses incarnations. Ainsi, la machine peut par défaut s’imposer comme seul interlocuteur écouté et entendu dans une conversation sur les options de développement et d’aménagement d’un territoire. La force de cette machine, ainsi que le démontrent les auteurs, est dans son habileté à monopoliser le message afin de le guider dans le sens de ses intérêts. Elle réussira même le plus souvent à les faire passer comme universel. Avec ce type de discours, une autre des forces rhétoriques de la growth machine est sa capacité à convaincre que la croissance est nécessairement synonyme de progrès économique et social pour les personnes défavorisées. Ou comme le veut l’aphorisme bien connu de la croissance, a rising tide lifts all boats.
L’axe argumentatif de la growth machine est d’autant plus puissant qu’il s’efface derrière une thèse englobante et « naturelle » qui le présente comme un bien en lui-même, sans autre besoin de justification. L’acceptation de ses vertus est si répandue qu’en essayant de pointer certaines failles dans son discours, on se trouve vite à plutôt devoir motiver les raisons de cette contestation. Ainsi, au lieu de susciter un questionnement opportun sur les mécanismes de mise en place et les bénéfices de la croissance, on est contraint d’expliquer le fait d’interroger l’idée même que le modèle de croissance proposé soit un apport positif net à la communauté d’accueil. Est-il vraiment si déraisonnable de demander qui a quoi? comment? à quel prix?, et surtout, en fin de compte, qui paye? En d’autres termes, de s’interroger sur la répartition légitime de la nouvelle richesse créée?
Sur les trace de Urban Fortunes
La réédition du livre était pour fêter ses 20 ans de parution, en 2007; nous sommes donc maintenant en 2024, à presque 40 ans de la date de publication d’origine et pourtant, il m’appert que le propos n’a rien perdu de son actualité et de sa pertinence. En fait, je suis même un peu contrarié que des concepts de base, comme la valeur de transaction (exchange value) et la valeur d’usage (use value), sur lesquelles repose l’essentiel de l’argumentaire des auteurs, ne fassent pas plus partie de nos enseignements en urbanisme. Il est clair que plusieurs des préceptes fournis par l’ouvrage trouvent leurs places quand vient le temps de décrypter un environnement urbain. Malheureusement, faute de gens (économistes, urbanistes, et ironiquement, aussi des entrepreneurs!) qui pourraient percer l’ubiquité du discours consensuel de la « growth machine », il existe toujours un aveuglement sur les opportunités laissées en friche par rapport à la richesse et qui tiendrait compte de la participation des gens en place. Une des rares figures contemporaines en urbanisme qui argumente en ce sens est curieusement un conservateur de tempérament, Chuck Marohn de Strong Towns.
En plus d’être, à moyen et long terme, un net négatif (les subventions, contributions et autres allègements fiscaux et de taxes finissent rarement par avoir un résultat positif), cette redistribution se concentre dans la poche de ceux qui possède déjà, pas ceux pour qui cette contribution viendrait changer la donnent. Il est difficile d’argumenter que cette stratégie, ces concessions sans véritable risque partagé rendu aux intérêts de la growth machine, entrainent des investissements frais dans l’économie locale.
Je pense que nos sociétés sont mûres pour une meilleure connaissance des manières de générer une expansion économique locale. Ce n’est pourtant nul autre que Jane Jacobs, dans The Economy of Cities [1], qui avait apporté la réponse la plus crédible. Cet ouvrage est trop peu lu et connu, selon moi. Mais le but des auteurs n’est pas de donner des instructions sur la construction d’une économie locale, mais plutôt de démontrer que les intérêts de la growth machine se concentrent en silo sur des valeurs purement transactionnelles, au détriment d’autres, comme l’usage. Un environnement urbain solide et pérenne est composé d’un complément équilibré des deux.
Rien de mieux que de s’ouvrir les yeux sur une situation qu’on avait un peu perdue de vue. Une lecture nécessaire qui choc juste là où il le faut, pour redémarrer le système.
[1] Jane Jacobs était d’ailleurs particulièrement fier de son travail sur cette question, comme elle en témoigne dans cette entrevue.