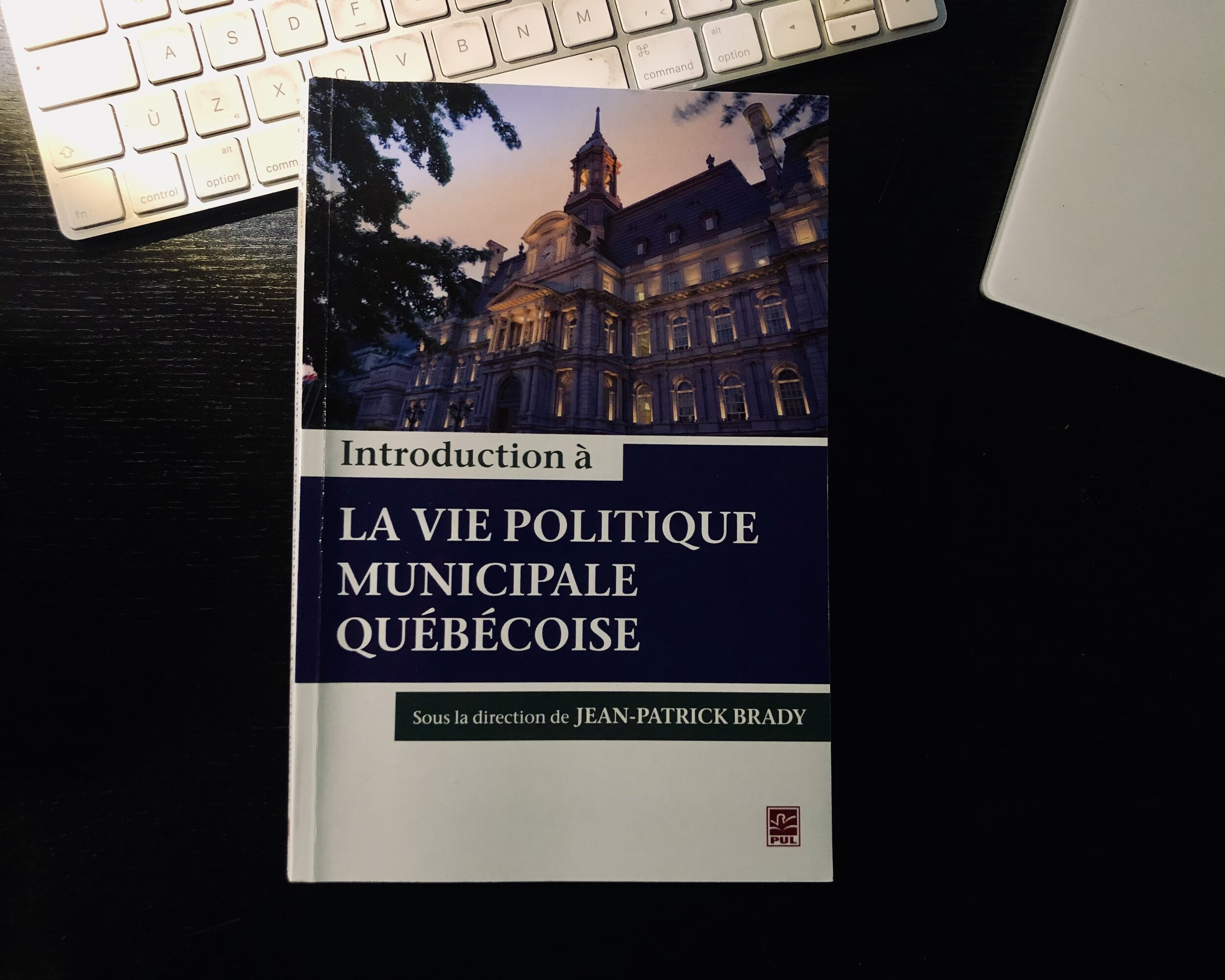Introduction à la vie municipale québécoise. Sous la direction de Jean-Patrick Brady, Presses de l’université Laval (PUL), 2019, 233 pages.
Avec les élections qui approchent à grands pas dans trois semaines, je poursuis cette série de lecture d’ouvrages ayant tous comme thème principal la gouvernance municipale dans la province. Dans ce petit manuel qui dépasse vite sa facture didactique et « d’introduction » à la vie politique municipale, les auteurs des perspectives choisies pour dresser ce portrait de première instance démontrent une habileté heureuse à synthétiser et à faire avancer leurs thématiques respectives. Toutefois, si la lecture de ces textes donne une impression de faire du sur place, ou d’un avenir tout aussi incertain que le passé, remplit de frustrations et de ressources insuffisantes, cela n’est certainement pas attribuable à autre chose qu’au portrait réaliste de la politique municipale offert par l’ensemble.
Dans un premier temps, disons que tous les participants à l’ouvrage ont bien conscience d’écrire à peine un an après l’adoption du projet de loi 122, dite Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs. Encore maintenant, en octobre 2021, les effets de cette loi sont très incertains, et même si le nombre des lois, chartes (de villes), codes (de la sécurité routière et municipale), règlements (un seul) et décrets touchés par cette loi est impressionnant, la vérité simple est que les effets ne se sont pas encore véritablement fait sentir. De plus, un des éléments les plus controversés intégrés à la législation (et demandé avec insistance par l’UMQ), soit le pouvoir d’abolir l’approbation référendaire, si les exigences réglementaires de participation publique sont respectées, semble faire chou blanc, trois ans après l’adoption de la loi.
Une des autres caractéristiques de la législation est justement de donner plus de responsabilités aux municipalités. Mais tout ceci sans faire la correspondance avec des moyens équivalents, ce qui permettrait de prendre en charge ces responsabilités croissantes. Dans ce répertoire, le cas des logements sociaux est particulièrement éloquent ; il y a en effet un renforcement des pouvoirs réglementaires (art. 13, dont Montréal s’est prévalue), mais les moyens financiers sont demeurés fermement entre les mains de la législature provinciale.
Sur les traces d’Introduction à la vie politique municipale québécoise
C’est donc un peu avant cette aube nouvelle (que l’on devine semblable à la dynamique, plus que centenaire, de subordination) que les huit chapitres présentent leurs matières. Mais loin de rendre ce matériel caduc, on sera heureux de parcourir un premier chapitre simple et efficace sur l’histoire du cadre législatif municipal, un autre sur les enjeux de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire ou, même si nous venons juste de lire un livre du même auteur sur la question, un autre sur le concept d’innovation municipale. Pour rester dans le domaine des idées familières, pour les avoir abordées dans cet espace, le deuxième chapitre mentionne l’acupuncture urbaine et l’urbanisme tactique comme moyens d’action (politique) dans l’espace urbain, tout en allant beaucoup plus loin sur ces manifestations actualisées du « droit à la ville ». Et comme pour faire suite au propos de Nettoyer Montréal, un texte fait de rappels surprenants est consacré aux suites de la commission Charbonneau et aux notions d’éthique et de déontologie (comme le souligne l’auteur, trop souvent confondue !) dans le monde municipal.
Un des chapitres les plus intéressants du volume, probablement parce qu’il était aussi très éclairant pour moi, est celui sur les moyens de développement économie utilisé par les municipalités (ou en leurs noms). Au-delà des politiques ou plans stratégiques implantés, cette question met en relief la dépendance des gouvernements municipaux et des administrations régionales (MRC) envers les initiatives ou les visées spécifique de la province. Pour le moment, une des rares échappatoires demeure une place dans le réseau (assez exclusif) des « villes créatives ».
Je l’ai évoqué, le point qui laisse sceptique dans la nouvelle législation sur les « gouvernements de proximité » est le silence sur les moyens financiers ; aucun nouveau pouvoir délégué substantiel. Il y a justement un chapitre qui fait ce contraste entre le vaste répertoire des « responsabilités municipales » (effectives ou potentielles) et les moyens datant d’un autre siècle (l’impôt foncier) mis à leurs dispositions des municipalités afin d’aller chercher des revenus. Nul besoin de souligner qu’un gouvernement, aussi « de proximité » qu’il soit, sans véritable indépendance financière, aura toujours de la difficulté à agir de manière pleinement responsable et autonome.