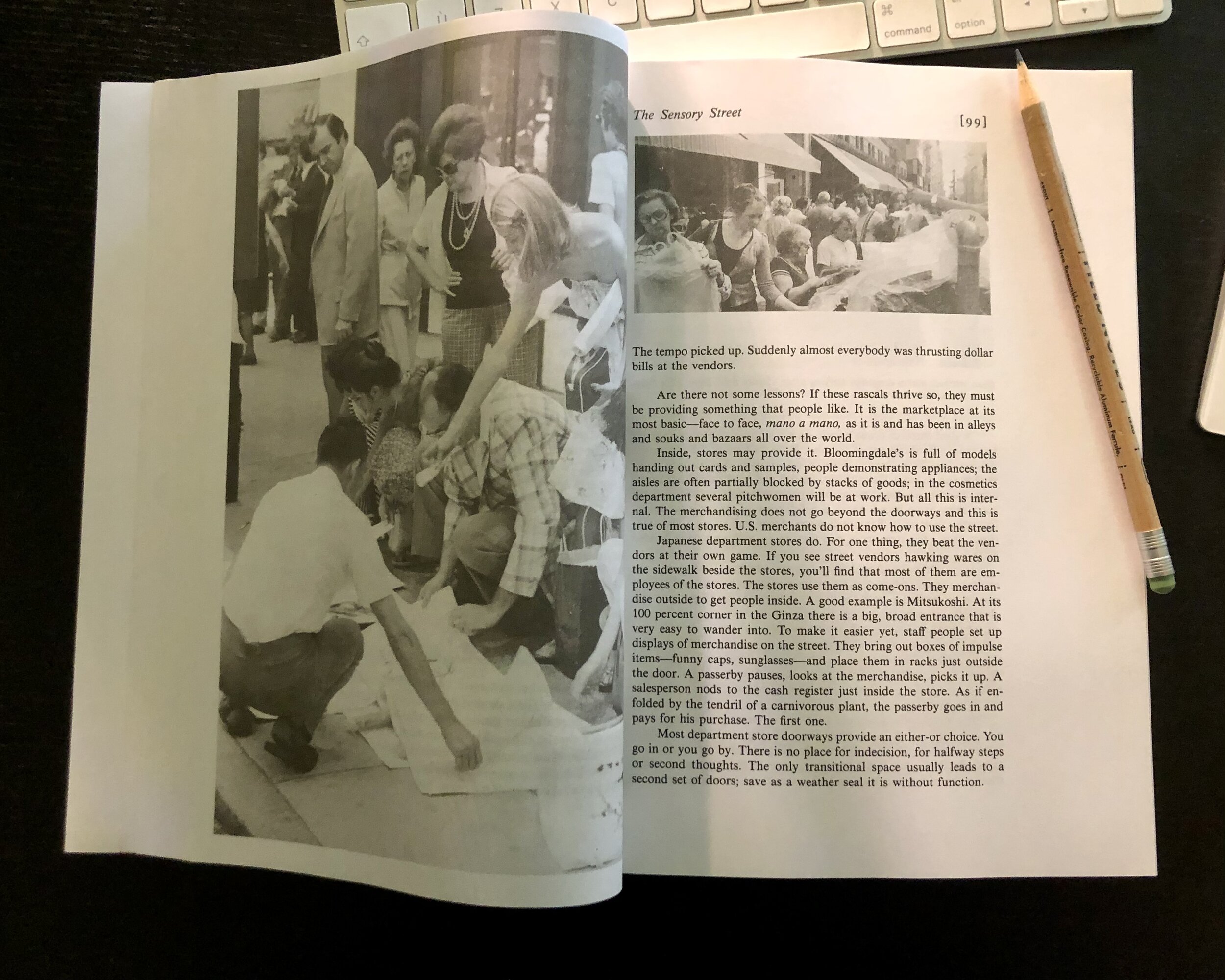Learning from Bryant Park—Revitalizing Cities, Towns, and Public Spaces. Andrew M. Manshel, Rutgers University Press, 2020, 293 pages.
Cette chronique est un boni dans notre série sur l’œuvre de William H. Whyte (1917-1999).
Après avoir passé tout ce temps à examiner et à considérer les travaux d’une personne, comme ceux de William H. Whyte, on trouve rassurant de constater qu’en situation réelle où cette vision a pris forme, un renversement positif à 180 degrés s’est produit. Le récit à la première personne de cet ouvrage nous illustre que oui, une ville qui s’inspire des observations de Whyte pour guider les orientations d’aménagements de ses aires et places publics fera des pas de géant en faveur d’environnements urbains plus conviviaux pour tous.
Il est également réconfortant de constater que, lorsqu’on applique les orientations proposées par Whyte en faisant preuve de sensibilité, après avoir pris soin d’analyser le contexte et l’échelle urbaine appropriée, les résultats constructifs sont souvent ressentis bien au-delà du lieu visé initialement. Chaque chapitre est l’exemple qu’un travail sur un espace ou un corridor urbain a des retombées sur tout un secteur ou même un quartier de la ville, que ce soit par émulation ou par attraction. La capacité à distribuer équitablement cet impact et ces retombées positives devient souvent alors le vrai défi et fait partie de l’enjeu.
Ce livre d’Andrew M. Manshel est un témoignage, à la première personne, de la puissance d’une approche de l’espace urbain, d’une sensibilité de gestion qui donne la priorité au à l’accueil convivial et ouvert de tout le public. Dans les expériences racontées dans l’ouvrage, qui s’étale sur une période de plus de 20 ans, la plus exemplaire est celle qui s’est produite au cœur du cœur de la plus grande métropole américaine, New York. Elle nous parle directement de la capacité de quelques orientations fortes, appliquées judicieusement, de transformer un environnement urbain pour le mieux, en faveur des gens qui fréquente et souvent choisissent d’y vivre. Le district visé dans cette discussion est Midtown Manhattan, plus précisément Bryant Park et ses alentours, derrière la fameuse branche centrale de la NY Public Library (avec ses lions !), le long de la Fifth Avenue, entre West 40th et 42nd Street. De surcroit, en page couverture du volume, on voit ce qui est devenu le symbole des approches d’aménagements « à la William H. Whyte » : une simple chaise de type bistro, toujours disponible et que le public est invité à déplacer à sa guise. L’ouvrage est un peu l’histoire de cet outil, par la voix d’un de ses praticiens.
Sur les traces de Learning from…
Cette chaise est certainement devenue le symbole de cette philosophie d’aménagement qui invite le public à « s’approprier » de l’espace afin de mieux la définir, ne serait-ce que le temps d’un midi. Toutefois, ce que ce symbole semble si bien dissimuler, c’est toute l’infrastructure de soutien et d’entretien qui doit exister pour que cette chaise existe. Un niveau de soin et de concertation qu’il est difficile de mettre sur pied, dans un premier temps et par la suite, de maintenir de façon consistante et durable. De plus, c’est en travaillant pour une organisation de type Business Improvement District (BID) [1], et non à travers une agence municipale, que la plupart des « improvements », autour de Bryant Park, ont été réalisés. Ces organisations ne sont pas des charités, mais exercent plutôt un pouvoir de contrainte quasi légale et de perception de redevances sur leurs membres.
C’est aussi le cas d’autres districts abordés dans l’ouvrage, comme celui de Jamaica Avenue et son BID (qui est également l’histoire de la lente transformation d’un corridor commercial). Se posent toujours des questions légitimes d’équité, de représentation et de gouvernance parfois, qui sont abordées sans dissimulation par l’auteur. Mais puisque la résultante du travail est bien souvent si manifestement transformationnelle, cette question est généralement étouffée. Et comme l’auteur l’admet même, toutes les décisions ont été rendues dans la communauté de manière « top-down » ; les discussions avaient lieu seulement au moment de considérer les changements et amélioration possible, une fois les décisions implantées. Les circonstances ont voulu que les têtes dirigeantes de ces BID, comme l’auteur, étaient particulièrement bien imprégnées des attitudes et des idées de William H. Whyte sur l’aménagement des places publiques, des espaces urbains, et de comment assurer une catalyse dynamique et durable. Mais autrement, quels auraient été les correctifs possibles si les choses avaient été autrement ? C’est probablement une des raisons que l’on voit trop souvent ce type d’organisation se contenter du triomphe facile de l’extraction économique à court terme et de l’accommodement universel de l’automobile.
Dans un environnement urbain dévitalisé ou lourdement grevé sur le plan économique, toute modification au statutquo peut vite entrainer des blocages centrés autour d’instincts conservateurs ; de même pour les espaces qui « fonctionnent » à une échelle autoroutière. L’ouvrage reste honnête et transparent sur les aspects parfois difficile et même contradictoire de la proposition. Mais à travers le récit de son parcourt, l’auteur fait le pari qu’une application raisonnée et contextuelle des observations de William H. Whyte constitue un investissement productif et durable, autant pour la ville que ses citoyens.
[1] Au Québec, il existe un équivalant, les Sociétés de développement commercial (SDC).